Héctor Abad et les raisons du cœur
 L’écrivain de Medellín n’a pas son pareil pour ouvrir une fenêtre grand angle sur sa Colombie. Il est vrai que, comme beaucoup de romanciers, a fortiori latino-américains, il fut et il est, aussi, journaliste. Il en a même tiré un livre journalier, Lo que fue presente (2019) qu’on pourrait traduire par Le présent du passé (au cas où un éditeur français serait preneur). On le connaît chez nous par ses deux grands romans, L’oubli que nous serons (2010), chant d’amour à son père assassiné par des sicaires à la solde d’« allez savoir qui », et qui était médecin hygiéniste et… président de la Ligue des droits de l’homme de Medellín ; et La Secrète (2016), qui campe sa terre natale et sa généalogie en proie à l’immense pouvoir destructeur des milices armées de Colombie. Sans oublier le très bel ouvrage Trahisons de la mémoire (2016), enquête policière sur un sonnet de Borges, et qui donne la clé de son écriture, car Héctor Abad est un homme de mémoire et de greffe, qui n’oublie rien, enregistre et prend note de tout, pour nous éclairer sur l’histoire ─ avec même un grand H. En ce début d’automne paraît en Espagne, chez Alfaguara, son éditeur habituel, son troisième roman, Salvo mi corazón, todo está bien (Sauf mon cœur, tout va bien, 360 pages), et avec lui l’émerveillement d’un lecteur qui entend en parler et en dire tout le prix.
L’écrivain de Medellín n’a pas son pareil pour ouvrir une fenêtre grand angle sur sa Colombie. Il est vrai que, comme beaucoup de romanciers, a fortiori latino-américains, il fut et il est, aussi, journaliste. Il en a même tiré un livre journalier, Lo que fue presente (2019) qu’on pourrait traduire par Le présent du passé (au cas où un éditeur français serait preneur). On le connaît chez nous par ses deux grands romans, L’oubli que nous serons (2010), chant d’amour à son père assassiné par des sicaires à la solde d’« allez savoir qui », et qui était médecin hygiéniste et… président de la Ligue des droits de l’homme de Medellín ; et La Secrète (2016), qui campe sa terre natale et sa généalogie en proie à l’immense pouvoir destructeur des milices armées de Colombie. Sans oublier le très bel ouvrage Trahisons de la mémoire (2016), enquête policière sur un sonnet de Borges, et qui donne la clé de son écriture, car Héctor Abad est un homme de mémoire et de greffe, qui n’oublie rien, enregistre et prend note de tout, pour nous éclairer sur l’histoire ─ avec même un grand H. En ce début d’automne paraît en Espagne, chez Alfaguara, son éditeur habituel, son troisième roman, Salvo mi corazón, todo está bien (Sauf mon cœur, tout va bien, 360 pages), et avec lui l’émerveillement d’un lecteur qui entend en parler et en dire tout le prix.
C’est donc d’une histoire de cœur qu’il s’agit. Et, comme le dit l’auteur, « tout ce que l’on peut écrire sur le cœur devient image et métaphore ». Le cœur avec toute sa physiologie, et dont on connaîtra le mécanisme et le fonctionnement après avoir lu ce livre, mais aussi le cœur avec toutes « ses raisons que la raison ne connaît pas », comme disait Pascal, et ces raisons-là s’appellent Dieu et la foi, certes, mais aussi et surtout, en amplitude, en complétude, l’amour. Avec Hector Abad, on a toujours, au sens le plus noble, le plus large, le plus fort, l’Amour en majesté. Six personnages trouvent ici leur auteur. D’une part, deux prêtres ─ l’un pénétré de l’amour de Dieu et de tous les êtres, et l’autre de l’amour (physique) des hommes et de Dieu en étonnante symbiose ─ et un écrivain qui entend écrire la biographie du premier ; de l’autre, trois femmes, une Italienne, une Indienne (ou indigène, comme il préfère dire) et une Colombienne juive. Tous personnages étroitement mêlés au sein d’une même intrigue au catgut savamment tissé.
Le centre de livre est occupé par ce prêtre Luis Córdoba, dit le Gros, un géant d’un mètre quatre-vingt-huit pour 135 kilos, véritable arbre claudélien, homme de foi et de sagesse, à la voix forte, une voix de chêne ─ ainsi Alain Cuny dans Tête d’or ─ tétant de toutes ses feuilles le verbe divin en parfaite verticalité, sans jamais oblitérer son devoir et son goût séculier, en parfaite horizontalité, ainsi que le dessinent les deux barres de la Croix. Cet homme, au corps pur, immaculé, totalement pétri de bonté et d’amour humain et divin ─ pour lui, du pareil au même ─ va connaître sa nuit obscure et son Via crucis. Car son cœur est las d’irriguer son grand corps, alors il grossit démesurément et un jeune médecin de ses amis, à qui le Gros rapporte d’un voyage en Allemagne (où il fut formé comme prêtre) un stéthoscope dernier cri, l’ausculte un beau jour et voit que son cœur ne tient plus en place et se perçoit désormais sous l’aisselle.
Ce gros cœur, c’est grave, très grave, irrémédiablement grave. Le voilà éligible, comme dit notre système de santé, à la transplantation cardiaque. Mais où trouver un cœur à sa mesure ? De plus il doit quitter la maison qu’il partage avec un prêtre, Lelo, qui est son ami le plus cher et son complice, et qui, à l’inverse, a le goût des hommes, gay à la foi tourmentée. Le Gros, comme on l’appelle, ne peut plus monter à l’étage, grimper des escaliers, le test d’effort lui serait fatal. C’est alors qu’intervient le troisième homme, Joaquín, son complice des séances de cinéma qu’anime Córdoba ─ ce prêtre est un fameux critique de cinéma et un animateur de ciné-club (pareillement à Rennes, un curé, Jean Sulivan, anima le ciné-club de la ville des années durant). Ce Joaquín, qui a divorcé de sa femme ramenée naguère d’Italie, Teresa, lui suggère de s’installer dans leur maison familiale, de plain-pied et sans escaliers. Teresa va donc accueillir le Gros chez elle, et l’installer près du téléphone en attente de l’hypothétique donneur. Et là, ce prêtre quinquagénaire, qui n’a jamais connu de femme, va découvrir la tendresse féminine. Celle, toute platonique, de Teresa qui l’aide dans son difficile régime, et celle de Darlis l’Indienne qui, avec un talent de guérisseuse, va masser constamment le cardiaque égrotant, drainages lymphatiques et plus si affinités. Quant à la troisième femme, Sara Cohen, elle est l’amie fidèle, la confidente, celle qui discute d’égal à égal avec ce curé atypique, soit qu’elle le taquine d’un brin d’humour juif, un rien provocante : « Jésus est le Juif qui a eu la plus grande clientèle de tous les temps » ; soit que, plus sérieusement, elle se penche sur le destin tragique du « peuple élu » :
« Les Juifs sont polis par la souffrance et lissés par les tourments, comme des galets sur la plage. On ne distingue les Juifs que lorsqu’ils meurent, comme on distingue les galets des autres pierres ; quand une main forte les lance, ils ricochent deux ou trois fois à la surface de l’eau avant de sombrer
Toute maladie grave entraîne une véritable révolution de la conscience, de la pensée. La proximité de la mort pousse à un retour désespéré vers la vie. Alors, un cœur tout neuf redonne à vivre, à survivre, il représente la chance d’une nouvelle vie. Et voilà que ce curé découvre la beauté, la tendresse, l’affection féminine, et surtout, au contact quotidien de ces trois enfants qui l’entourent ─ deux de Teresa, un de Darlis ─ et avec qui il ne cesse de jouer, il éprouve l’immense tentation de la paternité, si contradictoire avec sa condition de prêtre catholique. Il s’en ouvre à sa confidente :
« De bien belles choses me sont arrivée ces mois-ci, Sara. J’ai vécu dans une famille réelle, une famille complète avec trois enfants et deux femmes… Ne le prends pas mal, mais pendant ce temps-là, c’est comme si Teresa et Darlis avaient été mes épouses, et ces enfants, mes fils. »
Alors ce prêtre d’immense honnêteté et de grande sagesse, se promet, dans cette autre vie promise, de se défaire de l’habit sacerdotal, d’épouser une des deux femmes, de préférence l’indigène, et de lui faire un enfant. Avec un infini doigté le romancier, qui par ailleurs ouvre un véritable procès à l’Église romaine, pose le problème et nous le rend accessible : n’est-ce pas là aussi la raison du cœur dont parlait Pascal, cette raison secrète et souveraine ? L’auteur traite cette ambiguïté avec quelque humour, qui ne manque pas de grincer, car il lie, par un jeu de mots, la FE – en langage médical, la Fraction d’Éjection, c’est-à-dire le pourcentage de sang qui est expulsé à chaque contraction ─ et la Foi (qui se dit Fe en espagnol) :
« Mon problème, c’est la FE, la foi, j’ai un problème de foi, et définitivement, il me faut avoir plus de foi, de FE, plaisantait toujours Córdoba, la veille même de son opération. »
Ce cœur gros, dans tous les sens du terme, est donc la dramatis personae du roman. Dans ce sillage on pensera, certes, au beau récit de Maylis de Kerangal, Réparer les vivants (2014), qui rapportte vingt-quatre heures de la vie d’un jeune homme victime d’un accident de la route et dont la mort cérébrale permettra de prélever de précieux organes, et de sauver, par transplantation, quelque cardiaque en dernière extrémité. D’où ce rappel, qui est un hommage à la romancière française, figurant par ailleurs dans les remerciements de l’auteur en fin de volume :
« Il se souvenait d’une de ses amies à qui les médecins avaient demandé, organe par organe prélevé sur son fils, si elle acceptait que ce soit donné ou non. La peau ? Oui. Les yeux ? Oui. Le cœur ? Oui, oui, oui, le cœur aussi, le cœur aussi ! Mais ce don d’organe avait fini par la briser, elle, pour toujours, sans que ce fût une grande consolation que d’autres vivent maintenant grâce à des lambeaux survivants de son jeune fils. »
Mais ici, alors que le temps urge, où trouver l’impossible donneur ? Il faudra, donc, en passer par l’innovation chirurgicale d’un médecin brésilien venu à Medellín exposer son « procédé », qui consiste à amputer le ventricule gauche d’une part excédentaire, afin de réduire le volume du gros cœur, et advienne que pourra… Et le prêtre de réfléchir à cette nouvelle donne qui ébranle toutes ses croyances :
« À notre époque, incapable de démontrer l’existence de l’Esprit, ou de l’âme, qui ne se voit ni se perçoit avec aucun appareil, la définition de la vie ou de la mort a désormais cessé d’être le monopole de la religion, de nous, les curés ; la vie et la mort sont définies maintenant par ceux qui soignent, c’est-à-dire les médecins, les nouveaux grands-prêtres qui disent qui continue à vivre et qui meurt. »
Mais, au-delà de la précision physiologique de l’affection cardiaque, dont souffre, au miroir de Córdoba, le propre Joaquín qui est le véritable auteur, disons plutôt le promoteur, du récit, ─ et qui sait donc de quoi il parle ─, le romancier, qui a lu Balzac et Vargas Llosa, se plonge dans la société colombienne et aborde des thèmes de haute volée et de brûlante actualité, tels que le célibat des prêtres, la théologie de la libération, la corruption du pouvoir, et partant de l’Église colombienne ─ couvrant de vitriol un des cardinaux les plus en vue au Vatican ─, sans oublier le narcotrafic et les assassinats ─ dont celui du père de Sara, un médecin, tiens, comme le père du narrateur dans L’oubli que nous serons. Et surtout une percutante méditation sur la vie et la mort, l’irrémédiable duel. Héctor Abad promène son miroir stendhalien sur toutes les couches, et souvent nauséabondes, de la société colombienne. Mais par les yeux du prêtre nous vivons le bonheur de l’évasion cinématographique et la véritable harmonie à travers la musique, Mozart, notamment, dont il sait savourer et faire aimer tout à la fois La flûte enchantée et le Requiem, l’esprit magique et le religieux.
L’oraison funèbre de Lelo est assurément l’un des sommets de cette écriture :
« Luis mort, chers amis, ce qui est mort pour nous, c’est sa façon exquise d’exister. Ce qu’on n’entend pas maintenant et n’entendra jamais plus, c’est cette voix sage… Ce qui s’est arrêté, plus que son cœur, c’est sa façon d’être bon ami, bon compagnon et bon curé aussi, capable de curer l’incurable sans se targuer d’aucun miracle. Son cœur battait dans tout ce qui était vie et joie. »
Les chapitres sont, significativement, séparés par des cœurs rouges, et le récit se construit et se déroule au rythme des palpitations cardiaques. On finira cette lecture à bout de souffle et le regard noyé. Héctor Abad est le fils d’un médecin exemplaire, d’une immense humanité et pour cela-même assassiné, et l’on pourra penser qu’un tel roman, si pétri de vie, si menacé de mort, si allégorique de notre existence, de l’escrivivir (un mot emprunté à Julián Ríos) qui fait de chaque mot une goutte de sang et de chaque parole vitale une promesse de mort, est finalement le tombeau de son père. Un roman filial, bouleversant, d’une intense émotion à travers les mailles d’une intrigue rigoureuse et d’une approche scientifique, et plus encore métaphysique, de ce corps condamné qu’on voudrait réparer. C’est cela, en définitive, au regard de la culpabilité de ceux qui restent, et qui, dans cette impuissance qu’on appelle fatalité, voient partir l’être cher : un roman de réparation.
Albert Bensoussan
(« Hector Abad et Albert Bensoussan » photo Passou)
4 Réponses pour Héctor Abad et les raisons du cœur
Un immense bravo, un immense merci, et à Hector Abad et à Albert Bensoussan, pour nous avoir,l’un donné et l’autre fait découvrir, ce palpitant roman dont le protagoniste est le coeur, au sens propre comme au figuré!
La littérature, la vraie, est toujours une affaire de coeur.
Merci monsieur Albert Bensoussan.
Quand on a lu l’article d’Albert Bensoussan, on a l’impression d’avoir lu le livre. Du moins pour son intrigue, car le style de ce livre doit certainement demandé à être savouré et donc la nécessité s’impose de le lire, même en traduction.
Ce magnifique article de Albert Bensoussan émeut jusqu’au fond du cœur ,dont il tire sa substance . Plaise au Ciel que le roman d’Héctor Abad enfin traduit soit vite édité car nous l’attendons avec impatience.


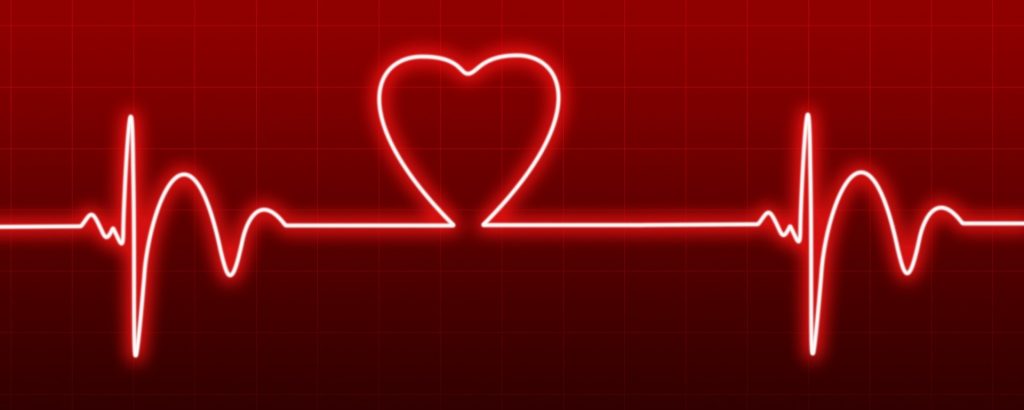
4
commentaires