
Le désir d’Europe des écrivains latino-américains
 Dans un écrit de 1524, Hernán Cortés désigne un lieu de culte du peuple aztèque par les mots de « grande mosquée ». face au vertige de l’inconnu, il se tourne vers le déjà-vu et, par cette torsion du réel, garde pied et ramène la réalité neuve à une expérience antérieure. Les Européens ont conquis les territoires et colonisé les peuples d’Amérique allant jusqu’à les plier à leurs utopies et leurs fantasmes. Grâce à cette construction chimérique du lieu, ils ont offert un matériau idéal aux écrivains à venir. En contrepoint, si les Latino-Américains ont eu un désir d’Europe, leurs rapports au réel les ont conduits à l’incontestable et au tangible. Leurs aspirations les entraînaient vers ce modèle et à la fréquentation respectueuse de figures imposantes.
Dans un écrit de 1524, Hernán Cortés désigne un lieu de culte du peuple aztèque par les mots de « grande mosquée ». face au vertige de l’inconnu, il se tourne vers le déjà-vu et, par cette torsion du réel, garde pied et ramène la réalité neuve à une expérience antérieure. Les Européens ont conquis les territoires et colonisé les peuples d’Amérique allant jusqu’à les plier à leurs utopies et leurs fantasmes. Grâce à cette construction chimérique du lieu, ils ont offert un matériau idéal aux écrivains à venir. En contrepoint, si les Latino-Américains ont eu un désir d’Europe, leurs rapports au réel les ont conduits à l’incontestable et au tangible. Leurs aspirations les entraînaient vers ce modèle et à la fréquentation respectueuse de figures imposantes.
« Je rêvais de Paris depuis l’enfance à tel point que, au moment de la prière, j’implorais Dieu de ne pas me laisser mourir sans avoir connu Paris. »
Rubén Darío dit ici son rêve d’apprenti écrivain et annonce bien d’autres jeunes auteurs qui iront chercher au loin modèle et inspira- tion. L’un des tout premiers écrits de Julio Cortázar est un essai sur Rimbaud et Octavio Paz exprime ainsi son adhésion au Paris de l’après-guerre :
« Je n’étais pas de là et, cependant, je sentis que j’y avais une patrie intellectuelle. une patrie qui ne me demandait pas de papiers d’identité. »
Au creux des rêves, ancrés dans des illusions qui invitent à l’ailleurs, des deux côtés de l’Atlantique, on a souvent projeté son imaginaire par-delà les flots. Chacun a cru voir chez l’autre l’image du bonheur et l’espace idéal où transposer ses propres fantasmes. Depuis que les deux continents sont en rapports étroits, ils entretiennent une relation unique de par la distance qui les sépare et de par une proximité qui implique une forme de complicité. Le passé leur a légué des langues, des valeurs et des croyances communes, mais aussi des dissemblances qui alimentent le dialogue enrichi par les similitudes perceptibles et les fructueuses dissonances. Le décalage entre les deux territoires invite à combler le vide pour y planter ses propres illusions et laisser courir son imagination.
Durant cinq siècles d’échanges de regards et de curiosités réciproques, des écrivains ont donné forme à ces questionnements ou les ont utilisés pour trouver une résonance plus universelle. Le rôle de l’écrivain est de conserver la mémoire, de déceler une cohérence dans le chaos et d’inventer des fables qui nous entraînent dans un lieu autre, chargé de sens et de merveilleux. Ce déplacement spirituel traduit le passage géographique d’un bord à l’autre de l’océan : le voyage et la littérature sont deux façons de défier les héritages ou les contraintes de l’existence. Ces deux activités peuvent aussi constituer une forme mineure de résistance des plus révoltés ou, plus simplement, de ceux qui ont du mal à adhérer à la réalité. Nombre d’écrivains ont cru percevoir sur l’autre rive un territoire mystérieux et fascinant. Cette traversée, dans les deux sens, s’est beaucoup pratiquée au XXe siècle : les auteurs ont deviné que la terre d’en face accueillerait leur monde intérieur et leur offrirait la possibilité d’appréhender le monde sous un angle nouveau (…)
Pendant des siècles, à de rares exceptions près, le savoir et la culture ont voyagé dans un sens, de la Métropole aux colonies. Depuis le voyage en Europe de Rubén Darío, à la fin du XIXe siècle, le quasi-pèlerinage vers le Vieux Continent constitue une étape obligée pour les auteurs latino-américains. Souvent écœurés par la médiocrité ambiante, soucieux de compléter leur formation qu’ils jugent lacunaire, ils remontent à la source de leur civilisation, à la rencontre de cette Europe qui a colonisé, imposé ses langues et ses croyances, et qui reste le noyau de leurs savoirs. on conçoit mieux l’évolution des littératures d’Amérique lorsqu’on comprend qu’elles se situent par rapport aux cultures-mères, qu’on saisit leur désir de se démarquer, d’inventer des traits originaux.
Certains écrivains ne prennent conscience de leur particularisme qu’une fois installés dans un nouvel environnement : jamais Asturias ou Cardoza y Aragón n’ont mieux appréhendé le monde maya que lorsqu’ils vivaient dans la capitale française. Et tous ceux qui ont suivi cette route en ont appris autant sur les pays visités que sur leur terre natale. C’est un défilé incessant. Carpentier, Sábato, Borges puis García Márquez, Cortázar, Ribeyro, Sarduy, Puig, Gelman traversent l’océan. L’Espagne accueille Onetti puis Bolaño, Cabrera Infante, et Sergio Pitol poursuit son vagabondage européen pendant de longues années. Fuentes et Vargas Llosa construisent leur renommée mondiale sur le Vieux Continent car il constitue non seulement le cœur de la culture mais aussi le lieu de la reconnaissance et du succès, ou du moins l’a longtemps été. À l’époque, les vieilles capitales trop sages détiennent les clefs des mystères du monde et des jugements de valeur sur les œuvres.
 Chacun a ses raisons de partir. Chaque écrivain qui effectue la traversée obéit à un destin unique. L’attirance qu’ils éprouvent est-elle de même nature ? La vision du Latino-Américain est-elle du même ordre que celle de l’Européen qui se projette par-delà l’océan ? Plus qu’à des comparaisons ponctuelles, ces problématiques invitent à réfléchir sur les notions d’écriture et d’ailleurs, sur les causes de la séduction exercée par les lointains qui permettent à l’œuvre de se développer, sur la capacité d’auteurs littéraires de se projeter dans un environnement neuf et d’y implanter leurs mots avec une vigueur renouvelée. À l’examen de leurs œuvres, on distingue chez les écrivains européens et latino-américains trois raisons de se lancer dans l’aventure – si l’on exclut les raisons professionnelles – : l’errance, la quête et l’exil. Ces motifs ne s’excluent pas entre eux et peuvent même se combiner sans heurts.
Chacun a ses raisons de partir. Chaque écrivain qui effectue la traversée obéit à un destin unique. L’attirance qu’ils éprouvent est-elle de même nature ? La vision du Latino-Américain est-elle du même ordre que celle de l’Européen qui se projette par-delà l’océan ? Plus qu’à des comparaisons ponctuelles, ces problématiques invitent à réfléchir sur les notions d’écriture et d’ailleurs, sur les causes de la séduction exercée par les lointains qui permettent à l’œuvre de se développer, sur la capacité d’auteurs littéraires de se projeter dans un environnement neuf et d’y implanter leurs mots avec une vigueur renouvelée. À l’examen de leurs œuvres, on distingue chez les écrivains européens et latino-américains trois raisons de se lancer dans l’aventure – si l’on exclut les raisons professionnelles – : l’errance, la quête et l’exil. Ces motifs ne s’excluent pas entre eux et peuvent même se combiner sans heurts.
L’errance est cette forme de vagabondage qui confie au hasard le soin de proposer événements et rencontres, autant d’éléments fructueux pour l’écrivain et son œuvre. Entre les deux continents il existe une complicité qui rend l’expédition plus facilement déchiffrable et les chocs moins violents. C’est à ce type de voyage, promenade ou lente dérive, que se livrent Henri Michaux en Equateur, Malcolm Lowry au Mexique ou Julio Ramón Ribeyro en Europe. La quête, au contraire, est un déplacement intentionnel, volontaire, à la recherche de vérités nouvelles, de savoirs et de valeurs oubliés dans la terre d’origine. L’écrivain latino-américain est sensible à l’impression de plénitude, d’organisation et d’aboutissement que dégage l’Europe. Son alter ego du Vieux Continent se plaît à voir au-delà des mers un lieu où la vie a conservé une saveur singulière et authentique, où l’existence est moins figée ; il pense que ce côté brouillon autorise une plus grande liberté d’action et d’écriture. Pour ces écrivains-là, la terre lointaine possède des vertus qui avivent l’esprit du voyageur, ils se rendent de l’autre côté dans un but précis. Artaud au Mexique, César Moro ou César Vallejo à Paris incarnent ce type de trajectoire. Ils partent au loin avec la certitude du croisé. Le voyage doit être une révélation et l’écriture avoir la capacité de la mettre en forme.
Les exilés des deux continents peuplent les livres d’histoire de la littérature tout au long du XXe siècle. Les noms arrivent sans peine sous la plume : Benjamin Péret et Ana Seghers au Mexique, Georges Bernanos et Stefan Zweig au Brésil, Roger Caillois et Witold Gombrowicz en Argentine et, dans l’autre sens, Cortázar et Sarduy à Paris, Cabrera Infante à Londres, auxquels on peut ajouter Juan Gelman, Eduardo Galeano, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, Juan Carlos Onetti ou Roberto Bolaño. Pour ces déracinés l’écriture peut conjurer l’absence, ressusciter le passé ou canaliser le désir d’approche du nouvel environnement et les fictions qui les habitent.
L’écrivain est un exilé de choix car sa position, en retrait du monde, fait de lui un marginal et un banni ; l’auteur forcé à l’expatriation est donc dou- blement exclu du réel, en tant que littérateur d’abord, en tant qu’exilé ensuite. Il est encore plus sensible qu’un autre à cette qualité de l’écriture qui permet de jouer avec la dialectique présence-absence, à la possibilité qu’offre son art de rendre vivaces les personnages disparus ou la terre lointaine, de la réinventer voire de la détourner. Il peut imposer au lecteur le sentiment de la perte, qui ressemble si bien au sourd cheminement qui caractérise le passage du temps et la progression de la mort. L’écrivain est comme la pointe extrême d’une forme d’être au monde, d’une grande lucidité, consciente du vide.
Notre écrivain déplacé ne se mêle pas, en général, aux artistes locaux ni ne s’intéresse aux courants esthétiques ou intellectuels de son nouvel entourage. Il n’a pas franchi les mers pour cela. L’homme de plume est un excentré et un excentrique par définition. L’écriture, pour être significative, agit en marge de la société et le créateur doit s’y confiner pour mieux dire le sens du monde, les ténèbres et les questions. Il peut être un maître du grotesque, qui met en évidence les aspects inquiétants ou ridicules de l’existence. La relation de l’écrivain à son propre entourage originel est de la même nature que le lien qui s’instaure avec son nouvel environnement outre-Atlantique, en plus intense. Il devient plus excentré et plus excentrique dans le territoire lointain, il y approfondit sa manière d’être et, par là même, poursuit son œuvre en creusant plus profondément les questions qui le hantent. Par ce déracinement il se rapproche plus vite du noyau central de ses textes futurs, comme si le voyage avait la vertu d’en accélérer la maturation.
Errance, quête et exil : trois raisons de partir qui associent, peut-être abusivement, des écrivains issus des deux côtés de l’Atlantique. Ces voyages ne présentent pourtant pas toujours des caractères identiques et y voir une forme de réciprocité atteint vite ses limites même si les comparer constitue un exercice fructueux. Du côté du Vieux Continent, les auteurs ont sans doute souhaité devenir orphelins, ne plus rien devoir à personne, faire table rase ; ils ont entendu l’appel du recommencement, d’un lieu qu’ils voient vierge et innocent, source de force et d’ardeur. La traversée de l’océan constitue une réponse volontaire à leurs lacunes, voire à l’asphyxie dont ils se croient atteints. on l’observera plus loin dans les séjours de Malcolm Lowry, de Witold Gombrowicz et d’Antonin Artaud, chacun illustrant une forme particulière de déplacement.
Les auteurs latino-américains sont aussi attirés par ce qui leur manque, mais leurs impératifs donnent l’impression d’être plus vifs, les champs du possible plus étroits. Sous les tropiques, les conditions socio-politiques, culturelles ou économiques, imposent des contraintes autoritaires à ceux qui vivent par la pen- sée ou dans l’imaginaire. Eux semblent avoir plutôt cherché des pères au cours de leurs expéditions. César Moro, César Vallejo, Severo Sarduy et Julio Ramón Ribeyro ont vécu avec une clairvoyance exemplaire la conjugaison du voyage et de l’écriture. Contre les menaces et la misère de leur pays d’origine, ils se sont laissés capter par les feux des capitales européennes.
Ces périples mêlent voyage et écriture, dépaysement et construction. Dans cette dynamique qui combine faux-semblants et spectres, l’écrivain est le maître du simulacre : il domine la dynamique apparence/ réalité à laquelle l’invite le voyage au même titre que la pratique de son art. Il sait, ou il apprend à jouer avec la vie, à se placer dans un univers autre pour mieux exposer ses propres chimères.
Ces histoires appartiennent à un temps où l’on passait lentement d’un lieu à l’autre. Là encore voyage et écriture entrent en résonance, tant il semble que l’ab- sence de précipitation permet à ces deux activités de procéder d’un même élan. Voyager et écrire constituent des actes qui se réalisent de manière singulière, comme portés par la spécificité de chacun. Les écrivains dépla- cés possèdent néanmoins des éléments communs, dus à des voyages et des destins comparables. Partager le côté extrême et chargé de sens de ces aventures nous renvoie inévitablement aux fondements mêmes de l’écriture et des énigmes qui la sous-tendent.
(Ce texte est extrait de la préface du livre)
(« Philippe Ollé-Laprune » photo D.R.; « Carlos Fuentes » photo Oscar Martinez ; « Julio Cortazar », photo D.R.; « Roberto Bolano » photo D.R.)
Philippe Ollé-Laprune
Europe-Amérique latine. Les écrivains vagabonds
192 pages, 18 euros
éditions de la Différence
3 Réponses pour Le désir d’Europe des écrivains latino-américains
A partir des années 60, quand les auteurs hispanos-américains ont débarqué en masse sur le vieux continent, nous étions aussi attirés par ce qui nous manquait. La littérature espagnole agonisait sous le réalisme social, et quelques lecteurs français s’adonnaient au nouveau roman tandis que les amateurs de romanesque attendaient mieux. Et le renouveau est venu d’un mouvement en retour.
« Pendant des siècles, à de rares exceptions près, le savoir et la culture ont voyagé dans un sens, de la Métropole aux colonies. »
Quel humour…
pas un mot sur les gringos..c’est une plaisanterie


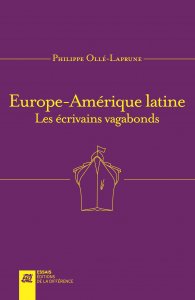
3
commentaires