
Dario Fo, l’indigné
 En création à Genève au Théâtre de La Comédie, dès le 10 avril à Malakoff, voici On ne paie pas, on ne paie pas de Dario Fo, dans une mise en scène du comédien Joan Mompart. Un spectacle enlevé, une belle réussite pour les cent ans du théâtre que dirige Hervé Loichemol, saison anniversaire placée sous le signe d’un répertoire résolument engagé dans son temps. Un théâtre qui tente de « retrouver la joie d’une époque où la citoyenneté avait un sens et le peuple une réalité. Où celui-ci inspirait la vie sociale, dessinait un avenir, orientait la vie artistique et politique ». C’est très exactement le propos que tient Dario Fo dans On ne paie pas, on ne paie pas, pièce de tréteaux datant de 1974 et que l’on dirait écrite en ce début de XXIe siècle – il est vrai qu’il avait procédé à plusieurs réécritures de sa pièce en 1991 et 2008.
En création à Genève au Théâtre de La Comédie, dès le 10 avril à Malakoff, voici On ne paie pas, on ne paie pas de Dario Fo, dans une mise en scène du comédien Joan Mompart. Un spectacle enlevé, une belle réussite pour les cent ans du théâtre que dirige Hervé Loichemol, saison anniversaire placée sous le signe d’un répertoire résolument engagé dans son temps. Un théâtre qui tente de « retrouver la joie d’une époque où la citoyenneté avait un sens et le peuple une réalité. Où celui-ci inspirait la vie sociale, dessinait un avenir, orientait la vie artistique et politique ». C’est très exactement le propos que tient Dario Fo dans On ne paie pas, on ne paie pas, pièce de tréteaux datant de 1974 et que l’on dirait écrite en ce début de XXIe siècle – il est vrai qu’il avait procédé à plusieurs réécritures de sa pièce en 1991 et 2008.
Avec cette farce sociale militante, Dario Fo jette sur le plateau une société en crise à l’heure des délocalisations, de la précarité, du terrorisme politique et d’un mouvement intime de protestation. Alors que l’individualisme forcené est la règle, Dario Fo lui oppose ce que Joan Mompart appelle très pertinemment « l’intimité de l’individu » : dans un monde peuplé « de salauds, de fripouilles et de dupes » où l’on mène une vie de chien jusqu’à partager leur pâtée, les ferments de révolte existent et c’est par la prise de parole qu’une existence se révèle et que tout finira par basculer. Et tout bascule en effet à la fin de la représentation qui voit le plateau du théâtre tanguer, audacieuse machinerie du scénographe Cristian Taraborrelli.
« Quand on est sous-payé, on ne paie pas » s’écrie Antonia, une jeune femme qui, avec d’autres femmes, vient de dévaliser, sans payer naturellement, les rayons d’un supermarché. Chaque jour, les prix ne cessent d’augmenter. L’heure de la révolte a donc sonné : criblés de dettes, menacés d’expulsion, privés d’électricité, les habitants de ce quartier n’ont d’autre choix que celui de la désobéissance civile. Mais tous ne sont pas de cet avis, tous n’ont pas ce courage, lâches ou légalistes, écrasés par la peur de la répression. Comment Antonia parviendra-t-elle à briser leur résistance, à quels stratagèmes va-t-elle avoir recours pour montrer à tous la « réalité des choses » ? Vous le découvrirez dans ce spectacle radical qui, malgré la noirceur qui le sous-tend, est d’une…allégresse parfaitement surréaliste ! C’est que, de quiproquos en situations burlesques, On ne paie pas, on ne paie pas renvoie à un certain rire incertain. Ce « rire de la faim » qui doit beaucoup à un travail d’improvisation et tout à des interprètes inspirés.
Si vous n’avez jamais goûté à une soupe de millet pour canaris dans un bouillon aux têtes de lapins surgelées, c’est le moment de réserver votre table.
PATRICK FERLA
*Avec Brigitte Rosset, Camille Figuereo, François Nadin, Mauro Bellucci, Juan Antonio Crespillo. Mise en scène de Joan Mompart que l’on retrouvera dans Les mains sales, de Jean-Paul Sartre, à la Comédie (23 avril – 8 mai)
http://www.theatre71.com/On-ne-paie-pas-on-ne-paie-pas.htmlhttp://www.comedie.ch/spectacle/on-ne-paie-pas-on-ne-paie-pas
Du 10 au 25 avril 2013 à la Scène Nationale de Malakoff – Théâtre 71
(« Patrick Ferla » photo Passou ; « Dario Fo » photo Manuel Cristaldi)
Dario Fo
Faut pas payer
283 pages, 20 euros
Dramaturgie éditions
16 Réponses pour Dario Fo, l’indigné
J’en connais qu’il faudrait payer pour qu’ils allassent payer de leur personne jusqu’à s’infuser une pièce du pitre officiel d’état que rembourse depuis tant d’années la sécurité sociale culturelle italienne. Même les critiques dramatiques italiens réclament une enveloppe de défraiement conséquente à leur directeur de la rédaction avant de consentir à se compromettre aux audiences publiques de ce bouffon qui s’amuse à jouer avec des « émeutes de la faim » virtuelles. Carmelo Bene le déplorait déjà, les indignés professionnels de Cour sont dans la rue, et ils jouent les « fous ». « Can’t pay, won’t pay » n’est pas une réflexion sur le don de soi, sur la gratuité des choses, c’est un slogan de plus, une invite à faire « payer » je ne sais quels méchants, c’est de la pure binarité conceptuelle faussement clownesque et de pacotille. Et tout cela est proclamé (à la criée) urbi et orbi dans une très mauvaise « phoné ». En attendant, avec votre permission, tolgo il disturbo ! J’ai rendez-vous avec Marie-Antoinette qui m’a promis un petit pain de brioche pour mon goûter.
…
…toute les personne au monde qui ont pris des médicaments sur ordonnance ou par automédication,…peuvent sollicités un rôle de comédien en manque et arborés le Master Tutti-Frutti,…et Marmelade du Profit circonstanciel,…
…je vous est compris,…en 68′,… sont excusées de leurs « avatars « ,…du comportement,…
…inutile de pousser votre séjour aux paradis fiscaux,…si c’est pour revenir » quenouille « ,…Oui,…çà va fort le chypre,…
…etc,…encore des bonnes à l’effort se lécher les babines de l’€uro-States du Loch Ness,…des colonies subtropicales,…
…etc,…c’est assez comme diversion de pingouin surgelé,…et phoque à Dario Fo,…
…envoyé,…au théâtre des costumes,…
…
…l’aventure c’est l’aventure,…film,…etc,…
…
Xlew, ne faudrait-il pas écrire Dario Faux?!
Bien à vous.
MC
xlew.m, Marc Court, vous êtes sévères, mais vous me faites mieux comprendre pourquoi je n’irai sans doute pas (re-)voir « Faut pas payer » / version « On ne paie pas » à Malakoff. Moins par paresse que par fatigue d’une révolte et d’une indignation en effet « officielles ».
Pourtant, vous me faites en même temps rajeunir (ou le contraire ?) : je n’ai pas un mauvais souvenir des années-Fo 60 et 70, de son hommage en acte à Ruzzante, et de « Mistero Buffo » par exemple.
Une pensée, grâce à xlew.m, pour Carmelo Bene, et même pour Deleuze qui, peu amateur de théâtre en scène, ne parlait plus QUE de Bene…
Coq-à-l’âne, mais c’est parce que « Mystère Bouffe » est maintenant au répertoire de la Comédie Française : vu hier soir la pensionnaire Adeline D’Hermy en excellente Hilde de « Solness le constructeur » à La Colline. Cette jeune femme est enthousiasmante, on rêve d’elle jouant aussi bien les jeunes filles de Claudel. Je le dis sincèrement, puisque Chloé a été Hilde il y a quelques années déjà, à l’Athénée.
Bien amicalement vers vous deux,
C.P.
xlew.m .merci de donner un point de vue c lair, net et intelligent.ah les dérives du populisme..
C’est très juste.
– Qu’est-ce qui te reste de Fo’?
– Le souvenir très vague du nom de Carmelo Bene.
– Et de Bene?
– L’image indélébile de Deleuze.
Vous remarquerez que le titre de ce billet en rajoute une couche, sans doute par une allusion au Grand Homme, héraut du devoir d’indignation.
« A voir de toute urgence ».
Cela suscite chez moi des réactions d’enfant: je me recroqueville, malgré moi, devant la cuiller d’huile de ricin.
Ce n’est pas daté, nous dit-on, c’est plus-actuel-que-jamais.
Ce n’est pas didactique, nous dit-on, c’est au contraire d’une folle gaité.
OUVRE GRAND!
Ce n’est pas moi qui dirai le contraire n’y étant pas allé, mais dans ces cas-là, il y a toujours autre chose on top of my priority list.
Je suis naturellement tout à fait près à reconnaître que le talent, voire le génie de Fo’ dépasse infiniment l’idéologie qu’il s’était donnée et l’image qui en est résulté.
C’est analogue (analogue seulement) au désir effacé puis retrouvé de lire du Brecht.
L’anarchisme, la poésie et jusqu’aux sacs de noeud historiques vécus en DDR ont depuis longtemps triomphé de l’accablement laissé par le didactisme idéologique.
On lit BB, si possible en allemand, et on se réjouit.
Peut-être un jour pour Fo’, aussi bien?
In italiano, eh.
Ça dépend peut-être aussi de l’image qu’on se fait des événements en Italie.
(renato, ça lui fait mal au ventre)
On peut vouloir plonger au coeur de ce chaos post-politique, du système Berlo à l’anti-système Grillo, dans sa vulgarité atroce mais peut-être créatrice, pour apercevoir son propre visage, au futur proche.
Fo’ dans ce cas, le Fo’ de 2013 et non des soixante-huitards, présenterait soudain un intérêt nouveau?
la cuiller d’huile de ricin > la cuiller d’huile de foie de morue!
(Il y a là une double malhonnêteté : projeter ma courageuse maman dans l’univers des fasci, et prétendre connaître le goût de l’huile de foie de morue.
C’est peut-être pas si mauvais, l’huile de foie de morue)
Ses souvenirs, Il Paese dei mezarat I miei primi sette anni (e qualcuno in più) chez Feltrinelli, seraient un bon endroit pour commencer.
Mon avis était sans doute lapidaire (c’est toujours une expérience un peu difficile de relire l’un de ses posts, parfois même atroce, le mien ressemble plus à un graffiti inscrit à la va-vite sur le mur d’un lieu public, comme au temps des Romains), mais, même si je n’ai jamais eu de sympathie envers Fo et son oeuvre, sa personnalité aucunement m’indigne ni ne me répugne son travail poétique, c’est leur résonance dans l’Italie contemporaine qui me surprend (et qui m’attriste, je le reconnais et ne renie rien). Pour reparler de lui, Bene semblait l’avoir noté très tôt ce trait caractéristique de la scène artistique italienne ; cette théorie et pratique du « ghigno » à tous les étages de la société du spectacle, cette portée au pinacle, dans le raisonnement intellectuel de la classe académique, du ricanement général. Benigni, Fo ne sortaient pas indemnes de son analyse au scalpel (Toto non plus, mais dans ce cas précis, je le suivrais beaucoup moins). Que sait-on de leur exacte part de responsabilité dans l’irrisitible montée au pouvoir de personnages ultra-bouffons comme Berlusconi ? je ne vais pas m’improviser sociologue de bazar de la société italienne (surtout en présence de personnes telles que C.P, M.Court, Elena, Paul Edel et Ueda — et l’auteur du billet — qui sont d’excellents connaisseurs de ce qui se passe dans ce pays), mais la responsabilité de Fo pourrait être engagée (Toni Negri, dans un de ces livres (Empire), même s’il ne l’écrit évidemment pas nero su bianco, semblait avoir prévu certaines choses choses dans son observation de la radicalisation des gens de Rifondazione, le moment de la mort de Carlo Giuliano en juillet 2001 à Gênes, où l’on vit un jeune homme décent, étudiant en histoire, se laisser entraîner par la rhétorique jusqu’au-boutise des black-blocks — des gens tout à fait rigolards derrière leur sourire sinistre de façade — , offrant un terrible exemple de l’ambiance de l’époque qui pourrait reparaître à chaque instant si la société italienne n’était pas si fortement ancrée dans la démocratie. [aparté : mais peut-être la catastrophe était-elle déjà arrivée et qu’on s’en rend pas si bien compte]). Est-ce que la bonne fortune critique de Fo, en 2013, est vraiment significative d’un vrai génie des lettres et de la scène, c’est ce que je me demande. Même dans le théâtre de boulevard français de de Funès des années soixante, dans celui de Dubillard, dans celui de Ionesco bien sûr, on apprenait des choses intimes sur le pays dans lequel on vivait au moment de la représentation des pièces, aujourd’hui avec Ruquier ou Zeller, c’est moins clair, mais on essaye toujours. Un indigné institutionnel comme Fo (Y. Reza avait raison) voudrait nous faire prendre des tableaux blancs sur fonds blancs pour argent gratuit comptant et nous les faire acheter deux fois, indignation et bonne conscience allant souvent de pair. À l’instant même où les évènement de Chypre (« ne touchez pas à mon dépot bancaire ! ») pourraient donner quitus à sa pièce, lui donner du relief, nous faire saisir des choses, elle ne semble n’être guère plus qu’un pur vagissement, une jérémiade mimant les gémissements des chypriotes moralement dévalisés autant que psychiquement dévastés. Je sais bien qu’une belle scénographie, le génie du jeu des actrices et des acteurs, peuvent sauver bien des trucs chez un auteur dramatique, mais de quelle vraie profondeur, y compris lorsque toutes les dimensions du talent sont au rendez-vous lors d’une représentation, pourrait se réclamer la pièce « Faut pas payer » de Dario Fo si on la mettait face à celle que l’on sent habiter les océans où se meuvent les oeuvres des Goldoni et Marivaux, ces coelacanthes magistraux d’un passé théâtral qui n’est pas lointain, tout juste magnifiquement ancestral, et splendidement intact lorsqu’il fait surface ?
xlew.m, c’est parfait, et vous éclairez encore la gêne que l’on peut ressentir devant un grotesque un peu vieilli… même s’il était par avance juge de la comédie menée par des acteurs politiques d’aujourd’hui. Sans doute la satire de ceux-ci pourrait-elle prendre d’autres formes que les éclats de « grommelot », au sens technique comme au sens large, qui firent un des intérêts du travail comique et sombre de Dario Fo.
Seulement, il faudrait voir plus précisément ce qu’en pense un jeune public ; là-dessus je n’ai pas de certitude. Et enfin, c’est drôle, je ressens un peu de nostalgie quand même de ce « babil des classes dangereuses » (emprunt déplaçant évidemment auteur et oeuvre).
@ C.P, hier soir dans ma voiture (drôle d’endroit pour une rencontre théâtrale, mais comme dirait Dario, Fo ce qui faut, on est pas toujours responsable de ses moyens de transports amoureux, nous faisons tous ce que nous pouvons, literally struggling, dans les domaines de l’amour, du théâtre, et de l’amour du théâtre, sans parler du théâtre de l’amour, the world of love is a stage is a stage is a stage, comme dirait cette fois-ci Gertrude, cheveux au vent dans son cabriolet décapoté), alors que je rentrais chez moi, j’ai entendu à la radio un extrait de la pièce d’Ibsen dont vous nous parliez dimanche. On a eu droit à un passage entre Yordanoff et Michel Robin (acteur extra, ses diction, présence scénique et personnalité, inimitables, sont toujours inspirantes, on a l’impression qu’on apprendra toujours quelque chose de l’homme pas son intermédiaire, c’est assez étrange). Quelqu’un chez moi, qui a vu (à Aix cet été) l’oeuvre qui se joue actuellement à Londres, au Royal Opera House, « Written on skin », me dit qu’on pourrait la rapprocher du « Solness » d’Ibsen. Ce n’est pas une histoire de jalousie entre un père et son fils, de querelle entre la nouvelle et l’ancienne génération, plutôt celle d’une ardente passion destructrice entre une femme-artiste et son mari que l’auteur, lui aussi plus ‘constructeur’ qu’architecte, transforme en parabole philosophique sans lourdeur ni fils épais, sans couler le public dans une torpeur en béton.
Chez Ibsen (chez Strindberg, l’amoureux paroxystique des femmes, c’est encore mieux), les actrices doivent certainement puiser au fond d’elles-mêmes pour montrer au public la couleur de l’accord qui résonne presque en cachette dans le coeur du personnage qu’elles interprètent, il y a des rondes, mais aussi un paquet de triples croches, des emballements, des décalages d’un demi-ton à prévoir, tout ça sans faire étalage de la « petite musique du métier » de comédienne. On a envie de saluer les Adeline et les Chloé qui n’ont pas peur de s’y frotter, en effet.
Souvenir d’un épopuvantable spectacle strasbourgeois, ou Fo payait de sa personne dans un numéro qui a paru à beaucoup du cabotinage éhonté. Mais vous avez peut etre raison, CP, il se peut que ce théatre accroche, comme naguère Tabarin, le Coluche de l’époque d’Henri IV. Au moins dans ce cas_là s’agit-il de textes brefs…
Bien à vous.
MCourt
xlew.m, le spectacle est moyen à mon goût, les décors et la scénographie élégants (et fort peu expressionnistes). Adeline D’Hermy m’a plu, je l’ai dit, Dominique Valadié est discrète et toujours très bonne. Mais Yordanoff est tristounet, comme à l’habitude, en Solness. Je préférais Tcheky Karyo, à la fois plus violent et plus déprimé dans le deuxième acte. C’est dommage, car j’aime Ibsen et cette pièce particulièrement.
Michel Robin, qui a quatre-vingt cinq ans et maintenant ses immenses mains tavelées de rousseurs, vient s’asseoir et boire un verre après le spectacle. Et il dit modestement à Nadine : « Je crois que j’ai dit tout mon texte correctement, et sans oreillettes. Mais vous voyez, je n’ai que sept ou huit minutes à parler en scène, ce n’est pas beaucoup ! »
« oreillette », une seule… C’est le salut de certains acteurs très âgés (je ne vous dis pas qui), les souffleurs ayant disparu.
Luciano di Samosata diceva: “Tutto dipende dai maestri che hai avuto. Ma attento, spesso i maestri non sei tu a sceglierteli, sono loro che scelgono te!” Mio nonno Bristìn mi aveva scelto come suo allievo di clowneria […]
Come se lo stessero aspettando, da ogni lato ecco che spuntano donne e bambini e vengono incontro al carro del Bristìn. Lui le saluta tutte per nome e per ognuna ha una battuta complimentosa o ironica, sempre con uno sfondo di bonario sfottò. Le provoca chiedendo dei mariti, dei morosi e subito inventa lazzi sui loro rapporti, il tutto gettando in aria e riprendendo al volo da autentico giocoliere legumi e verdure. Io allora non afferravo certo la tempesta di allusioni sessuali, spesso oscene, che il nonno scaraventava intorno con il far trombolare zucchini, enormi carote e cetrioli tempestati di bernoccoli… il tutto provocando grasse risate con esplosioni in falsetto e vere e proprie crisi di ridarola.
[…] Le donne sceglievano la merce… […] Era chiaro che tutte quelle clienti venivano in così gran numero intorno al suo carro soprattutto per godersi lo spettacolo di quello spassoso ciarlatore. Ho sempre avuto il dubbio che spesso comprassero roba della quale non avevano ‘sto gran bisogno quasi per ripagare il sollazzo che il Bristìn riusciva a regalare loro.
Gli abitanti di Porto Valtravaglia erano soprannominati “Mezaràt”, mezzo topo, ciè pipistrelli. Questo per via che la maggior parte di loro viveva e lavorava di notte. […] I forni della vetreria dovevano rimanere in funzione ventiquattr’ore su ventiquattro […] Così in quel paese dei Mezaràt le osterie, le trattorie, i bar e gli alberghi o chiudevano mai i battenti. […] In quei locali c’era sempre un gran movimento: i maestri di fornace in attesa dei loro turni in compagnia degli altri nottambuli […] Fra tutta ‘sta caterva di fantasisti sbilenchi, i personaggi che raccoglievano maggior attenzione e rispetto, erano senz’altro i contastorie e i frottolanti. […] I fabulatori erano la gloria e il vanto di questo mio nuovo paese. Li ritrovavi nelle osterie, in piazza, sul sagrato della chiesa, all’imbarcadero, sulle banchine del porto. Spesso raccontavano di fatti accaduti secoli e secoli fa… ma era una ribalderia, cioè prendevano a prestito storie mitiche per trattare della realtà quotidiana e degli avvenimenti della cronaca più recente giocando di satira e di grottesco.


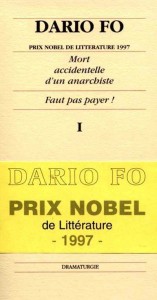
16
commentaires