Refaire « La promenade au phare » avec Virginia Woolf ?
 On pourrait s’étonner du titre donné par Virginia Woolf à son roman Vers le phare (To the Lighthouse)[1], un phare dont pourtant elle a dit (lettre à Roger Fry du 17 mai 1927) qu’il n’était le symbole de Rien. Cependant le phare occupe bien dans le roman une place centrale. On se souvient que le livre se compose de trois parties (La fenêtre, Le temps passe, Le phare) : la première partie, la plus longue, présente les personnages dans la maison d’été des Ramsay, et pose la question de savoir si, oui ou non, une excursion au phare sera le lendemain possible ; la deuxième partie, la plus courte, décrit sous l’œil indifférent du phare, qui continue immuablement son balayage circulaire de l’espace, la lente désagrégation de cette maison d’été désormais désertée pendant la Première Guerre mondiale ; enfin la dernière partie fournit quelques réponses aux questions posées dans la première : une promenade au phare a enfin lieu, tandis qu’une femme peintre (Lily Briscoe, double de Virginia Woolf) réussit à terminer un tableau imaginé dix ans plus tôt. Le livre dans sa structure même fait ainsi explicitement référence au faisceau lumineux d’un phare à occultation, puisqu’il se compose de deux longs temps lumineux (les première et troisième parties), séparés par un temps court de noir absolu (la deuxième partie, où tout – êtres et lieux – semble condamné à tomber dans le néant). De façon absolument « moderne », toute l’organisation du roman repose donc sur une savante construction où le psychologisme n’occupe qu’une place accessoire.
On pourrait s’étonner du titre donné par Virginia Woolf à son roman Vers le phare (To the Lighthouse)[1], un phare dont pourtant elle a dit (lettre à Roger Fry du 17 mai 1927) qu’il n’était le symbole de Rien. Cependant le phare occupe bien dans le roman une place centrale. On se souvient que le livre se compose de trois parties (La fenêtre, Le temps passe, Le phare) : la première partie, la plus longue, présente les personnages dans la maison d’été des Ramsay, et pose la question de savoir si, oui ou non, une excursion au phare sera le lendemain possible ; la deuxième partie, la plus courte, décrit sous l’œil indifférent du phare, qui continue immuablement son balayage circulaire de l’espace, la lente désagrégation de cette maison d’été désormais désertée pendant la Première Guerre mondiale ; enfin la dernière partie fournit quelques réponses aux questions posées dans la première : une promenade au phare a enfin lieu, tandis qu’une femme peintre (Lily Briscoe, double de Virginia Woolf) réussit à terminer un tableau imaginé dix ans plus tôt. Le livre dans sa structure même fait ainsi explicitement référence au faisceau lumineux d’un phare à occultation, puisqu’il se compose de deux longs temps lumineux (les première et troisième parties), séparés par un temps court de noir absolu (la deuxième partie, où tout – êtres et lieux – semble condamné à tomber dans le néant). De façon absolument « moderne », toute l’organisation du roman repose donc sur une savante construction où le psychologisme n’occupe qu’une place accessoire.
Le phare en question a existé réellement. Le livre de Virginia Woolf est en effet partiellement autobiographique, puisqu’il se fonde sur les souvenirs des vacances familiales passées en 1882 et pendant les dix années suivantes par sa famille, les Stephen, en Cornouailles où Virginia pouvait apercevoir au loin le phare de Godrevy[2]. Mais en écrivant Vers le phare en 1926, Virginia Woolf n’a pas seulement cherché à puiser dans ses souvenirs d’enfance : elle a d’abord cherché à faire œuvre de création littéraire, tout en répondant à un certain nombre de questions fondamentales qu’elle s’est toujours posées : comment rendre compte du fameux « flux de conscience » qui agite en permanence l’esprit humain, véritable maelstrom intérieur semblable à la mer ? Quelle place peut être celle d’une femme (sa mère Mrs Julia Stephen, appelée ici Mrs Ramsay) dans une Angleterre victorienne dominée par le pouvoir écrasant des hommes (ici celui de son père, Leslie Stephen, écrivain alors connu) ? Peut-on lutter contre la mort implacable et le chaos, qui finissent par tout abattre ? L’Art (peinture ou littérature) peut-il arracher quelque chose à ce flot destructeur ?
Certes la mère de Virginia, Julia Stephen (Mrs Ramsay), qui avait illuminé de sa présence intelligente et aimante toute la première partie du roman… disparaît soudainement, au détour d’une phrase dans la deuxième partie du roman (comme avait brutalement disparu en 1895 la propre mère de Virginia) : « Mr Ramsay, trébuchant le long du couloir, étendit les bras, un matin obscur. Mais Mrs Ramsay étant morte assez soudainement la veille au soir, ils restèrent vides[3] » (c’est tout : le lecteur n’en apprendra pas davantage !). Elle laisse un mari inconsolable, présenté par Virginia avec plus d’humanité que son propre père, devenu un tyran acariâtre. Il n’est donc pas exagéré de présenter Vers le phare comme une sorte de « mausolée parental[4] » : « un livre-stèle, une sépulture de papier au cœur de laquelle la mère repose enfin [5]» (mais aussi le portrait d’un père qu’elle a à la fois adoré et détesté). Le livre est cependant fort loin de se résumer à un album de famille.
Car que faire autrement du phare ? Dans le roman, il est au moins double, à la fois un bâtiment réel, lointain (dont les gardiens font l’objet des soins attentionnées de Mrs Ramsay), mais aussi une sorte de figure fantastique, susceptible à l’occasion de se charger des significations les plus diverses. Quand, dans la troisième partie, Mr. Ramsay devenu veuf arrive enfin avec ses enfants sur l’île qui porte le phare, il n’y aura nulle compassion dans leur regard, tourné vers eux-mêmes plutôt que vers les gardiens. Des habitants du phare, de ce qu’ils sont réellement et de ce qu’est leur quotidien, on ne saura rien.
La solitude ! En effet, si Mrs. Ramsay, dans sa lumineuse beauté et sa sollicitude pour les autres, était le véritable phare de la première partie du roman (irradiant mais avec ses moments d’éclipse, où elle s’absentait pour se retirer en elle-même), la solitude des êtres qui gravitaient autour d’elle était criante : tous étaient seuls. D’abord son époux, Mr. Ramsay (« C’était son destin, sa particularité, bon gré mal gré, de déboucher ainsi sur un éperon de terrain que la mer est en train de ronger lentement et de rester là, debout, tout seul, comme un oiseau de mer désolé », p. 61) ; et il ne cesse de répéter, allusion à un naufrage décrit par Tennyson : « Nous pérîmes. Chacun tout seul « . La peintre Lily Briscoe, « enveloppée par un profond silence » (p. 194), est une « solitaire personne » (p. 184) ; le triste Charles Tansley, qui ne songe qu’à « défendre son moi » (p. 113), se sent solitaire et préfèrerait être seul avec ses livres dans sa chambre, plutôt que de participer au banquet familial rituel ; etc. La solitude, si elle est souffrance, est aussi libération. Elle peut dépouiller de tous les faux-semblants, des pesantes conventions sociales de la société victorienne :
« souvent, assise, (Mrs. Ramsay) se surprenait en train de regarder, de regarder sans cesse son ouvrage à la main, au point de devenir la chose même qu’elle regardait, cette lumière (du phare) par exemple. [… ] Comment un Seigneur quelconque a-t-il pu créer ce monde ? se demandait-elle. Son esprit s’était toujours rendu compte de ce fait qu’il n’y a ni raison, ni ordre, ni justice : qu’il n’y a que de la souffrance, de la mort, de la pauvreté. Il n’y a si basse perfidie que le monde ne puisse la commettre. Aucun bonheur ne dure ; elle le savait (p. 82-83). »
Le phare solitaire, immuable dans son tournoiement, est également le signe de l’écoulement implacable du temps, qui détruit tout. Si, dans la deuxième partie, c’est à la maison d’été des Ramsay qu’il paraît en priorité s’attaquer (dans la succession des tempêtes, des hivers et des saisons), il s’en prend également aux humains. Virginia Woolf nous montre alors ses personnages qui tombent comme des mouches : Mrs. Ramsay la première, puis sa fille Prue (des suites d’un accouchement) et enfin son fils Andrew (« Un obus fit explosion. Vingt ou trente jeunes gens furent tués en France et parmi eux Andrew Ramsay, dont la mort, Dieu merci, fut instantanée[6] », p. 160-161)… Dans la « vraie » vie Virginia Woolf avait vu mourir d’abord sa mère Julia en 1895, alors qu’elle-même n’avait que treize ans, puis sa demi-sœur Stella en 1897 au retour de son voyage de noces, puis son père Leslie en 1904, enfin son frère Thoby en 1906. Vers le phare est aussi un roman du manque, du vide, de l’absence. Pour Virginia Woolf, de la même façon que les rayons du phare se succèdent éternellement au sein d’une nature aussi belle qu’indifférente, comment échapper à la mort, à l’anéantissement final ? Tout est éphémère, transitoire, tout passe comme un nuage sur les vagues,… ou comme la lumière à éclipse du phare de Godrevy.
En vain semble-t-il les humains, à travers la vieille domestique Mrs MacNab, tentent-ils une ultime parade pour nettoyer la maison. Mais, quand cette dernière s’en va, la nature, débarrassée des humains, se venge implacablement, d’où une description hallucinante de noirceur :
« Si l’on avait pu écouter des pièces d’en haut de la maison vide on n’aurait entendu que les secousses, les écroulements d’un chaos gigantesque traversé d’éclairs. Les vents et les vagues s’ébattaient à la façon de Léviathans amorphes et gigantesques dont le front ne laisse passer aucune lueur de raison et qui, montés l’un sur l’autre, dans des jeux imbéciles, font des poussées, des plongeons dans les ténèbres ou la lumière (car la nuit et le jour, les mois et les années se confondaient en une masse informe), et cela au point qu’on eût dit que l’univers tout entier se battait contre lui-même, se culbutait dans une brutale confusion, dans un déchaînement d’incohérents appétits (p. 167). » Tout se défait, sous les coups de boutoir du temps : « La maison était abandonnée au désordre et à la ruine. Seul le rayon du phare entrait un instant, envoyait son éclat soudain sur le lit et le mur dans l’obscurité de l’hiver, regardait avec tranquillité le chardon et l’hirondelle, le rat et la paille. Rien maintenant ne s’opposait à ces rayons ; rien ne les contredisait. Le vent pouvait souffler ; le coquelicot et l’œillet pouvaient mêler leurs graines à celles des choux. L’hirondelle pouvait construire son nid dans le salon, le chardon écarter les dalles et le papillon se chauffer au soleil sur la cretonne fanée des fauteuils. Le verre cassé et la porcelaine pouvaient demeurer sur la pelouse et disparaître dans la confusion de l’herbe et des baies sauvages (p. 166). »
Dans le roman de Virginia Woolf cependant, la désagrégation ne va pas à son terme. Rappelées par une survivante de la famille Ramsay, deux vieilles femmes, Mrs. MacNab et Mrs. Bast, arrachent à la crue de néant les objets qui peuplaient la vieille maison et stoppent au dernier instant, miraculeusement (mais tout n’est-il pas éternel recommencement, jaillissement, et la lumière du phare n’est-elle pas précisément cyclique ?), la décomposition et la pourriture (p. 167). La maison finalement renaît, même si c’est autrement.
Comment donner une forme durable à un tel chaos ? Comment donner un semblant d’unité à ce monde éphémère et fluide ? À sa façon, c’est ce qu’avait tenté, par l’amour, Mrs. Ramsay. Mais Mrs. Ramsay – ce trait d’union nécessaire entre des êtres que tout sépare, ce « centre rayonnant de beauté, de bonté, de qui émane comme d’un phare une chaude lumière qui efface les ténèbres, protège les amoureux, féconde les stériles, réunit les solitaires, envahit d’amour tout ce qu’elle touche[7] » – était morte. Reste cependant pour Virginia Woolf (pour atteindre cet insaisissable caché derrière le chaos apparent des sensations et du réel) la voie de l’Art : dans Vers le phare c’est la voie choisie par Lily Briscoe, peintre comme la sœur de Virginia[8]. La peinture est un moyen pour restituer quelque chose de la fluidité des choses et des êtres. À la fin, Lily découvre ce qui manquait à sa toile pour vivre hors de l’espace (représenté par la 1ère partie du livre : La fenêtre) et hors du temps (c’est la 2ème partie : Le temps passe) : elle le trouve dans la touche finale de sa peinture, qui fait revenir Mrs. Ramsay disparue avec son fils en la transformant en tache de couleur qui équilibre toute la composition. Mais, comme pour toute artiste, à quel prix, et au terme de quelles incertitudes angoissantes y est-elle parvenue !
Quand Lily peint, « son esprit ne s’arrêtait pas de lancer, du fond de ses abîmes, des visions, des noms, des phrases, ainsi que des souvenirs et des idées, à la façon d’une fontaine se dégorgeant sur cet espace blanc (p. 191). » À travers ce processus créatif, Virginia Woolf évoque ici son propre travail d’écriture, où tout est basé sur le vécu subjectif de la conscience, dans sa complexité, son irrationalité, son obscurité, c’est-à-dire dans ces eaux sombres où notre esprit se meut, dans d’insondables profondeurs… Toujours elle a recherché à recréer le flux chaotique de la conscience, avant son articulation par le langage, comme l’écoulement d’une eau courante.
La seule victoire envisageable sur le temps et la mort n’était donc pas à chercher du côté des Écritures, mais bien dans l’Écriture[9]. À la toute fin de Vers le phare, Lily Briscoe, ayant enfin jeté le trait final sur son tableau, constate que « c’était fait ; c’était fini. « Oui, songea-t-elle, reposant son pinceau avec une lassitude extrême, j’ai eu ma vision (p. 244). »
Jean-Michel Ropars
[1] Autrement traduit en français La promenade au phare.
[2] Ce phare (une tour blanche octogonale en pierre de 26 mètres de hauteur, au centre de l’île de Godrevy) fut mis en service en 1859.
[3] Virginia Woolf, La Promenade au phare, Paris, Stock, Bibliothèque cosmopolite, traduction Maurice Lanoire (références aux pages ici), 1979, p. 155.
[4] Geneviève Brisac & Agnès Desarthe, La double vie de Virginia Woolf, Paris, Points Document, 2008, p. 157.
[5] Id., p. 154.
[6] On est stupéfié par l’extraordinaire habileté avec laquelle Virginia Woolf traduit l’inégal écoulement du temps : il est doué d’élasticité, s’écoulant lentement puis s’accélérant brutalement. Elle avait déjà prêté cette pensée à Mrs Dalloway dans le roman de ce nom (1925).
[7] Monique Nathan, préface p. 10 à La promenade au phare, Stock/Bibliothèque cosmopolite, 1979.
[8] On sait que Vanessa, la sœur aînée de Virginia, était peintre, et que Virginia Woolf, dotée elle-même d’une extraordinaire sensibilité à la vision et aux couleurs, écrivit une vie de Roger Fry, peintre, critique et théoricien d’art, membre du groupe de Bloomsbury à partir de 1910.
[9] Voir Françoise Pellan, Virginia Woolf, l’ancrage et le voyage, Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 12.
Une Réponse pour Refaire « La promenade au phare » avec Virginia Woolf ?
Excellent


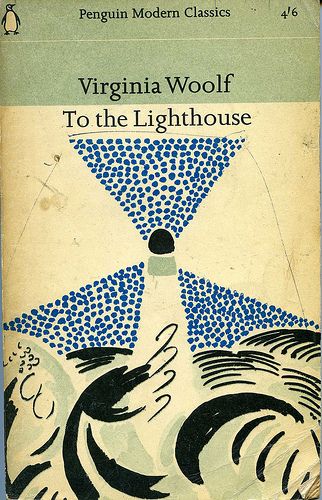
1
commentaire