
Stratégie des deux-points chez Gadda
 (…) Quels sont le noyau et le développement du Pasticciaccio (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana qui paraît ces jours-ci en français sous le titre L’affreuse embrouille de via Merulana) ? La question est à la fois simple et compliquée. Elle est simple par son « histoire » : deux crimes sont au centre des événements, le vol des bijoux d’une comtesse d’origine vénitienne et, deux jours plus tard, l’assassinat de madame Liliana Balducci, romaine, perpétrés sur le troisième palier d’un immeuble, sis au 219 de via Merulana, où vivent confortablement des gens et des familles de la nouvelle bourgeoisie romaine, le « generone ». En réalité, à part celle de Liliana Balducci, on parle peu dans le roman des familles, tant les personnages principaux proposés à la trame sont singulièrement seuls : c’est le cas de la comtesse volée, veuve, c’est le cas du commendator Angeloni, appelé à témoigner, dont la latence homosexuelle ou pédérastique est fortement suggérée.
(…) Quels sont le noyau et le développement du Pasticciaccio (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana qui paraît ces jours-ci en français sous le titre L’affreuse embrouille de via Merulana) ? La question est à la fois simple et compliquée. Elle est simple par son « histoire » : deux crimes sont au centre des événements, le vol des bijoux d’une comtesse d’origine vénitienne et, deux jours plus tard, l’assassinat de madame Liliana Balducci, romaine, perpétrés sur le troisième palier d’un immeuble, sis au 219 de via Merulana, où vivent confortablement des gens et des familles de la nouvelle bourgeoisie romaine, le « generone ». En réalité, à part celle de Liliana Balducci, on parle peu dans le roman des familles, tant les personnages principaux proposés à la trame sont singulièrement seuls : c’est le cas de la comtesse volée, veuve, c’est le cas du commendator Angeloni, appelé à témoigner, dont la latence homosexuelle ou pédérastique est fortement suggérée.
Madame Balducci, elle aussi, malgré son mariage, vit dans la plénitude esseulée de sa fixation mentale, celle de ne pas avoir d’enfants, qui se constitue, au long du récit, comme un manque à vivre. De même pour son mari, toujours en voyage, puis pour son cousin, le beau Giuliano Valdarena, malgré l’imminence de son mariage. Les personnages, en somme, sont inscrits dans des solitudes existentielles fortement marquées. Il est vrai que, çà et là, il se noue des combines, des relations apparentes et des rapports, comme dans le « laboratoire » de Zamira Pàcori, ou dans les locaux du commissariat. Mais ressortent principalement les individualités solitaires à l’intérieur d’un fourmillement de masses composites, inégales et incongrues : les attroupements de curieux au pied du portail de la grande maison, ou sur les marchés dans les différents quartiers visités.
Et, seul parmi tous, le commissaire Ingravallo, « préposé à l’affaire » – qui s’appelait Ingràvola dans la première version de Letteratura, et dont la sémantique du nom pourrait renvoyer à « celui qui rend gravide », quitte à imaginer que ce qu’il tente d’« engrosser » est, à plusieurs titres, « l’histoire » racontée. Solitude « active » que la sienne, car elle l’amène à réfléchir, et cette réflexion, avec l’ensemble de ses possibles, marque le point de départ du roman. L’histoire – un vol et un assassinat – est donc assez simple, voire banale : un élément lointain de suggestion pourrait avoir été inspiré par Crime et Châtiment de Dostoïevski. Des années plus tôt, vers 1924, lors de l’élaboration de ce qui deviendra ensuite le Racconto italiano di ignoto del Novecento, cette annotation de Gadda donne une idée de ses lectures :
« “Malombra” : pour voir comment Fogazzaro décrit le crime […]. Pour le crime éventuellement “Le disciple” de Bourget […]. Je suis en train de lire Dostoïevski – bien ! »
Il existe enfin un très court récit de Carlo Emilio Gadda, de 1948, « Un inchino rispettoso », in Accoppiamenti giudiziosi, qui relate une histoire d’assassinat et de vol probable d’une femme, où apparaît une cordelette utilisée pour la strangulation qui n’est pas sans rappeler la ficelle de la poule du Pasticciaccio. Pourtant, en dépit d’une certaine transparence de l’histoire, celle-ci va vite se compliquer, s’embrouiller, se « pastisser ». Les crimes, sortis du secret et du mystère de leur accomplissement, rendus publics et nourris par la presse, deviennent pâture pour une masse d’officiants et de badauds. Une double réflexion s’impose alors : si pour accomplir un ou deux crimes une ou deux personnes suffisent à l’affaire, pour les dénouer il faut beaucoup plus de monde, et tout ce monde autour crée à lui seul l’image même de la confusion. Pas seulement : en creux, en fond de scène, telle une conscience sourde, chacun des acteurs du débrouillement du crime sait que si l’on retrouve les voleurs des bijoux, ceux-ci pourront être rendus à la victime qui en a été privée, tandis qu’on aura beau retrouver l’assassin, cela ne suffira pas à rendre la vie à la victime.
C’est cette insuffisance que l’écriture essaie de combler. C’est à cette confusion, à ce « pastis », que l’écriture tente de donner un corpus uni, à la recherche d’une seule « vérité de la réalité ». Est-ce réellement possible ou vain ? La vérité de la réalité est-elle saisissable en un unique geste qui lui fournirait l’ensemble de ses explications ? C’est bien cette problématique que fonde le « prologue » du commissaire Ingravallo, sans d’ailleurs parvenir à lui fournir une conclusion, puisque tout fait, toute action venant, pense-t‑il, d’un esprit faible incapable d’en saisir la complexité des motivations profondes, lâchés en pâture au public, se démultiplient en autant de complexions différentes qui finissent par les rendre illisibles. Pour définir ces ensembles variés et multiples, Gadda parle d’affaires qui d’abord ressemblent à des « banalités », mais qui se muent en « catastrophes inopinées », puis en « motifs », ou « mobiles », ou « cause » et « causes », ou « causes concomitantes », lesquels, se mêlant entre eux, prennent la forme d’enchevêtrements très embrouillés.
L’histoire, et avec elle l’écriture, se complique pour d’autres raisons encore : Gadda souligne avec insistance la date qui enserre les événements, et cela pas seulement pour classer la double affaire dans les conventions de toute investigation. Son but est d’inscrire ces événements de moeurs et de crime en 1927, à l’intérieur donc de l’Ère fasciste. La dictature mussolinienne est à l’oeuvre depuis 1922, et à cette époque elle a déjà dépassé la crise provoquée par le meurtre – qui en quelque sorte l’a fondée – de Giacomo Matteotti en 1924 ; Mussolini et le fascisme veulent, surtout dans Rome, ce que ni la monarchie ni la république italiennes n’ont jamais obtenu : à savoir que les trains arrivent à l’heure dans chaque gare, qu’on ne vole ni ne tue impunément. De là aussi vient dans le roman cette parade de commissaires de police et de carabiniers, ceux-là mêmes appelés à assurer la libre circulation des biens et des êtres, à répondre aux questions que le crime, sous toutes ses formes, pose.
Ce n’est évidemment qu’un aspect paradoxal des choses, et les motifs de vitupération à l’encontre de la dictature sont très nombreux dans le roman, et se rapportent directement à l’individu Mussolini – sans pourtant qu’il soit jamais nommé – plus encore qu’à sa politique. Outre les sarcasmes très violents énoncés contre Napoléon et Vittorio Alfieri et Ugo Foscolo – ce dernier est évoqué à deux reprises dans le roman –, Mussolini en prend plein la tronche : c’est à l’ensemble de ces hommes à la masculinité trop définie, caractérisée et, en fin de compte, grotesque que Gadda en veut, à ce manque obtus de finesse, sinon d’élégance, qu’il s’en prend, à cette goujaterie gougnafière qui surpasse les fonctions que ces « héros » s’assignent. Aucun autre roman du xxe siècle n’aura affublé le dictateur d’autant d’épithètes variées, lancées avec une férocité presque libidinale ; et il faudra attendre la publication d’Eros e Priapo, en 1967, véritable pamphlet antimussolinien, pour avoir le tableau complet des injures que Gadda lui destinait.
C’est donc aussi la description des tensions internes et sourdes entre ces deux véritables « organisations », d’une part les policiers, rattachés au ministère de l’Intérieur, de l’autre les carabiniers, rattachés au ministère des Armées. Ces « corps » n’ont pas cessé de s’opposer dans l’histoire italienne – que l’on songe aux innombrables films avec Gina Lollobrigida ou Sophia Loren, la série des Pain, amour et…, ou la série actuelle de Montalbano –, sans oublier les différentes brigades qui composent la police, celle des moeurs ou la brigade politique, par exemple. C’est dire si l’ampleur de la « vérité de la réalité » ne cesse de se boursoufler, passant d’un corps et d’une analyse à l’autre en un enchaînement infini de « concauses » et d’« effets » ; ne serait-ce que pour dénoncer l’inefficacité ou l’impuissance d’un système global qui, pourtant, doit être et se veut, coûte que coûte, exemplaire.
Ce qui se dessine, alors, c’est la désorganisation de l’organisme fasciste, sa délitescence en acte : la description de ces différents moments est régulière dans le roman, elle le traverse et le raccorde sans répit, autant que les crimes, pour en constituer une honte majeure de l’histoire d’Italie, qui peut se répéter, se redire, se rejouer. Au sens propre du terme, cette dénonciation n’a rien de politique – vers 1923, depuis l’Argentine, Gadda exprimait quelque amorce de sympathie pour le mouvement sous forme d’interrogation : le fascisme est censé ne plus exister politiquement au moment où le roman est écrit –, mais elle s’inscrit de plain-pied dans la littérature historiographique italienne au même titre que les oeuvres de Tite-Live, Suétone et Tacite s’inscrivent dans la littérature latine. Le grotesque historique du « personnage mussolinien » est installé, depuis, dans l’histoire de la littérature italienne, de même que certaines caricatures grotesques plus récentes resteront inscrites dans la littérature cinématographique grâce à Amarcord ou à Ginger et Fred de Fellini.
Or, comme partout dans les règles de normalisation imposée, s’il y a crime, il y a pauvre, le pauvre en est même la « cause », le « motif », la « raison » immédiats. Face à cette bourgeoisie cossue et entêtée, la police va chercher chez les plus démunis ses fautifs et ses victimes. La vérité de la réalité se stratifie et se complexifie en couches sociales qui s’opposent, dans ce grouillement de crèche que sont les commis, les femmes de ménage, les ouvriers, les autres corps de métier dans une société à un stade encore précapitaliste, malgré le fascisme, malgré la beauté de Rome, la capitale. Et d’ailleurs : les uns, les riches, vivent dans la ville qu’ils ont quadrillée et vrillée de serrures, pensant ainsi s’assurer de toute invasion et dévastation de leurs solitudes – ce thème étant très appuyé dans le Pasticciaccio – ; les autres, les pauvres, essaient de survivre dans des proximités suburbaines qu’on ne peut pas encore appeler banlieues – à l’intérieur de la même situation précapitaliste –, car c’est déjà la campagne.
On retrouve là, entre ville et campagne, un des motifs les plus forts de la tension poétique de Gadda, déjà amplement développé dans L’Adalgisa, quelques années auparavant. Il ne s’agit pas de donner corps à une dichotomie oppositionnelle, mais de parcourir plutôt deux territoires qui ne peuvent vivre, ou survivre, que dans une sorte de rapport confus et altéré par la proximité de leurs distances et par la nécessité forcée de leurs relations, sans pourtant aucune finalité commune, aucun autre projet que celui de posséder et de déposséder. C’est au fond toute l’histoire de Liliana et de ses « bonnes » ou de ses « nièces », cette incapacité à nouer « la » relation nécessaire entre les mots et les choses, cette volonté de rester dans l’équivoque des non-dits et des non-faits. (…)
L’écriture, dans ses insolences, a tout prévu et dit. Le relief de chacun est à tel point définitif qu’on peut en imaginer, pour chacun, la stase figurale qui le finalise, agissant comme un coagulant statuaire ou visionnaire. Autant dire que la Vénus de Milo ne retrouvera jamais ses bras ou que la Joconde continuera à sourire une main posée sur l’autre, à l’infini. Pour tous, une vie longuement tressée d’incertitudes est le seul lot, et toujours le mal triomphera d’un bien dont nous ne savons rien et qui reste inconnu in æterno, semble dire Gadda, probablement parce que ce bien n’est pas à saisir, à comprendre. C’est aussi que le portrait chez Gadda n’est jamais banal, il inscrit quelque chose de définitif qui tranche sur les doutes, par allusions infimes. Et tout le monde y a droit, petits ou grands personnages, dont la complexion est saisie en un synthétisme tourbillonnant et totalisant.
Et malgré la méfiance gaddienne à l’égard du féminin en général, les plus beaux portraits du Pasticciaccio sont ceux de deux femmes : Liliana et Ines. L’une longuement décrite, à plusieurs reprises, avant et après la mort, et dans l’immédiateté du crime : scène de maître, en plongées et contre-plongées du regard mort qui vise le vide des hauteurs. L’autre, au moment de son interrogatoire par les deux commissaires, peinte par une poétique de l’attendrissement et de l’abandon face à la splendeur possible de la misère : bouts de chair perçus à travers l’émaillage des tricots, fissures actives de l’unité, flamboiements des regards plus violents que la lumière, attitudes qui vivent dans la noblesse d’une culture antique transmise par les corps. La description ici n’emprunte rien à la littérature, mais tout à la culture picturale, et, parmi les peintures possibles, à la seule qui, au fond, intéresse Gadda, au Caravage – l’amitié avec Roberto Longhi en témoigne, comme quelques pages très inspirées du Racconto italiano. D’où viendrait la pose du corps de Liliana sans le souvenir de La Conversion de saint Paul ou du Crucifiement de saint Pierre ? Et la pose d’Ines attablée chez les policiers sans celui de La Vocation de saint Matthieu ? Et sans la Madone des pèlerins, qui imprimerait sa force à Assunta ? Seule Liliana semble échapper à un dessein qui la figerait, même si elle meurt de l’histoire et dans l’histoire et bien que la mort ne soit pas un devenir (…)
La « digression » n’est pas chez Gadda l’élucubration inventive et perdue, elle définit au contraire, solidement, les limites de tous les invariables qui se collent aux personnages et aux situations, qui en font le tissu actif et régénératif. Les « folies » donataires de Liliana ne sont plus telles dès qu’elles investissent une partie ou l’ensemble des personnages, par des truchements certainement osés mais qui dévoilent leur nécessité rigoureuse. L’espace occupé alors par la digression est l’élément de liaison et de lisibilité, et il se pose entre les uns et les autres, entre tous, comme moteur de saturation de l’espace, et même comme élément de sursaturation qui, redisons-le, épuise les possibilités de la matière. Or tout cela n’appartient pas en propre au récit, mais à l’écriture. Peut-être que le récit n’achève pas, mais la scène est toujours achevée, et elle l’est même par surabondance : il n’y a plus rien à en dire, car « tout est dit ». Peut-être non là, immédiatement, peut-être plus tard, dans un ailleurs qui reste improbable et qui n’est pas tout de suite tangible, mais qui est confié, malgré tout, à l’écriture, comme ultérieure et, dirait-on, définitive adresse au Lecteur.
 C’est alors l’élément imprévu qui prend consistance, une consistance que l’individuel humain est incapable de retenir pour lui-même ; et pourtant l’élément imprévu est ce qu’il y a de plus inaltérable dans ce qui nous entoure, inaltérable au sens où il ne se déplace ni ne subit de variations. Il est là, toujours, comme de tout temps. C’est la date, c’est la saison, c’est le marché, c’est ce qui est vendu sur le marché, c’est la démarche des uns et des autres, c’est l’élément féminin, c’est l’élément masculin, l’écoulement de la vie. Chaque chose est prise dans sa détermination territoriale à être ce qu’elle est, chou-fleur, artichaut, garçon, livreur, poule, maquerelle, commissaire et carabinier, qui ne se départit pas de sa fonction, qui y colle même en deçà et au-delà du vraisemblable, en tout cas jusqu’à épuisement de la matière qui lui est propre. Tout geste motive ainsi sa manière, toute intention devient geste, attentif, suspensif, décisif. Décrit par l’écriture. Forcément décrit, parce qu’il n’existe nulle autre part que là, dans les emboîtements que Gadda lui assigne, avec des corrélations spécifiques rassemblées et redistribuées et de nouveau dispersées par l’auteur, dans un premier souci de vraisemblance.
C’est alors l’élément imprévu qui prend consistance, une consistance que l’individuel humain est incapable de retenir pour lui-même ; et pourtant l’élément imprévu est ce qu’il y a de plus inaltérable dans ce qui nous entoure, inaltérable au sens où il ne se déplace ni ne subit de variations. Il est là, toujours, comme de tout temps. C’est la date, c’est la saison, c’est le marché, c’est ce qui est vendu sur le marché, c’est la démarche des uns et des autres, c’est l’élément féminin, c’est l’élément masculin, l’écoulement de la vie. Chaque chose est prise dans sa détermination territoriale à être ce qu’elle est, chou-fleur, artichaut, garçon, livreur, poule, maquerelle, commissaire et carabinier, qui ne se départit pas de sa fonction, qui y colle même en deçà et au-delà du vraisemblable, en tout cas jusqu’à épuisement de la matière qui lui est propre. Tout geste motive ainsi sa manière, toute intention devient geste, attentif, suspensif, décisif. Décrit par l’écriture. Forcément décrit, parce qu’il n’existe nulle autre part que là, dans les emboîtements que Gadda lui assigne, avec des corrélations spécifiques rassemblées et redistribuées et de nouveau dispersées par l’auteur, dans un premier souci de vraisemblance.
Que, par ailleurs, la vraisemblance aille chercher chez Gadda tous les extrêmes possibles est la marque d’une capacité « culturelle » hors du commun, d’une volonté qui n’est aucunement prête à se défaire de l’abandon au phrasé le plus adéquat à la multiplicité qui enveloppe et revitalise de sa continuité réticulaire, alors que l’on croit vivre dans des unités monadiques : nous sommes comme « les seize vents de la rose des vents quand ils s’entortillent en trombe dans une dépression cyclonique ». Cela trouble forcément la langue, et, dans la langue, sa structure et sa perception qui reprennent dans le Pasticciaccio, ou mettent en fonction, le travail critique que Gadda entretient avec l’italien dans le recueil d’essais I viaggi la morte. En premier, sa syntaxe puissante – et elle l’est –, mais qui vibre de fragilités tout aussi puissantes, parsemée de ses innombrables incises lui conférant une allure d’« entretien infini », bariolée des inventions d’une langue « appropriée » qui mêle ses dialectes, c’est-à-dire ses langues, ses multiples langues, à l’intérieur de l’italien qu’ils finissent par minorer. L’infiltration est constante, impossible à arrêter, comme un acte de guerre et d’attaques minutieuses, premiers symptômes d’un mouvement qui devient irréversible, de plus en plus violent.
Le discours direct entretenu la plupart du temps en dialecte romain, parfois en napolitain, est repris ensuite par toutes les phrases disséminées dans la totalité du discours indirect et brode l’italien de sa trame légère et insolente, suivant des significations – des accords, comme en musique – sonores parfaitement orchestrées : articles, adjectifs, adverbes, proverbes, constructions parataxiques recréent un chaos maîtrisé qui s’embrouille et débrouille sous nos yeux, dans notre ouïe, dans notre langue. Cette langue est à la fois une énonciation et une dénonciation, en ce qu’elle énonce son statut « idiolectal » mais par ce geste même dénonce un état de crise de la langue. Et, dans cet appareillage, c’est la ponctuation qui s’offre comme l’élément le plus visible et le plus révélateur ; c’est elle qui devient le pentagramme sur lequel sont transcrites les notes.
Il a fallu suivre cette manière unique dans la prose de restructurer la phrase pour qu’elle perde ce qu’elle semble avoir de plus précieux, à savoir son unité structurelle, sa force de psychologisation à outrance, la classification en genres, l’impossibilité de les mélanger impunément. C’est comme si Gadda s’amusait – et s’évertuait – à détruire, ou à infiltrer, toute structure classique du raisonnement, kantien ou autre. Le moyen le plus voyant de cette réflexion est constitué par la mise en place stratégique des « deux-points » : il y en a, justement, partout, ils constituent le long fil mental sur lequel Gadda retrempe son linge dans les eaux du Tibre et nous offre le corps fracturé et brisé de sa langue, plutôt que de le rincer, comme Alessandro Manzoni, dans les eaux de l’Arno. Les deux-points servent surtout à casser – définitivement pour ce qui est de la prose de Gadda – la structure idéologique de toute dialectique, qui ne sert pas vraiment dans la fonction littéraire, tout simplement parce que les motivations humaines ne se laissent ni formuler ni arraisonner par une pensée structurée, mais errent dans la vacuité vagabonde qui leurest propre.
C’est cette propriété qu’il faut saisir et relancer. Et les deux-points – oubliant la structure de la thèse, de l’antithèse et de la synthèse – organisent les motivations sur une même ligne des affects qui toutes les soutient ensemble sans que l’une dépende forcément de l’autre : d’où, sans doute, l’« affreux pastis ». Même l’enlisement des causes et des effets ne sert plus à grand-chose : ce qui est fait est fait, c’est un fait, c’est le seul fait.
JEAN-PAUL MANGANARO
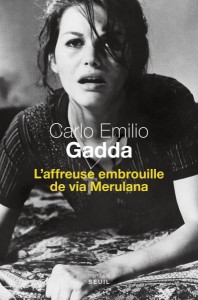 P.S. Il y a des traductions qui « se font ». Il y a des traductions qui « s’inventent », au sens qu’il faut aller les chercher, les trouver. La fréquentation déjà acquise par six traductions qui ont précédé celle-ci – La Madone des philosophes, L’Adalgisa, Les Merveilles d’Italie, Les Années, Vers la Chartreuse, Conversation à trois voix – ne peut être qu’un préalable, sans doute nécessaire, mais insuffisant à l’élaboration qu’a nécessitée cette version du Pasticciaccio. C’est que ce roman est un véritable laboratoire pour Gadda lui-même, qui y entreprend une recherche linguistique de traversées et de glissements à laquelle on a donné le nom de « plurilinguisme ». Le croisement des dialectes et surtout la broderie quasi constante de l’incision dialectale qui se greffe, en la blessant, sur la grande prose italienne sont, dans la langue originale, étonnants, pour une raison relativement évidente : les dialectes sont encore entièrement parlés en Italie. Et Gadda s’en est longuement expliqué dans quelques pages de son oeuvre critique : La phrase, le vocable, sous une main plus expérimentée et plus subtilement à l’oeuvre, se dépouillent de leurs tonalités parodiques : parvenues sur le papier par le cri-cri léger de la plume, chacune s’envole vers un ton nouveau, vers un ton pervers. On leur demande une nouvelle tâche. La nouvelle utilisation les torture : leur figure se déforme, en comparaison avec l’usage, comme u
P.S. Il y a des traductions qui « se font ». Il y a des traductions qui « s’inventent », au sens qu’il faut aller les chercher, les trouver. La fréquentation déjà acquise par six traductions qui ont précédé celle-ci – La Madone des philosophes, L’Adalgisa, Les Merveilles d’Italie, Les Années, Vers la Chartreuse, Conversation à trois voix – ne peut être qu’un préalable, sans doute nécessaire, mais insuffisant à l’élaboration qu’a nécessitée cette version du Pasticciaccio. C’est que ce roman est un véritable laboratoire pour Gadda lui-même, qui y entreprend une recherche linguistique de traversées et de glissements à laquelle on a donné le nom de « plurilinguisme ». Le croisement des dialectes et surtout la broderie quasi constante de l’incision dialectale qui se greffe, en la blessant, sur la grande prose italienne sont, dans la langue originale, étonnants, pour une raison relativement évidente : les dialectes sont encore entièrement parlés en Italie. Et Gadda s’en est longuement expliqué dans quelques pages de son oeuvre critique : La phrase, le vocable, sous une main plus expérimentée et plus subtilement à l’oeuvre, se dépouillent de leurs tonalités parodiques : parvenues sur le papier par le cri-cri léger de la plume, chacune s’envole vers un ton nouveau, vers un ton pervers. On leur demande une nouvelle tâche. La nouvelle utilisation les torture : leur figure se déforme, en comparaison avec l’usage, comme u
n élastique tendu. Horace, dans l’épître « Humano capiti » a indiqué qu’un tel emploi de la parole déjà connue était pensable : le « spasme », « l’emploi spastique », peut impliquer une dissolution-rénovation de leur valeur. L’usage imprécis du peuple, mais qui, dans son imprécision même, recrée ni plus ni moins que la préciosité méditée des baroques, a pris le drapeau. […] Le vocable n’est pas immanent aux millénaires : ce n’est pas un chêne, c’est une moisissure : c’est un prurit des millénaires. Il m’a semblé que je ne pouvais intervenir de la même manière en français, mais en élaborant une langue mouvante – entre élisions et agglutinations, entre métalangage et métalexique – qui aurait pu rendre un corps et un mouvement saturés et efficaces à l’oeuvre. Je dédie ce travail à la mémoire et aux ombres de Dante Isella et de Giancarlo Mazzacurati.
(extrait de la préface à L’affreuse embrouille de la via Merulana de Carlo Emilio Gadda qui vient de paraître au Seuil dans une traduction du préfacier Jean-Paul Manganaro, 368 pages, 23 euros)
5 Réponses pour Stratégie des deux-points chez Gadda
Oh, un romanzo giallo, grazie. Mi piace molto.
Vous avez traduit aussi » La cognizione… », il me semble.
http://blogfigures.blogspot.fr/2012/01/carlo-emilio-gadda.html
Il pasticciaccio Souvenirs de lecteurs relatives :
Gadda veut être, avant tout, un réaliste, mais puisque il ne croit ni à l’objectivité ni à la linéarité, il privilégie l’approche baroque, « qui n’est pas seulement une esthétique mais une éthique de la connaissance aussi »; il casse ainsi tous les codes et élabore une forme de recyclage de la sociabilité et de la subjectivité déhistoricisantes où se mêlent la mélancolie moderne et une confusion des styles ‘pré-postmoderne’ car, plutôt que limiter son action à la simple narration, il agit sur les jeux des langages afin d’en composer une allégorie — la valeur allégorique étant attribué par Gadda lui-même aux faits narrés et à leur concaténation représentative de l’instabilité du réel et de l’inactualité de ce qu’il représente : la finitude du monde et la précarité des signifiés en cherchant le roman qu’il pourrait écrire par une complexe divagation de la trame dans l’enchevêtrement des causes où la voix du narrateur est une pluralité de voix qui varient les personnages : qui parle ? la voix de l’écrivain ? celle du Commissaire ? celle de la collectivité ? celle de chaque personnage et celle des personnages racontés par d’autres personnages ? quel est le point de vue ? la vérité ? ah! La vérité ce n’est que « le résidu fécal de l’histoire » — caché par le Personnage-narrant Gadda est un narrateur qui a oublié le ‘je’ ? Pasolini, cité de mémoire, dit qu’il « est écrasé par deux erreurs : le survivant positivisme libéral pré-fasciste et le lyrisme déformant d’un antifasciste usé et désagrégé par la lutte avec l’état ».
Enfin, j’ai aimé la tradution de « La cognizione », je passerai chez un libraire pour « Il pasticciaccio ». Curieux du rendu en fr. du chapitre VIII.
Néanmoins, le texte de Mangarano sur Gada est assez indigeste…Pas vraiment incitatif.


5
commentaires