
Il faut marcher avec l’auteur
 Suite à la sortie de l’anthologie bilingue de la Baby Beat Generation, publiée aux Éditions La main courante en 2006, diffusée en France et aux USA, j’ai traduit le livre d’un de ces baby beats : le récit autobiographique de Thomas Rain Crowe, Ma vie dans les Appalaches (titre original : Zoro’s field – My life in the Appalachian woods). J’ai organisé en 2006 une tournée française de neuf lectures bilingues avec quatre poètes de la Baby Beat Generation. Qui sont-ils ? De jeunes poètes originaires des quatre coins des États-Unis qui, dans les années 1970, se rendent à San Francisco pour côtoyer leurs pères beats. Ils donnent un second souffle au mouvement et relancent la machine, publient de nouveaux numéros de la revue mythique Beatitude, organisent des évènements avec Lawrence Ferlinghetti (aujourd’hui âgé de 92 ans, fondateur de la librairie culte City Lights, depuis classée au patrimoine historique), Gary Snyder, Diane di Prima, Bob Kaufman (qui grâce à eux sort d’un vœu de silence de 13 ans), Allen Ginsberg, Jack Micheline, Michael McClure, Jack Hirschman… et trente ans plus tard, en 2006, ils se réunissent à nouveau à S.F. pour célébrer cette anthologie où les Beats apparaissent également. Comment je les découvre ? Dans une belle et vieille librairie sur les bords de la Liffey, le fleuve de Dublin.
Suite à la sortie de l’anthologie bilingue de la Baby Beat Generation, publiée aux Éditions La main courante en 2006, diffusée en France et aux USA, j’ai traduit le livre d’un de ces baby beats : le récit autobiographique de Thomas Rain Crowe, Ma vie dans les Appalaches (titre original : Zoro’s field – My life in the Appalachian woods). J’ai organisé en 2006 une tournée française de neuf lectures bilingues avec quatre poètes de la Baby Beat Generation. Qui sont-ils ? De jeunes poètes originaires des quatre coins des États-Unis qui, dans les années 1970, se rendent à San Francisco pour côtoyer leurs pères beats. Ils donnent un second souffle au mouvement et relancent la machine, publient de nouveaux numéros de la revue mythique Beatitude, organisent des évènements avec Lawrence Ferlinghetti (aujourd’hui âgé de 92 ans, fondateur de la librairie culte City Lights, depuis classée au patrimoine historique), Gary Snyder, Diane di Prima, Bob Kaufman (qui grâce à eux sort d’un vœu de silence de 13 ans), Allen Ginsberg, Jack Micheline, Michael McClure, Jack Hirschman… et trente ans plus tard, en 2006, ils se réunissent à nouveau à S.F. pour célébrer cette anthologie où les Beats apparaissent également. Comment je les découvre ? Dans une belle et vieille librairie sur les bords de la Liffey, le fleuve de Dublin.
Dans Ma vie dans les Appalaches, Thomas Rain Crowe explique qu’un jour il a décidé de mettre fin à cette vie urbaine palpitante, qu’il s’est assez nourri de toute cette expérience littéraire et alors il rebrousse chemin vers les terres qui ont vu grandir l’enfant qu’il était, pour se replonger dans ses racines, en pleine nature, dans les montagnes des Appalaches, en Caroline du Nord où il vit encore aujourd’hui, où il cultive encore son potager, une de ses principales sources de revenu, et où il écrit notamment pour des revues écologiques. Ce livre émouvant et pertinent est un récit autobiographique, un essai poétique, philosophique, écologique. Au début des années 1980 et pendant quatre ans, il s’installe dans une cabane qu’il a construite lui-même, au milieu des bois, où il vivra seul et par ses propres moyens, sans électricité, eau courante, transport ni revenu, tout comme l’avait fait, cent quarante ans avant lui, Henri David Thoreau qui racontera son expérience dans un livre passionnant et célèbre Walden, ou la vie dans les bois. Thomas Rain Crowe, comme Thoreau, a appris à couper son bois, à faire son pain de maïs, à cultiver ses légumes, à faire son miel, sa bière maison, à vivre au milieu de la nature et de ses animaux, à penser et à écrire loin de tout…
Le livre d’Henri David Thoreau est toujours d’actualité, a d’ailleurs été retraduit dernièrement, et celui de Thomas Rain Crowe lui fait merveilleusement échos, en est un prolongement naturel et a beaucoup de sens dans le monde actuel. Il y parle de tous ces aspects vitaux pour vivre dans les bois, mais aussi de sujets aujourd’hui cruciaux comme l’environnement, la solitude, l’écoute, la tyrannie de l’argent, la mentalité qui va avec… Ce livre de Thomas Rain Crowe – poète, éditeur, traducteur, et journaliste très actif aux USA – a remporté plusieurs prix littéraires, a eu plusieurs tirages, et est sorti en poche en automne 2006. Il est construit de manière originale puisqu’il est composé de plusieurs chapitres qui décrivent tout ce que l’auteur a dû apprendre et faire pour survivre pendant quatre ans dans les bois : Les outils, La pêche, Les abeilles, L’agriculture, La neige, Les voisins, Les Cherokees (un de mes chapitres préférés), Les animaux, La solitude… et que chacun des ces chapitres commence par une citation : Thoreau, Emerson, Whitman, Snyder… et termine par un de ses propres poèmes. C’est un livre d’une très grande valeur, qui marquera son temps et donnera du plaisir à de nombreux lecteurs français, comme l’a fait et continue de le faire celui d’Henri David Thoreau.
C’est naturellement que j’ai proposé ce texte magnifique, ode jubilatoire que Thomas Rain Crowe dédie à la nature, aux Editions Phébus – heureux du choix de la couverture de l’éditeur, particulièrement belle et réussie, où l’on se retrouve sous la canopée des arbres, ce qui reproduit vraiment l’atmosphère du livre. Idéalement, bien sûr, un traducteur devrait pouvoir traduire les textes qu’il aime, qu’il découvre et propose (même s’il n’est pas rémunéré davantage pour cet apport). C’est extraordinaire de lire par exemple que des traducteurs en viennent à se concocter des dictionnaires attitrés à un auteur en particulier ; Bernard Hoeppfner dans son article du 1er janvier 2013 sur ce même site évoque précisément cet aspect des choses.
Je crois que les autres traducteurs de cette rubrique ont exprimé avec justesse que la traduction est une écriture en soi, le traducteur devient un peu auteur… Il y a toujours un décalage littéraire dans la traduction. Pour trouver ce mot juste, cette formule, cet équivalent, il faut se décaler de la version originale, pour lui être fidèle. S’il est évident que l’écriture est par définition musicale, la traduction l’est tout autant. Le mot juste, la formule adéquate, ne sont pas toujours dans le dictionnaire, il faut les traquer partout, dans toutes nos lectures, parfois même les inventer. Vivre quelque temps dans le pays de la langue à traduire est essentiel. Lorsque je traduis je me mets dans la peau de l’écriture des écrivains et non dans la peau des écrivains. Tout comme il y a quelque chose de mathématique dans la littérature il y a quelque chose de mathématique dans la traduction, de structurel et d’esthétique : respecter le contenu et en faire ressortir la poésie. Traduire c’est écrire. Le traducteur littéraire est un écrivain en soi.
Mais pour ce texte particulièrement, j’ai dû ouvrir des dictionnaires pour des parties très techniques et passionnantes : l’ornithologie et la botanique, de longues heures en quête de l’oiseau ou de l’arbre équivalents. Par contre il n’y avait aucun dictionnaire pour le patois appalachien ! J’ai eu recours à l’auteur qui par chance pour moi est encore parmi nous. Nous avons travaillé main dans la main si je puis dire, avec Thomas Rain Crowe, comme nous l’avions fait pour l’anthologie ; je préparais une série de question pour chaque chapitre, il me répondait assidûment, et nous avons vérifié ensemble le moindre arbre ou oiseau lorsque j’avais des doutes, n’étant pas spécialiste en la matière bien que tout autant amoureux de la nature que lui, vivant à présent dans les belles Pyrénées ariégeoises où l’auteur rêve de me rendre visite – d’une chaîne de montagnes à une autre !
Je retrouvais un peu mes racines en fin de chaque chapitre, puisqu’un poème vient y mettre fin avec harmonie.
Au rythme de cette traduction sur laquelle j’ai travaillé aux quatre coins du monde (dans un petit hôtel de Lima au Pérou, sur un cahier à anneaux Atoma – j’avais besoin de retranscrire le tout à la main, c’était viscéral -, à Buenos Aires, Bruxelles, Barcelone, et enfin en Ariège), j’ai pas mal marché, comme Thomas Rain Crowe qui marche la plus part du temps dans son livre. D’une certaine façon je marchais avec lui, dans ses mots, dans ses poèmes, dans les bois qu’il a parcouru pendant des années, et cela me permettait de prendre le recul nécessaire, de faire le point, de sentir ce qu’il avait ressenti.
(« Mathias de Breyne et Thomas Rain Crowe » photos D.R.)
(Traduction en cours : La racine de l’ombú, un inédit d’Alberto Cedrón et Julio Cortázar, Editions CMDE)
Thomas Rain Crowe
Ma vie dans les Appalaches
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Mathias de Breyne
304 pages, 21 euros (sortie le 15 mai)
Phébus
3 Réponses pour Il faut marcher avec l’auteur
Je pense que Thoreau a été (ré-)introduit en France par Kenneth White au milieu des années quatre-vingt dans ses livres de l’époque Grasset qui furent très médiatisés. Mais je crois aussi que ce sont bien les premiers mouvements que l’on pourraient appeler « solidaires », « citoyens », qui prônaient vers 1995 que la société se tournât vers plus de soutenabilité, écologique, économique, qui assurèrent sa célébrité, notamment grâce à sa réflexion sur la « civil desobedience », un recueil dont ils s’emparèrent comme un vademecum et qu’ils brandirent jusque dans leurs manifestations, le saisissement d’une oeuvre qui n’aurait rien à envier au succès que connaîtrait quinze ans plus tard, dans des modalités fortement parallèles, le petit livre de Stéphane Hessel (en France tout commence et tout finit par des chansons politiques beaucoup plus que par des chants poétiques.) C’est la lecture de Kerouac (surtout de « Dharma Bums » dans lequel est offerte la description très inspirante pour un jeune de la pratique du « yab-yum » par Snyder) qui fit peut-être découvrir la fameuse poésie Beat aux européens. Pour moi, ce fut vers 1991-92, je me souviens que j’achetais dans les librairies anglo-américaines de Paris tout ce qui sortait de chez Grey Fox Press Books par exemple, une micro-maison d’édition californienne de Bolinas diffusée à Berkeley. Lew Welch, Philip Whalen, Franck O’Hara et bien sûr Allen Ginsberg ou les rééditions de quelques récits de Charles Olson étaient les auteurs de prédilection. Je me souviens que Gary Snyder dans les années de la contestation était assez pote avec le gouverneur Jerry Brown (qui trente plus tard l’est redevenu ! on a l’impression que le temps s’est arrêté en Californie…)
Thomas Rain Crowe (qui porte un nom ultra-poétiquement-beat, on pense évidemment à la pluie, peut-être aussi à un corbeau décrit par Jim Harrison) poursuit la tradition en la mettant au coeur d’une modernité en effet très active (culture maraîchère maison, édition indépendante, on ne saurait faire plus « moderne » en 2013, les échanges directs de producteurs à ‘consommateurs’ sont aussi de plus en plus prisés en Europe.) Cela donne envie de le découvrir par l’intermédiaire de son traducteur (bravo) ou dans le texte, suivant le karma du lecteur, et le choix de son dharma.
Ètrangement Alain Corbin a traité aussi de la question poétique de la douceur de l’ombre portée par les arbres, très récemment (la couverture du livre choisie par Phébus m’y fait penser.)
J’ai eu la chance immense d’assister aux lectures Parisiennes des auteurs de la Baby Beat Generation lors de la sortie de l’anthologie en 2006 et ce fut des moments extraordinaires et j’ai été heureuse de faire la connaissance de ces poètes tellement sympathiques et vrais, notamment Thomas Rain Crowe avec qui j’ai pu un peu discuter…Ce fut un excellent souvenir. Je suis contente plusieurs années après d’avoir de leurs nouvelles, et de connaître la vie de Thomas à présent. J’aime en général les évocations de la nature de Whitman et Thoreau et le dernier livre de Thomas traduit par toi Mathias me donne très envie de découvrir cette vie dans les Appalaches. Il est vrai que le traducteur apporte aussi sa patte à l’écriture de l’auteur et tu as raison il n’est pas l’auteur et se met dans la peau de son écriture mais quelque part, je crois que vous vous ressemblez tous les deux, Thomas et toi, le même amour de la nature, de l’écriture, de la poésie et de la vérité et du coup la communication entre vous est plus forte et ça se sentait déjà dans l’anthologie qui était une oeuvre magnifique. Je vais me préciper pour acheter « Ma vie dans les Appalaches » avec ta traduction pour sentir à travers les pages cet échange entre vous.
Merci
Il faut marcher avec l’auteur


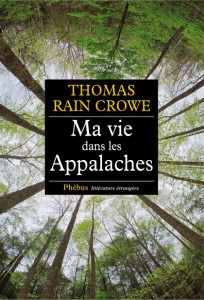
3
commentaires