
Digressions à l’indienne avec Jeet Thayil
 Avec leur habituelle morgue citadine, mes amis mumbayites de l’off-, voire de l’anti-Bollywood, considèrent surtout Jeet comme un chanteur et parolier rock ; à la sortie en Inde de son premier roman, Narcopolis, ils semblèrent lui adresser le même reproche (lui vouer la même jalousie ?) qu’un peu plus tôt à Siddharth Dhanvant Shanghvi (dont j’ai traduit les deux premiers romans et qui semble, toujours selon la rumeur de Bombay, malgré son talent, s’être brûlé les ailes littéraires dans ses papillonnements mondains) : à leurs yeux, Jeet veillait surtout, comme Shanghvi, à façonner son image, c’était le énième (encore) ‘jeune’ auteur indien anglophone à publier un premier roman pour tenter de percer sur le marché occidental, tant que dure en Occident la vogue des premiers romans de ‘jeunes’ (et moins jeunes) auteurs indiens, talonnés par les Bangladeshi(e)s et les Pakistanais. Sur www.stincmusic.com, Jeet Thayil (entendez-le apostropher I love you all son public sur scène) se présente comme « guitariste-poète-romancier » ; il y a dans Narcopolis une phrase plutôt sybilline sur un son de guitare, que j’ai rendue par « un thème à la James Bond sur fond d’orchestration symphonique genre musique de western », dont même l’explication de l’intéressé n’a pas élucidé totalement le mystère pour moi. A son traducteur français de passage à Bombay, Jeet se dit simplement poête, avec à l’appui un ou deux recueils. Un poète légèrement maudit et new-yorkais, auréolé de sourdes vapeurs, de quelques ombres : entre autres, la mort de sa jeune épouse, si j’ai bien compris, et, naturellement, la drogue in a big way.
Avec leur habituelle morgue citadine, mes amis mumbayites de l’off-, voire de l’anti-Bollywood, considèrent surtout Jeet comme un chanteur et parolier rock ; à la sortie en Inde de son premier roman, Narcopolis, ils semblèrent lui adresser le même reproche (lui vouer la même jalousie ?) qu’un peu plus tôt à Siddharth Dhanvant Shanghvi (dont j’ai traduit les deux premiers romans et qui semble, toujours selon la rumeur de Bombay, malgré son talent, s’être brûlé les ailes littéraires dans ses papillonnements mondains) : à leurs yeux, Jeet veillait surtout, comme Shanghvi, à façonner son image, c’était le énième (encore) ‘jeune’ auteur indien anglophone à publier un premier roman pour tenter de percer sur le marché occidental, tant que dure en Occident la vogue des premiers romans de ‘jeunes’ (et moins jeunes) auteurs indiens, talonnés par les Bangladeshi(e)s et les Pakistanais. Sur www.stincmusic.com, Jeet Thayil (entendez-le apostropher I love you all son public sur scène) se présente comme « guitariste-poète-romancier » ; il y a dans Narcopolis une phrase plutôt sybilline sur un son de guitare, que j’ai rendue par « un thème à la James Bond sur fond d’orchestration symphonique genre musique de western », dont même l’explication de l’intéressé n’a pas élucidé totalement le mystère pour moi. A son traducteur français de passage à Bombay, Jeet se dit simplement poête, avec à l’appui un ou deux recueils. Un poète légèrement maudit et new-yorkais, auréolé de sourdes vapeurs, de quelques ombres : entre autres, la mort de sa jeune épouse, si j’ai bien compris, et, naturellement, la drogue in a big way.
Je suis allé lui rendre visite dans son appartement de Bandra, quartier anciennement goan, léthargique, bois et végétation luxuriante, mais aujourd’hui en pleine mutation, rattrapé par le bétonnage et la verticalité shangaïsants de la mégapole indienne, Bandra aujourd’hui victime de sa situation privilégiée, centrale, désormais, dans la topologie de Mumbai, et de son succès auprès des trentenaires (cool, man, yaar !). Depuis, Jeet a déménagé à Delhi, plutocrate haut-lieu de l’édition en Inde, à la différence de Mumbai, tout aussi plutocrate mais cruellement moins intellectuel ; lors de notre entrevue, cependant, il logeait donc en stand-by dans un immeuble bas, en béton, flanqué de trois grêles et poussiéreux cocotiers, vestiges de l’autrefois infinie et languide frange cocotière du Maharashtra.
Le bloc géométrique était typique du premier boom qui a commencé à entacher à la fin du siècle déjà dernier l’atmosphère goane – portugaise – de Bandra. Le deux-pièces de l’écrivain était typique des studios des jeunes artistes de la ville en ce début de XXIe siècle : en m’asseyant dans un coin qui en était aussi le milieu, j’imaginai aisément respirer l’air de l’appartement du narrateur de Narcopolis, humer la présence du personnage-clé du roman, la hijra, le castré, l’eunuque, la « trans », le/la Tirésias, la femme, Fossette, qu’il y invite à la fin du roman, j’imaginai entendre à travers la large fenêtre ouverte les voisins qu’il prend à témoin dans les toutes dernières lignes pour leur présenter ses fantômes, avant de boucler la boucle et de revenir à l’alpha et l’oméga du livre : Bombay.
Avec sa tête de bonze aux lunettes design, ses traits fins, la subtile nuance de la coloration de sa peau lisse et l’impression qu’il donne de flotter juste au-dessus ou à côté de la réalité, Jeet ne fait pas vraiment « indien ». Il n’est à l’image ni de « l’Indien » façonné par l’imaginaire de ceux, parmi les Occidentaux qui, ne la connaissant pas, fabulent l’Inde, ni de l’Indien multiple, contrasté et tout aussi déroutant que perçoivent ceux qui la connaissent et n’affabulent pas moins. On situerait ce faux Indien-là plus à l’est (le Bouddha vient à l’esprit, auréolé de toute une école de pensée jadis sauvagement combattue par l’hindouisme et encore cachée, aujourd’hui, tue et refoulée en Inde, comme le protestantisme en France). Il faudrait aussi le situer, ce faux Indien-là, un tout petit peu plus au sud et beaucoup plus à l’ouest – à moins que… un peu plus au nord ?
Pendant l’entrevue, emporté par mon engouement pour la grande cité, pour Bombay/Mumbai, je commets l’erreur à laquelle un traducteur ne devrait jamais céder face à son auteur : je parle trop, je lui raconte, depuis la première giffle de chaleur reçue à mon arrivée en 1976 – le début de la période, de ce fait, évoquée dans Narcopolis – ma longue histoire d’amour vache avec ce lieu, défaillante ces derniers temps (en raison surtout du bétonnage pré-cité, de sa hargne destructrice, effaçante du passé, ce en quoi le traducteur colle parfaitement, d’emblée, dès la première phrase, à Narcopolis : « Bombay, qui a oblitéré son histoire en changeant de nom et en s’offrant un lifting architectural, est le héros ou l’héroïne de cette histoire… »). De son propre aveu, l’auteur a voulu, avec ce livre, faire œuvre de mémoire, célébrer des repères et des personnages disparus, comme la hijra de chair et d’os qui a inspiré Fossette. Me fourvoyant dans mes propres dédales de Bombay/Mumbai, j’en oublie presque de poser à Jeet les questions sur le roman qui sont la raison officielle de ma venue. L’écrivain est trop bonne oreille (ou trop poli), pour ne pas inviter à la confidence : en ce point aussi, il ressemble au narrateur de Narcopolis, témoin plus qu’acteur, silencieux, phlegmatique, dont on imagine que c’est sa plume qui le retient au monde, qui combat, compense, accompagne, intègre la pipe, la fumée et le reste.
A l’instar de son narrateur, Jeet avoue ne plus être très en phase avec la ville, prétend, écoutant mon bavardage, que j’en connais davantage les anecdotes, les recoins, l’élasticité : « … nouveau venu à la rue, à Bombay, marginalisé par mon ignorance, par l’allure des affaires humaines sur les trottoirs et dans les boutiques, sachant que je n’avais pas le savoir-faire, j’avançais trop lentement, mon attention retenue par les choses qui ne comptaient pas, parce que, dans ma tête, je n’étais pas entièrement là, or cette scission, cette dispersion de l’a-moitié présent se lisait sur mon visage, les gens me regardaient et devinaient le décalage horaire, y voyant une déficience spirituelle… » Bien sûr, c’est exactement mon sentiment quand j’arpente les mêmes rues, moi le blanc – ici on dit « rose » –, l’étranger, le hors-des-castes, le traducteur qui ne parle pas la langue du cru.
 C’est pourtant la description de Mumbai, pour moi prouesse toujours inatteignable (autant que celle de l’Inde), qui m’avait convaincu de vouloir à tout prix traduire Narcopolis. Sans doute parce que Jeet exprime mieux que je pourrais le faire ma vision de la ville. Pour la première fois de ma carrière, je me suis même battu pour traduire un livre. L’une de mes éditrices habituelles perdit la bataille des droits mais, par son intermédiaire, j’ai su qui l’avait remportée. Or, il se trouve que la jeune directrice de collection qui avait rafflé la mise, me connaissant de réputation, a accepté de me confier le travail. Chaque fois qu’il paraît une traduction par un(e) autre que moi d’un livre qui a Bombay pour sujet ou toile de fond, et Ganesh sait qu’il y en a, j’ai un pincement de cœur, l’impression d’avoir râté le rickshaw. J’ai la chance, néanmoins, d’avoir au moins traduit : le premier roman de Manu Joseph, Les Savants (je suis en train de traduire son deuxième, sur des ados d’aujourd’hui amateurs de b.d. à Madras/Chennai) – le héros travaille à deux pas de mon « chez moi » bombayen et emprunte le même parcours, pour aller en ville, que je décris dans Une heure avant l’attentat, récit de mon rapport à l’Inde sur fond d’attentats de 2008 à Bombay ; les premier et second romans de Shanghvi : Les Flamants de Bombay, qui décrit mon Mumbai des élites jazzy et flashy – cela dit, La Fille qui marchait sur l’eau, quoique situé dans les années 1920, évoquait aussi, en filigrane, le Bombay actuel, tout en l’enveloppant de façades contournées et perclues de mousson, dont il ne reste presque rien aujourd’hui et encore moins depuis que les autorités municipales ont, en un après-midi, sous mes yeux médusés, rasé trois mètres de part et d’autre d’une des plus belles avenues anciennes, Nepeansee Road, démolissant un kilomètre cinq cents de portails monumentaux, grilles, murets, frontons, piliers, abreuvoirs à oiseaux, griffons, naïades et autres circonvolutions en briques, stuc et fer forgé, tous signes de la défunte grandeur parsie de Bombay, anéantis pour le bien, officiellement, de la circulation automobile et – sous-titrons – de la suprématie marathe nationaliste retrouvée.
C’est pourtant la description de Mumbai, pour moi prouesse toujours inatteignable (autant que celle de l’Inde), qui m’avait convaincu de vouloir à tout prix traduire Narcopolis. Sans doute parce que Jeet exprime mieux que je pourrais le faire ma vision de la ville. Pour la première fois de ma carrière, je me suis même battu pour traduire un livre. L’une de mes éditrices habituelles perdit la bataille des droits mais, par son intermédiaire, j’ai su qui l’avait remportée. Or, il se trouve que la jeune directrice de collection qui avait rafflé la mise, me connaissant de réputation, a accepté de me confier le travail. Chaque fois qu’il paraît une traduction par un(e) autre que moi d’un livre qui a Bombay pour sujet ou toile de fond, et Ganesh sait qu’il y en a, j’ai un pincement de cœur, l’impression d’avoir râté le rickshaw. J’ai la chance, néanmoins, d’avoir au moins traduit : le premier roman de Manu Joseph, Les Savants (je suis en train de traduire son deuxième, sur des ados d’aujourd’hui amateurs de b.d. à Madras/Chennai) – le héros travaille à deux pas de mon « chez moi » bombayen et emprunte le même parcours, pour aller en ville, que je décris dans Une heure avant l’attentat, récit de mon rapport à l’Inde sur fond d’attentats de 2008 à Bombay ; les premier et second romans de Shanghvi : Les Flamants de Bombay, qui décrit mon Mumbai des élites jazzy et flashy – cela dit, La Fille qui marchait sur l’eau, quoique situé dans les années 1920, évoquait aussi, en filigrane, le Bombay actuel, tout en l’enveloppant de façades contournées et perclues de mousson, dont il ne reste presque rien aujourd’hui et encore moins depuis que les autorités municipales ont, en un après-midi, sous mes yeux médusés, rasé trois mètres de part et d’autre d’une des plus belles avenues anciennes, Nepeansee Road, démolissant un kilomètre cinq cents de portails monumentaux, grilles, murets, frontons, piliers, abreuvoirs à oiseaux, griffons, naïades et autres circonvolutions en briques, stuc et fer forgé, tous signes de la défunte grandeur parsie de Bombay, anéantis pour le bien, officiellement, de la circulation automobile et – sous-titrons – de la suprématie marathe nationaliste retrouvée.
De Bombay, dans Narcopolis, c’est un autre quartier, un autre courant qui sont saisis, un esprit et des réalités peut-être plus ténus, plus difficiles à cerner, ce que l’auteur voit comme la partie secrète de l’histoire de la cité. On s’approcherait davantage de Maximum City ou de Shantaram si cet essai et ce roman, respectivement, ne professaient une approche plus rude, plus violente et plus mafieuse encore de la ville, version/vision à laquelle j’adhère moins, peut-être par crainte de la voir, et que j’aurais eu plus de mal à traduire.
Le Bombay de Narcopolis, c’est, par opposition au binôme autocélébratoire de la ville, argent et glamour, image de marque de Mumbai aujourd’hui, mais aussi à son inverse, la version hyperviolente et glauque, ce qui se passe, ou plutôt se passait, à Shuklaji Street, du temps de mes premiers voyages en Inde (pré- la grande métamorphose qui a commencé vers 1995 et s’est amplifiée depuis, au point de tout raser sur son passage, à la chinoise, ni plus ni moins). Shuklaji Street est l’un des cœurs populaires de Bombay, le quartier chaud, lui-même en voie de disparition – tout autant qu’a vécu la rue du Canon, quartier à matelots, chez moi, à Toulon –, une longue rue où l’on passe entre des rangées de maisons de passe ; ce que j’en voyais, moi, en m’y retrouvant par hasard lors de mes pérégrinations, ayant tourné par erreur à gauche plutôt qu’à droite ou vice versa, et en ne demandant pas mon reste, c’étaient des barraques en bois pas très  hautes, vétustes, pourvues de balcons ou de fenêtres auxquels étaient accoudées les prostituées à la vulgarité plus que fellinienne, quand, moins chères, elles ne se déhanchaient pas au rez-de-chaussée, encore plus baveusement fardées, telles des actrices de troupes ambulantes, représentant des déesses au verbe cru et perlées de sueur, offrant une image outrée de l’agressivité enjoleuse des poissonnières de Sassoon Dock. J’ignorais que mes congénères, à l’époque de la fine fleur de la queue du phénomène hippie, allaient fumer l’opium dans le quartier.
hautes, vétustes, pourvues de balcons ou de fenêtres auxquels étaient accoudées les prostituées à la vulgarité plus que fellinienne, quand, moins chères, elles ne se déhanchaient pas au rez-de-chaussée, encore plus baveusement fardées, telles des actrices de troupes ambulantes, représentant des déesses au verbe cru et perlées de sueur, offrant une image outrée de l’agressivité enjoleuse des poissonnières de Sassoon Dock. J’ignorais que mes congénères, à l’époque de la fine fleur de la queue du phénomène hippie, allaient fumer l’opium dans le quartier.
Pour Jeet (comme pour Ashim Ahluwalia, dont le film Miss Lovely, présenté à Cannes en 2012, à la Semaine des réalisateurs, évoque l’univers du cinéma X dans le Bombay des années quatre-vingt), il s’agit bien de mettre en lumière un autre binôme, nerf de la guerre bombayenne : sexe et drogue. Mais il s’agit aussi, peut-être surtout, de quête d’identité et, en cela, le choix d’un personnage transgenre est, forcément, exemplaire.
Je prétends souvent que, romans et traductions étant d’abord affaire de mots, il n’est pas besoin de pratiquer tel ou tel sujet pour bien le traduire. C’est des mots eux-mêmes, en traduisant, que surgissent la connaissance et la solution aux problèmes de traductologie. Mais j’étais rassuré, pour Narcopolis, d’au moins maîtriser le lieu et le temps, puisque je pâtissais tout de même d’un handicap, un manque de connaissance générale sur le sujet de la drogue. Le lexique, à la fin de la traduction française publiée aux éditions de l’Olivier, aide le lecteur/lectrice à démêler les arcanes du business, mais il fut d’abord mon garde-fou, ma façon de m’y reconnaître entre garad, nasha, white paste, od ou khana… Contrepoint ou complément de la drogue, la cuisine, un domaine dans lequel je suis plus expérimenté, occupe une bonne place dans ce lexique, comme elle le ferait, d’ailleurs, dans tout roman indien qui se respecte, entre roti et tandoori roti, l’un cuit au tandoor, l’autre pas, dit aussi rotla, au Gujarat, Etat indien au nord du Maharashtra, dont la cuisine blanche fascine les auteurs indiens (Shanghvi vous en sert même dans sa demeure face au bungalow de la superstar Amitabh Bachchan, mentionné dans Narcopolis comme icône incontournable des jeunes mâles indiens des années 70) ; la nourriture gujarati se distingue, entre mille autres mets, par ses tepla et son undhyu, spécialité aux légumes plutôt ardue à réussir et dont il ne faut pas confondre le nom avec undu(gundu), terme péjoratif utilisé à Bombay pour désigner les gens du sud.
Et puis, Jeet Thayil fait référence au vocabulaire de la castration (nirvan, « mot empreint de spiritualité pour une pratique atroce », me confia-t-il) orchestrée par la daima ; et pourquoi faut-il encore que hijra (pas facile à traduire, et la version anglaise locale, eunuch, n’aide en rien, ne recouvrant pas vraiment l’« eunuque » français, pas plus que « castrat » ou « trans »), pourquoi faut-il que hijra, donc, soit affublé d’une variante, hijda ? Confronté à tant de multiplicité, qui finit par rimer avec duplicité, (demandez à tout homme d’affaires occidental amené à traiter avec un homologue indien – les différences et la revanche culturelles ont parfois bon dos), le traducteur a envie de crier chooth ! – mais encore lui faut-il savoir si on va comprendre « con » ou « trou du cul », car le mot signifie les deux, et bénéficie lui aussi, qui l’eût cru, d’une variante, chootiya.
Oui, tout comme les mumbayites vénèrent et exècrent à la fois les hijra, j’aime et je déteste Bombay. Qui est las de Bombay est las de la mort. Or ce qui fait que je respire bien dans Narcopolis, ce n’est pas mon accoutumance à l’opium, son sujet de façade, pour lequel mes sources furent modestement Le Lotus bleu puis Jules Boissière avant De Quincey et Burroughs. Je suis certain que nombre de lecteurs/lectrices pourront apprécier à leur juste titre et l’évocation et la réflexion sur la thématique. Mais ce qui me transporte dans ce roman, c’est la transcription, à travers un bel art du/des récit/s, des personnages et de leur errance mentale et physique, d’une autre fumée, peut-être celle de la pollution, la dickensienne épaisseur de l’air des quartiers congestionnés – et c’est la congestion affective qui m’intéresse – de l’intérieur de la ville, de son ventre sinon de ses bas-fonds, dès qu’on s’éloigne du front de mer à Worli ou de la plage de Chowpatty, qu’affectionnent (à l’instar des personnages de Shangvhi, car c’est là qu’on va, dans la vraie vie comme dans la fictive,  immanquablement, depuis le centre-ville étouffant, prendre face à la mer d’Oman une bolée du peu d’air disponible) Fossette, maîtresse des genres, mâle et femelle comme Nataraj, le Siva dansant, ou Bombay/Mumbai, et M. Lee, maître opiomane, référence mythique, quasi mythologique, dans le roman, y vont en taxi boire un milkshake à Rajasthan Lassi (hélas pas à la sapotille car elle n’est pas en saison) puis déguster un kulfi à la pistache au Cream Centre –moi, je préférais les glaces et sorbets, notamment gingembre et piment, de chez Bachelorr’s, tout à côté, jusqu’à ce que, récemment, le glacier qui, à Charni Road, sert ses clients sur le trottoir, voire dans leur voiture, cédant aux changements de modes de comportement et à la perte de goût des nouveaux mumbayites, se lance dans la restauration rapide sur le pouce, avec une baisse concomittante de la qualité de ses glaces maison.
immanquablement, depuis le centre-ville étouffant, prendre face à la mer d’Oman une bolée du peu d’air disponible) Fossette, maîtresse des genres, mâle et femelle comme Nataraj, le Siva dansant, ou Bombay/Mumbai, et M. Lee, maître opiomane, référence mythique, quasi mythologique, dans le roman, y vont en taxi boire un milkshake à Rajasthan Lassi (hélas pas à la sapotille car elle n’est pas en saison) puis déguster un kulfi à la pistache au Cream Centre –moi, je préférais les glaces et sorbets, notamment gingembre et piment, de chez Bachelorr’s, tout à côté, jusqu’à ce que, récemment, le glacier qui, à Charni Road, sert ses clients sur le trottoir, voire dans leur voiture, cédant aux changements de modes de comportement et à la perte de goût des nouveaux mumbayites, se lance dans la restauration rapide sur le pouce, avec une baisse concomittante de la qualité de ses glaces maison.
J’avais cru comprendre, lors de notre entretien, que M. Lee, dont un chapitre de Narcopolis nous conte la fuite de la Chine communiste, serait la pierre angulaire d’une trilogie dont Narcopolis aurait été le premier tome, une histoire de Bombay à travers celle des drogues. Car c’est de Bombay que la sanglante Compagnie des Indes, raconte Jeet (en off, aux journalistes, pas dans le livre), envoyait l’opium en Chine, et se dessine alors une généalogie secrète de la fortune de la ville, que la majorité préfère oublier, mettant en avant soit les filatures, aujourd’hui détruites elles aussi et reconstruites en centres commerciaux, soit, plus récemment, le boom économique assorti d’une supposée résilience face à tous les maux. Une vaste saga, donc ? (Tiens, on vient de m’en proposer une, par Kalyan Ray, le mari de la réalisatrice Aparna Sen, mais celle-là a plus à voir avec Calcutta/Kolkota, comme l’âpre et délicieux 36 Chowringhee Lane de son épouse). Dans notre dernier échange de courriels, suscité par ces quelques réflexions à propos de notre entrevue, Jeet m’écrit que, non, il n’y aura pas de trilogie, mais qu’il planche sur son prochain roman, oui, lentement car il voyage trop (j’ai lu de lui, il est vrai, il y a quelques mois, un article pour un magazine de voyage chic sur la Buddhist Trail dans le nord-est du pays) ; le personnage de Narcopolis qui s’y retrouve n’est finalement pas Lee, mais le peintre Newton Xavier, figure provocatrice et alcoolisée, non pas tourné vers l’est et le passé mais vers l’ouest et, qui sait, l’avenir de la peinture indienne, vaste programme, et quoi d’autre ?
On attend avec impatience de voir à quelles nouvelles frasques il va s’adonner pour faire avancer la question du post-colonialisme non encore résolue, semblerait-il, dans le domaine de la pensée et des arts, littérature comprise, alors qu’elle ne l’est que trop sur les plans économique et idéologique.
BERNARD TURLE
(« Portraits de Bernard Turle et de Jeet Thayil » photos D.R. ; « Bombay/Mumbai » photos Passou)
Jeet Thayil
Narcopolis
traduit de l’anglais par Bernard Turle,
304 pages, 22 euros
éditions de l’Olivier
12 Réponses pour Digressions à l’indienne avec Jeet Thayil
« J’ignorais que mes congénères, à l’époque de la fine fleur de la queue du phénomène hippie, allaient fumer l’opium dans le quartier. »
La queue du phénomène … !
Jeet Thayil est poète, peu conforme aux clichés occidentaux, et s’exprimant en anglais, parfait ?
Il faut le montrer entendre, alors.
http://vimeo.com/44085197
plutocrate
mais pas toutafé..
M. Lee, maître opiomane
..mort y peut pus t’en coller une..alors on la ramène..c’est petit
Nul doute que cette description donne envie de lire Narcopolis, version d’un Mumbaï noir dans ses dédales d’opium et de sexualités troublantes. L’envers du décor de la ville sans cesse modifiée,dans son émergence occidentalisée,où comme le disent, l’écrivent Bernard Turle et l’auteur du livre, Jeet Thayil, il faut désormais une sorte de devoir de mémoire pour aborder l’Inde nouvelle. Dans une errance poétique qu’il nous tarde de connaître.
mais le peintre Newton Xavier, figure provocatrice et alcoolisée
il a copié sergio..ça se sent
il y a la queue de la mousson, il y a eu la queue du phénomène hippie, ces années-là, où ça s’est brouillé, ce n’était déjà plus la grosse vague et pas encore retour à la normale, les dérives étaient de plus en plus individuelles
Auteurs pakistanais(e)s, je veux bien, mais Bangladesh(i)s…? A part Tamina Anam, assez faible quoique fortement aidée en écriture par papa Mafhuz, qui règne en zamindar sur la presse anglophone ici, et Shazia Omar qui, elle, a un vrai talent et fait partie d’un collectif d’écrivains assez décoiffant (The Writers’Block)vous voulez parler de qui?
Pours les afficionados des lettres d’Aise du Sud, il est encore temps de se rendre au Hay Festival de Dhaka le 14,16 & 16 novembre prochain et y rencontrer du beau monde (N.Aslam, T.Ali, etc etc…)et vivre un moment exceptionnel.
Jamu
« de l’entreglosage », disait Montaigne, qui était poli:
« Qui est las de Bombay est las de la mort » plus haut rappelle furieusement (mais c’est certainement une coïncidence) le » when a man is tired of London, he is tired of life » du bon Dr Johnson.
« Pour paraphraser » est pourtant une belle et noble modalisation.
Que des clichés, ces photos.
L’auteur de l’article parle beaucoup mais connait peu, comme disent les Marmas des CHT.
チャンルー キムタク ローレックス 時計 http://www.qf95.com/
カバン メンズ
deux ans déjà, j’aurais dû regarder les commentaires il y a longtemps mais je ne pensais pas qu’il y en aurait
jamuna, comme j’ai toujours à coeur de parfaire ma connaissance, j’aimerais savoir ce que vous entendez par « ne connaît pas » ; parmi mes nombreuses lacunes, il y a, bien sûr, une vision globale de la littérature de l’Aise du Sud : je ne suis qu’un praticien, je passe tout mon temps à traduire et il en reste peu pour avoir une approche critique de la chose
Leo Bloom Pold Londres a été ma première métropole de coeur, remplacée par Bombay plus tard, donc, oui, la banale référence est voulue
pour ce qui est de la queue du phénomène hippie, oui, oui, je maintiens, pour moi la queue de la mousson et la queue dudit phénomène se mêlent très harmonieusement dans le paysage indien de 1975


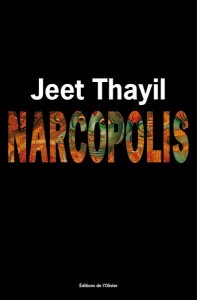
12
commentaires