
La coupe à ras bord
 Quelques remarques négligées sur ma récente version de « The Golden Bowl »
Quelques remarques négligées sur ma récente version de « The Golden Bowl »
Un des tout premiers articles de critique littéraire de Virginia Woolf, publié le 22 février 1905 dans The Guardian, traite de Mr. Henry James’s latest novel, autrement dit The Golden Bowl, paru en novembre 1904, chez Scribner en Amérique, et Methuen en Angleterre. Virginia alors encore Stephen venait d’avoir vingt-trois ans. Elle formule avec fermeté ce qu’elle doit comme éloges, en introduction et conclusion :
« Dans les 550 pages de son dernier livre, il n’en est aucune, nous pouvons l’affirmer, qui porte les traces de la hâte ou de la négligence ; il n’en est aucune qui ne fasse pas réfléchir ; aucune qui ne présente pas un exquis bonheur d’expression et de pensée digne à lui seul d’illuminer un chapitre entier d’un roman ordinaire » ; et puis, donc : « Il n’y a aucun romancier vivant dont le critère soit aussi élevé, ou dont le talent soit si constamment grand. »
Mais tout cela, c’est comme par acquit de conscience, pour aimablement encadrer le cœur de son impression, et le fond de sa pensée :
« Les 550 pages de La Coupe d’or se consacrent à montrer comment quatre personnages affrontent certaine difficulté naturelle qui surgit fréquemment en-dehors des romans de Mr. James, mais qui ne saurait guère ailleurs, on peut l’imaginer, produire une telle quantité de réflexion, d’analyse et de pinaillage. […] Malgré toute l’adresse et le soin qui leur sont prodigués, les acteurs ne restent qu’autant de fantômes distingués. […] Mr. James se tourmente et tourmente ses lecteurs dans son effort ardu pour dire tout ce qu’il y a à dire. »
Soit, commenterons-nous : il y a bien du vrai là-dedans, surtout ainsi rédigé.
Une trentaine d’années plus tard, dans son autobiographie, A Backward Glance (Les Chemins parcourus), où elle dédie d’importants passages à son amitié (honneur de sa vie, note-t-elle) avec Henry James, Edith Wharton, septuagénaire, énonce quelques remarques nécessairement moins juvéniles, et plus récapitulatives, mais somme toute similaires :
« Ses derniers romans, malgré toute leur profonde beauté morale, me paraissaient manquer de plus en plus d’atmosphère, être de plus en plus détachés de cet air épais et nourrissant où nous évoluons et vivons tous […] Les personnages y semblent isolés dans une sorte de tube de Crookes pour que nous les examinions. […] Il s’agit, selon moi, de magnifiques projets de roman, plutôt que des romans achevés. »
Soit, répéterons-nous : il y a bien du vrai là-dedans, surtout dans « profonde beauté morale », et dans « projets de roman ».
Arrêtons-nous sur « profonde beauté morale ». The Golden Bowl traite d’un phénomène moral démoniaque : la possession ; ou, si l’on préfère, la possessivité ; c’est-à-dire, le sentiment qu’éprouve un être humain d’être propriétaire d’un autre être humain ; et, de ce sentiment de possessivité, le propriétaire, le possesseur, se trouve possédé, comme par un démon ; le possédé n’est pas celui que le vocabulaire indique en surface ; il y a une réalité plus profonde de la possession, et toute la beauté morale du roman vient de ce qu’il la met en scène, et donc la révèle ; le possédé n’est pas le Prince Amerigo, pourtant acheté, en apparence comme en réalité, par le collectionneur millionnaire américain Adam Verver, pour sa fille unique Maggie, comme le plus coûteux des objets d’art de la vieille Europe ; la véritable possédée, c’est Maggie : possédée par sa possessivité à l’égard d’Amerigo, possédée par sa volonté de ne pas être dépossédée de sa volonté de possession, et, pour cela, de ne pas manifester, ni même éprouver, de la jalousie sexuelle, alors qu’un hasard parfaitement romanesque l’a mise en possession de la preuve métaphorique (la « coupe d’or », justement, qui est un objet de cristal doré, et fêlé, comme l’est leur double mariage) que son récent mari Amerigo, et son amie de toujours Charlotte Stant, devenue épouse de son père, ont été naguère, à Rome, et puis, après leurs mariages respectifs, ont recommencé d’être, en Angleterre, amants.
À l’origine, pourtant, la possessivité de Maggie s’appliquait plutôt à son père. C’est du reste la raison pour laquelle elle l’incite à épouser sa compagne d’enfance Charlotte : pour le garder sous la main, pour que tout continue de se passer en famille, incestueusement, endogamiquement. « Incestueusement », car, bien entendu, couchant avec Charlotte, Adam couche analogiquement avec Maggie. Et, d’une certaine manière, un peu plus analogique encore, Adam, à travers Maggie, couche avec sa très coûteuse acquisition Amerigo. Mais, donc, analogie pour analogie, la possessivité de Maggie finit par se concentrer, analogiquement, tout entière sur Amerigo. Et la profonde beauté, qui est une profonde vérité, morale de l’histoire, c’est que la victoire de Maggie ne peut se produire que par le moyen de sa défaite. Sa victoire, c’est d’éloigner Charlotte d’Amerigo. Sa défaite, c’est de ne pouvoir obtenir cela qu’au prix de l’éloignement de son père adoré à « American City » (la banalité générique de ce nom de ville fictive peut laisser perplexe, mais il fait pendant au prénom générique d’Amerigo, supposé descendant direct d’Amerigo Vespucci), elle-même, Maggie, restant conjugalement à Londres. L’équivoque est d’autant plus profondément réelle et véridique, que Charlotte, par orgueil, et par panique, aussi, par désespoir consenti, présente la chose comme une victoire personnelle : posséder enfin son propre mari, Adam Verver, pour elle seule, en partant avec lui loin de Maggie, alors que c’est en réalité pour elle, Charlotte Stant, une double et atroce défaite, être séparée d’Amerigo, et aller vivre dans cette terre de cauchemar à ses yeux qu’est l’Amérique.
Si je puis avouer un sentiment intime, je dirais que Maggie Verver, « pauvre petite fille riche » manipulatrice des sentiments d’autrui, et avant tout de ses propres sentiments, me fait horreur ; et puis que je ne suis pas loin de supposer qu’elle fait horreur à son auteur même. Elle possède le moyen technique de la Possessivité, qui est la maîtrise de l’Espace. Riche, elle possède maison et château (même s’ils sont acquis par les millions de son père), et elle peut y enfermer Amerigo, et d’ailleurs aussi Charlotte, avec toutes les périlleuses équivoques que cela comporte : mais ces périls adultères restent sous sa domination, puisqu’elle a décidé de les héberger. Toutefois, le Temps échappe aux techniques de la Possession et de la Possessivité.
Or c’est ici que je trouve Charlotte Stant admirable, tout en n’étant pas loin non plus de supposer que son auteur même l’estime ici admirable. Charlotte sait qu’elle ne peut posséder Amerigo, intemporellement, éternellement, que dans un fugitif Repli du Temps, pour une ou deux heures de sexe et d’amour, l’après-midi, dans une chambre d’auberge de Gloucester, qu’elle a pris l’initiative de réserver, en s’assurant de la compatibilité des horaires de trains locaux. Amerigo la suit, étant la passivité même. Étant la passivité même, il laissera partir Charlotte à American City, et, tout ému et empli d’amour conjugal, contrit, repenti et reconnaissant, il restera en Angleterre avec son épouse Maggie. J’ai dit que je trouvais horrible Maggie, et admirable Charlotte ; je dis maintenant que je trouve Amerigo pitoyable comme tout malheureux dont l’identité d’« homme à femmes » est de faire commerce de sa capacité d’être un objet de convoitise sexuelle pour lesdites femmes.
C’est une particularité, il faut le préciser, dans la totalité de l’œuvre de Henry James. Si jamais, ce qui est très rare, on y trouve des scènes de trouble sexuel, ce trouble est ressenti par une femme en présence d’un homme. Or c’est peut-être dans The Golden Bowl que l’auteur s’est le plus efforcé à mettre en scène un tel trouble : trouble de Maggie, durant certain retour nocturne en fiacre, dont le bellâtre Amerigo s’emploie à profiter avec tout son magnétisme physique, et contre lequel elle-même s’emploie à se défendre dans un effort intime déprimé et déprimant.
Mais la splendide Charlotte n’a pas à s’en défendre, car elle possède sur Amerigo un puissant pouvoir sexuel contre lequel lui-même ne se défend pas. Amerigo se laisse guider par Charlotte, car il est sexuellement amoureux d’elle dans la mesure où elle est sexuellement amoureuse de lui : jusqu’au moment où Charlotte décide, ou bien se figure décider (alors qu’elle est manipulée par Maggie), de baisser les bras avec Amerigo ; et donc, tardivement, après coup (après le coup de l’auberge de Gloucester avec Charlotte, bien qu’il ait déjà engendré un « Principino » selon les obligations reproductives de son mariage), il se soumet à l’idée d’être finalement amoureux de Maggie, ainsi que Maggie l’a finalement décidé pour lui.
Et maintenant considérons le concept de « projet de roman, au lieu de roman achevé ». Je me trompe peut-être, mais je crois me souvenir d’avoir lu quelque part que Pierre Boulez a déclaré qu’Hector Berlioz avait composé, non pas de la musique, mais des projets, ou des rêves, de musique. Soit. « Il y a bien du vrai là-dedans ». Car, n’était-ce pas, dans le texte, dans la partition, exactement calculé pour cela : calculé, non pas pour construire une muraille monumentale qui impose sa compacité présente, mais pour indiquer, pour ouvrir, dans le ciel de l’avenir, une direction où s’épanouissent tous les possibles ? Le projet, l’avenir, du roman est très précisément nommé à l’intérieur même de The Golden Bowl : il a pour nom Fanny Assingham.
Je vais ici en finir tout de suite avec le triple calembour obscène que des lecteurs anglophones ou américanophones ont vite décelé dans le nom de ce remarquable personnage : « Fanny », dans l’argot anglais, illustré par le roman érotique classique de John Cleland, Memoirs of a Woman of Pleasure (« popularly known as » Fanny Hill), c’est le sexe féminin, la « chatte », si l’on veut ; « ass », ce n’est même pas de l’argot, c’est du langage courant, c’est le cul ; « ham », c’est de l’argot gentillet, c’est le derrière.
Pourquoi diable avoir pour ainsi dire physiologiquement hyper-féminisé l’initiatrice de toute la situation (dont l’infiniment savoureuse description physique se lit pp 50-51 de ma traduction) ? Eh bien, Fanny est la commentatrice qui a fait se rencontrer, à Rome, Maggie et Amerigo, et qui donc a déclenché leur mariage. En même temps, c’est celle qui est au courant de l’ancienne liaison d’Amerigo et de Charlotte, et qui par conséquent est épouvantée quand Charlotte épouse le père de Maggie, car elle redoute qu’on la rende responsable et coupable de ce quatuor scabreux et quasiment échangiste. Or, le responsable et coupable, c’est évidemment l’auteur même, Henry James, qui a imaginé tout cela, et comment le raconter.
L’auteur, Henry James, ne pouvait imaginer ce quatuor effroyablement scabreux qu’au moyen de la part féminine en lui, la part qui, en lui, observe et imagine et commente et reconstitue en profondeur, à l’infini, ad nauseam, « à ras bord », les amours d’autrui. Cette part féminine et créative en lui, il la considère, comme romancier, avec un humour grandiose, et grandiose en effet est Fanny Assingham. Fanny possède un mari adorable, le colonel Bob, qui l’écoute avec patience, fascination, lassitude, tendresse, et ironie ; Bob est la part masculine de James, qui encourage sa part féminine, en lui laissant entendre :
« Vas-y, déchaîne ton étonnante imagination viscérale, car, moi, dans mes propres viscères, je n’en ai aucune d’une force semblable, et donc je reste ici, tranquillement, amoureusement, à côté de toi, en frisant ma moustache, pour stimuler et solidifier tes réjouissants délires d’interprétation ».
Le projet de The Golden Bowl est ainsi inclus dans The Golden Bowl même : on le décèle dans les « exaspérantes » (selon Edith Wharton), mais géniales (selon moi, et quelques autres depuis 1904), conversations de Bob et Fanny Assingham, véritable « roman dans le roman », précurseur de tout un avenir pour le XXème siècle, et suivant.
P.S. Deux extraits de lettres de Henry James au traducteur français Auguste Monod :
17 décembre 1905:
« J’imaginais en général que je n’étais pas particulièrement facile à traduire, car le fait de posséder à un degré quelconque sa propre forme et sa propre couleur oppose toujours un obstacle à autre chose qu’un rendu très approximatif dans une autre langue, et cette autre langue peut même interdire que l’approximation soit suffisante ! Mais manifestement je suis dans l’étrange et malheureuse position de défier complètement le génie de la langue française, moi qui adore ce génie, et qui passe dans notre fumeux pays pour un galliciste débridé. »
7 septembre 1913 :
« Comme je sens que dans une œuvre littéraire de la moindre complexité, la forme et la texture sont la substance même et que la chair est indétachable des os ! La traduction est un effort — même s’il est très flatteur ! — pour arracher la chair infortunée, et en fait pour en sacrifier une telle quantité que la chose vivante saigne et se meurt. »
(« Jean Pavans et Henry James » photos D.R.)
Henry James
La Coupe d’or
traduit de l’anglais par Jean Pavans,
704 pages, 25 euros,
Seuil
12 Réponses pour La coupe à ras bord
bonjour Monsieur.
si vous me permettez des souvenirs de la vie de personnes « réelles », dont moi-même qui ai vendu plus de mémoires de Fanny lorsque je travaillais dans une librairie à côté de l’American express, parce que je devais tenir ce rayon où se précipitaient les américains à peine de descendus du car,que de H.James que j’aimais déjà lire – c’était l’année du bac- j’ai connu une femme dont le prénom était fanny : elle n’était pas née française, ne savait pas du tout l’anglais ,lisait assez peu , et à la mort de son mari de prénom albert, elle se renomma alfanny , manière de se retrouver la première, l’alpha, et de posséder seule son « al »que je n’ai pas connu,et d’anticiper des difficultés de traduction
je crois me souvenir d’avoir lu quelque part que Pierre Boulez a déclaré qu’Hector Berlioz avait composé, non pas de la musique, mais des projets, ou des rêves, de musique.
======
Ce snob de Boulez aggrave encore son cas – contempteur imbécile du jazz, le voilà qui débine notre Hector de la Symphonie Fantastique nationale. Le maître est bien marteau. Et hop, encore une boulez…
Bravo pour votre article, M. Pavans, je vous admire d’avoir lutté et visiblement gagné votre combat avec l’ange de la prose jamesienne, dont le moins qu’on puisse dire, est qu’elle est souvent inutilement ampoulée et précieuse, comme qui dirait « convoluted », « involved ».
Ma connaissance de James se limite aux nouvelles et à The Bostonians/Les Bostoniennes, roman que j’ai beaucoup apprécié la seconde fois que je l’ai lu pour un concours. Et il me semble que dans ce livre qui se moque les bas-bleus, il est aussi question de possessivité et de possession, de territoire et d’appropriation de l’autre. Olive Chancellor, Verena Tarrant & Basil Ransom….what’s in a name, n’est-ce pas?
Allez, c’est décidé, j’emporte « The Ambassadors » pour tuer le temps et la mauvaise littérature lors de mon prochain aller-retour Asie-Europe. Ce sera de votre faute.
le nom Verver me semble bien intéressant, au moins d’être double!
Jean, il faut savoir que, quand Urucu dit « c’était l’année du bac », il veut dire 1954. Son hors-sujet délirant du 11 septembre à 15 h 47 s’explique par la sénilité. Il ne faut pas lui en vouloir.
décortiqueur, cessez de provoquer !peut-être êtes -vous assez intime avec JEAN PAVANS pour l’appeler par son prénom : pas moi . de même d’ailleurs ne nommerais-je aucun auteur par on prénom-ainsi victor pour Hugo , là où les erdéliens y vont du totor : c’est on snobisme que je ne supporte pas .
précision: c’est dans une ancienne traduction de James que j’ai commencé à trouver des traductions insoutenables et par la suite commencé à suivre l’intérêt que les critiques prenaient aux traductions puis aux traducteurs: de quoi je me réjouis .
c’est un snobisme
n’en déplaise à décortiqueur, j’apprécie les remarques « sur la traduction de winnicot » de Gribinski dans Winnicot ou le choix de la solitude de A Phillips où il explique pourquoi il a rendu erotic par libidinal
effet immédiat de votre article : relire le livre d’Adam Philipps sur Winnicott « ou le choix de la solitude »
il y rapporte que D.W.chirurgien pendant la grande guerre sur un destroyersemble , aux dires de sa femme, aoir eu « beaucoup de temps libre qu’il semble avoir employé à lire les romans de Henry James »
ce que je n’eus jamais fait autrefois: je viens de relire une préface de Borgès dans laquelle il évoque deux photographie inoubliables de James réalisées en 1906 et les décrit avec ce qu’il en suppose de la participation de H.James lui-même : « ce jeu de l’homme vu par les autres , de l’homme vu par lui-même (James « le plus malheureux des hommes »)
vous connaissez n’est-ce pas ce texte ?
alors ‘ voir »
Peut etre que parler d’ Opéras revés, de Faust aux Troyens, aurait été plus juste. Il a fallu le Disque et ses effets sonores pour donner toute son ampleur aux intentions de Berlioz. Puis la scène à suivi. C’est vrai pour la trilogie Benvenuto, Troyens, Béatrice. Ici un grand merci s’impose à feu Colin Davis.
Je souhaite à Pierre « Boulet » la meme notoriété dans un siècle, mais j’en doute…
MC
Merci
La coupe à ras bord
Je viens de relire La coupe d’or – – avec toujours autant de ténacité et de difficulté … édition Robert Laffont, traduction qui n’est pas la votre + des fautes d’orthographe de ci-de là dans le texte.
Bien qu’à l’évidence, je l’aime et qu’il me fascine, j’ai toujours trouvé ce roman bien difficile à lire … je n’ose donc imaginé ce qu’il est à traduire …
Je suis en accord avec votre vision du couple « incestuel » que forment Maggie et son père. Je ne suis pas aussi sévère que vous vis à vis de Maggie qui certes achète et possède avec son père le Prince et Charlotte dans un but mondain, décoratif, esthétique – – pour parachever un projet à savoir la collection d’oeuvres d’art d’Adam Verver en quelque sorte par qeulques prolongements humains « de choix » si l’on peut dire – – mais aussi est une jeune femme qui se rend compte progressivement qu’elle aime son mari et entend le garder auprès d’elle. n’est-elle pas l’épouse légitime après tout ? Henry James nous montre Maggie en train de se « banaliser », en train d’accepter le cycle des rites de passage : rompre avec le père, s’en affranchir, s’en éloigner, accepter l’époux, lui donner sa place d’amant et de père.
Sauf que … pour quitter le père et le cocon disons monstrueux car teinté d’inceste qu’elle a toujours connu, Maggie se fait encore monstrueuse. au détriment de notre belle Charlotte.
Je dis « notre ». car comment Charlotte ne peut-elle pas etre « notre » ? A chaque relecture, je reste pétrifiée et presque glacée quand tout à coup, dans ce roman si alambiqué, si distingué, si elliptique, si empli de non-dits survient avec brutalité le « dit ». Et Il touche Charlotte. Charlotte et sa corde au cou. Charlotte et son licol. Charlotte en souffrance, à la fin, littéralement menée comme animal.
Une image très violente qui me fait à chaque fois venir les larmes aux yeux tant elle est insupportable.
En tout cas, merci pour ce billet. Quoique la sachant pleine de potentiels, je n’avais pas été jusqu’à imaginer Fanny Assingham en tant que double de l’auteur. La piste est intéressante. Elle donne à voir le livre en train de se faire (ou de faussement se faire, c’est selon …). une mise en scène de l’écrivain.
A défaut d’avoir relu le livre dans votre traduction, au moins ma lecture s’est-elle enrichie, par votre commentaire, d’un élément nouveau.
Cordialement,


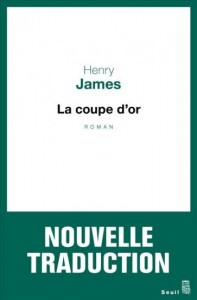
12
commentaires