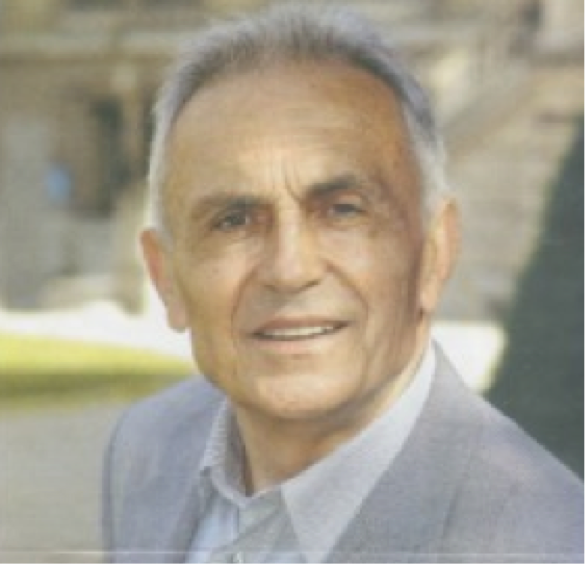
Un titre problématique de Giraudoux
 Les traducteurs ont souvent reculé devant le titre de la pièce de Jean Giraudoux La guerre de Troie n’aura pas lieu (ici en Pdf). Annette Kolb a préféré Kein Krieg in Troja (Pas de guerre à Troie), Christopher Fry Tiger at the Gates (Tigre aux portes de la ville), et même si l’on est revenu à des traductions littérales, ce titre n’a jamais été plagié par les journalistes anglais ou allemands comme en France, faute d’avoir trouvé semblable euphonie, semblable cadence (La guerr’ de Troie n’aura pas lieu, soit un octosyllabe de quatre ïambes). La formule semble gravée dans le marbre. Elle a fait florès dans la presse française, elle reparaît quotidiennement, pour la guerre des Trois ou de Troyes, pour la guerre du Golfe et la guerre d’Ukraine, pour toutes les rivalités du commerce ou de la politique et même en tête d’une double page des Nouvelles littéraires signée René Marill Albérès : « La mort de Giraudoux n’aura pas lieu ».
Les traducteurs ont souvent reculé devant le titre de la pièce de Jean Giraudoux La guerre de Troie n’aura pas lieu (ici en Pdf). Annette Kolb a préféré Kein Krieg in Troja (Pas de guerre à Troie), Christopher Fry Tiger at the Gates (Tigre aux portes de la ville), et même si l’on est revenu à des traductions littérales, ce titre n’a jamais été plagié par les journalistes anglais ou allemands comme en France, faute d’avoir trouvé semblable euphonie, semblable cadence (La guerr’ de Troie n’aura pas lieu, soit un octosyllabe de quatre ïambes). La formule semble gravée dans le marbre. Elle a fait florès dans la presse française, elle reparaît quotidiennement, pour la guerre des Trois ou de Troyes, pour la guerre du Golfe et la guerre d’Ukraine, pour toutes les rivalités du commerce ou de la politique et même en tête d’une double page des Nouvelles littéraires signée René Marill Albérès : « La mort de Giraudoux n’aura pas lieu ».
Gage d’éternité ? Ce titre, à peine trouvé, posa problème. D’abord parce qu’il est trop long, et Giraudoux et Jouvet entre eux disent La Guerre de Troie, et mieux : Troie. Trop long aussi pour les usages du temps, et pour la mise en page : renvoyé à la ligne suivante sur l’affiche du théâtre, « n’aura pas lieu » peut signifier « Relâche » ! Le premier manuscrit soumis à Jouvet propose deux titres en balance: « Prélude des préludes » et « Préface à l’Iliade », qui à l’automne se réduisent à « Prélude ». « J’ai voulu faire une modeste post-préface à l’Iliade », dit-il aussi.
Comme d’un simple gland peut sortir un grand chêne, chacun de ces titres contient toute la pièce. « Prélude », « préface », ou verbe au futur (n’aura pas lieu), dans tous les cas l’action se situe dans la première des avant-guerres, et du coup le dénouement est lui aussi « donné », ou bien tragique ou bien ironiquement heureux. Giraudoux a hésité, ses manuscrits le prouvent, et finalement il a conservé les deux fins. Au milieu de la scène dernière, « La guerre n’aura pas lieu, Andromaque !» clame Hector, mais par un bel effet de théâtre, le rideau qui avait commencé de tomber se relève peu à peu : « Elle aura lieu » et le rideau tombe définitivement. « La parole est au poète grec » (II, xiv, p. 551).
En somme, en découpant dans cet avant-guerre de Troie un espace de liberté et de création, Giraudoux inscrivait aussi, au-dessus de ses personnages, un fatum : « C’était écrit »… dans Homère. Rien à voir avec le Destin qui régnait dans l’Antiquité au-dessus des dieux eux-mêmes, lesquels d’ailleurs se contredisent comme de vulgaires humains. Aucune transcendance dans cette idée du destin. Giraudoux s’en explique dès la première scène : c’est « la forme accélérée du temps » (I, i, p. 484). Et en effet, en l’espace de deux heures, la tragédie va se jouer en temps réel. Giraudoux note :
« Tous les spectateurs, ou du moins presque tous, sauront d’avance comment l’histoire se termine, et aussi que la plupart des personnages vont être tués dans peu de temps une sorte d’ombre plane sur eux ».
Mais il ne néglige pas ceux des spectateurs qui n’ont pas lu l’Iliade, ou qui l’ont oubliée. En auteur avide de succès, et qui rêve de théâtre populaire, il livre un texte qui se lit à plusieurs niveaux pour des publics différenciés. Ainsi, son Hélène a le don de voir l’avenir coloré. Elle voit la fin de l’Iliade, la bataille, la ville en flamme — « c’est rouge vif » —, avec des approximations et des blancs que les spectateurs cultivés savoureront comme un plaisir réservé : traîné dans la poussière le cadavre de Pâris — de Pâris ou d’Hector ? —, Andromaque pleurant sur le corps d’Hector, leur fils jouant avec les boucles de son père, sans dire son nom — Astyanax bien sûr! (I, ix, p. 509)
Autre exemple : quand Hélène, devant les vieillards qui la regardent, « rajuste sa sandale, debout, prenant bien soin de croiser haut la jambe» (I, iv, p. 494), certains spectateurs reverront un haut-relief du Parthénon ; d’autres remarqueront surtout que « les plus malins regardent d’en bas »… Cassandre note encore qu’ « elle met un certain temps à rajuster sa sandale », et Pâris l’excuse :
« Je l’ai emportée nue et sans garde-robe. Ce sont des sandales à toi. Elles sont un peu grandes. »
Autant de niveaux de lecture, cumulables certes… (…) L’épopée souvent tourne à la querelle de famille. Cassandre parie contre Andromaque, Hélène « conseille à Andromaque de faire ses commissions elle-même », d’où scène d’ « explication » entre belles-sœurs. De même entre frères : « Tu as fait aussi un beau coup ce jour-là ! », dit Hector à Pâris qui réplique: « Ce que tu es frère aîné !» Une comédie bourgeoise ?
En fait, Giraudoux rêve d’être le Racine de son siècle. Sa Judith (1931), sous-titrée « tragédie », a été mal reçue, et il n’a pas accepté ce demi-échec. Avec Troie il cherche une demi-revanche. Avant la création, il présentait sa pièce comme «une comédie-tragédie », « une comédie dramatique, une tragédie bourgeoise », et c’est même écrit dans le texte. Cette tribu royale, dès qu’il est question d’Hélène, devient aussitôt un assemblage de belle-mère, de belles-sœurs et de beau-père digne de la meilleure bourgeoisie » (I, vi, p. 503). Après le succès des premières représentations, il ose le dire :
« C’est une tragédie que j’ai voulu écrire. Une tragédie, bien entendu, à ma manière, mais une tragédie, c’est-à-dire un ouvrage dominé par une fatalité «
Une menace de guerre, voilà quelle est cette fatalité. Enclenchée par l’arrivée imminente d’un envoyé grec, dès la troisième réplique, cette fatalité se trouve contrebattue dès la cinquième réplique par le retour d’Hector. Il était le rempart de Troie dans la guerre. Le voici rempart contre la guerre. Le guerrier pacifiste ! Giraudoux innove doublement. Il invente une guerre avant la guerre, et de cet Hector bien connu d’Homère, il fait un ancien combattant. En partant il avait juré que cette guerre était la dernière. Il a aimé la guerre, il la hait désormais (…)
Pour Giraudoux, le discours aux morts posait un double problème. Dans Bella (1926), sous le nom de Rebendart, il avait attaqué Raymond Poincaré, Président de la République de 1913 à 1919, l’accusant, peut-être secrètement d’avoir été jusqu’au-boutiste en 1915 et 1916 et même d’avoir une part de responsabilité dans le déclenchement des hostilités, clairement d’utiliser maintenant les morts pour « prêcher la haine, la hargne et l’amertume » et s’opposer à la politique de Briand : la réconciliation, alors possible, avec la République allemande de Weimar.
« Tous les dimanches, […] inaugurant son monument hebdomadaire aux morts, feignant de croire que les tués s’étaient simplement retirés à l’écart pour délibérer sur les sommes dues par l’Allemagne, il exerçait son chantage sur ce jury silencieux dont il invoquait le silence ».
Giraudoux ne veut pas prendre le rôle de Rebendart. Faire à son tour un « discours aux morts » ? Par défi, et par conscience, il va tordre le cou de l’éloquence traditionnelle. Ses manuscrits prouvent qu’il s’y est repris à plusieurs fois, de deux façons : en faisant, par antiphrase, l’éloge de la vie, et en dénonçant les prétendues vertus guerrières. Finalement il met les deux versions bout-à-bout.
Jouant de profil, bas-relief égyptien, tous les soirs, dans l’émotion partagée puis les applaudissements unanimes, « acclamé pour ce qu’il disait, et pour sa façon de le dire », Jouvet prononça cet anti-discours « sans inflexion, à voix contenue », sans aucun effet oratoire, et, selon la grande Colette, ce « Discours aux morts de la guerre pourrait bien devenir d’ici peu une Prière sur l’Acropole à la mesure de notre temps et de son inquiétude. » Ainsi, « le rôle d’Hector marque une date dans la carrière de M. Jouvet ». Il pouvait jouer Arnolphe, il pourra jouer Don Juan. Réciproquement, le jeu de Jouvet promeut le personnage. D’où la tentation de prendre Hector pour le porte-parole de Giraudoux, et Giraudoux pour un pacifiste.
Le succès de cette lecture « pacifiste » a un revers. Giraudoux n’a pas que des amis. Paul Claudel note dans son Journal :
« Cette apologie de la lâcheté et de la paix à tout prix est répugnante ».
Claudel, jaloux de n’être pas joué chez Jouvet, a pu aussi se reconnaître dans ces vieillards pressés d’envoyer la jeunesse se faire tuer. En sens inverse, Dominique Jamet jugera qu’« il fallait alors un sacré courage à Giraudoux et à Jouvet pour dire leur fait aux chercheurs de revanche, et faire l’apologie des signes extérieurs de la lâcheté ».
« Les plus beaux livres de Giraudoux sont écrits sont le signe de la colombe », écrira Gide en mars 1944, donnant pour exemple cette phrase de Provinciales (1909) : « Chaque pensée que j’envoie vers toi me revient avec un rameau d’olivier ». Giraudoux avait fait la guerre, deux fois blessé, sur la Marne puis aux Dardanelles, promu au feu. On ignore trop qu’en 1916 — en pleine guerre —, Giraudoux avait émis — et même publié ! — la crainte d’une « seconde revanche », « dans vingt ans, dans trente ans ».
Il aspirait à un monde pacifique, il n’était pas pour autant objecteur de conscience, ni membre des « combattants de la paix », quoique Hector utilise le mot de « combat », et qu’Andromaque plaide au nom de « toutes les femmes du monde ». Son Hector figure (préfigure, post-préfigure) ces cohortes d’ « anciens combattants » qui jouent un grand rôle dans la France de l’entre-deux-guerres. Dans les partis, les associations, les ligues, ils répètent le mot d’ordre : « Plus jamais ça. » Et pourtant, en mars, Hitler a rétabli le service militaire obligatoire, ce dont Giraudoux s’est aussitôt alarmé. Les articles qu’il publie dans le Figaro en ce printemps 1935 le prouvent, il a vu une façon, et une seule, de tout à la fois éviter la guerre et tenir tête aux « régimes totalitaires »: faire « le poids ». Comme dans la pesée Hector-Ulysse (II, xiii, p. 543).
En 1935, les cicatrices de la Grande Guerre n’étaient pas refermées : mutilés, gueules cassées, veuves de guerre, pupilles de la nation, dettes de guerre, faiblesse du franc, natalité négative. De même qu’Hector ne voulait surtout pas de cette guerre — dont il a eu préfiguration sur la prunelle d’Hélène —, Giraudoux, qui avait fait la Marne, doutait que les miracles se reproduisent. Il redoutait quelque chose comme ce qu’avait été Sedan, quelque chose comme ce que sera la débâcle du printemps 1940. Il ne voyait pas la France en état de l’emporter alors. Et nous tous aujourd’hui, avec le recul, nous ne pouvons que déplorer cette guerre mal engagée, dans l’ombre de laquelle Hitler a pu procéder à la destruction industrielle de populations entières.
« Le pain, la paix, la liberté » : ce mot d’ordre allait conduire le Front populaire au pouvoir l’année suivante. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale, coiffant les Beaux-arts, décernera à Giraudoux la cravate de Commandeur de la légion d’Honneur et lui offrira l’administration de la Comédie-Française, qu’il déclinera au profit de son ami Édouard Bourdet. En 1938, il ne sera pas de ces « Munichois » qui approuvaient les concessions faites à Hitler. En 1939, il ne se dérobera pas et assumera la charge de diriger le commissariat général à l’information de la France en guerre contre Hitler alors l’allié de Staline. « Cassandre à la propagande », ironisera Aragon. Car elle a eu lieu…
(…) Charles Maurras, Léon Daudet, Robert Brasillach, Drieu La Rochelle et d’autres avaient lancé un manifeste des « intellectuels » — le mot est dans la pièce (II, iv, p. 516) —en faveur de l’Italie. En tant que fonctionnaire des Affaires étrangères, nouvellement nommé inspecteur général des Postes diplomatiques et consulaires, Giraudoux ne pouvait pas signer la réplique aux côtés de Gide, de Malraux, de ses amis Beucler et Jouvet. Mais en signant La guerre de Troie n’aura pas lieu, il signait à sa façon, et même L’Humanité le comprit :
« Si, comme certains l’avaient regretté, Jean Giraudoux s’est abstenu de participer aux manifestations qui ont eu lieu pour ou contre la paix, pour ou contre la culture, c’est peut-être que l’écrivain se réservait d’agir à sa manière ».
Néanmoins, il se défendit d’avoir écrit une pièce d’actualité. Assez actuelle certes, mais d’un intérêt « ne disons pas éternel, mais assez permanent» puisqu’« il est question de la guerre et de la paix ». Quand par la bouche d’Ulysse les Grecs se jugent « à l’étroit sur du roc », on pense à « l’espace vital » revendiqué par Hitler. Mais ces marqueurs sont faibles au point que Jean Vilar, jouant Ulysse en Avignon (1963), se fit une moustache à la Hitler mais y renonça à Paris, et qu’en 1983-1984, un autre Ulysse pouvait arborer une cocarde bleu-blanc-rouge au festival de Schwäbig Hall tandis qu’à Bellac en 1985 il avait l’accent germanique.
(…) 1935, c’était une époque difficile, que seul un regard rétrospectif, mais anachronique, a pu éclairer. Du fait de la menace hitlérienne, écrit Christian Mégret en 1962, « tout le crédit que la guerre des patries avait perdu, la guerre antifasciste le retrouva ». Ironie de l’histoire : en 1935, après le voyage de Laval à Moscou, les communistes votèrent les crédits militaires ; en 1962, ils soutiendront la campagne du « mouvement de la Paix » pour l’interdiction des armes atomiques, et Jean Vilar, en fidèle compagnon de route, montera Troie dans la cour d’Honneur d’Avignon puis à Chaillot, vastes espaces archicombles, afin de rappeler au public du T.N.P. les horreurs de la guerre, façon de participer à la campagne internationale du « Mouvement de la paix ».
Mais bientôt le vent tournait. Les choses basculent vers 1980, après que des historiens américains ont commencé à chercher des responsables du génocide en France, et, dans leur sillage, des non-historiens. Moyennant contresens et lectures anachroniques, une vulgate se répand qui fait de Giraudoux un antisémite pur et dur au mépris de son rôle historique, et même un inspirateur du vichysme, un programmateur de l’holocauste. Son engagement comme Commissaire général à l’information (de juillet 1939 à mars 1940) au service du gouvernement qui a déclaré la guerre à Hitler, on le transfère au service de Pétain ! Le pacifisme devient une volonté de servir Hitler, et La guerre de Troie n’aura pas lieu une anticipation des accords de Munich. Cette damnation l’exclut de maints conservatoires où il régnait en vrai classique, le chasse des grands théâtres subventionnés et compromet sa carrière en Amérique. Au point de provoquer l’indignation de Philippe Tesson en 2006:
« La guerre de Troie n’aura pas lieu n’est pas sitôt à l’affiche que déjà et encore la mauvaise querelle se rallume autour de Giraudoux. Giraudoux le Munichois, Giraudoux le pacifiste, Giraudoux-Hitler même combat ! »
En vain. L’antienne revient en 2013 : Francis Huster serait coupable de s’être mis au service du point de vue qui, au moment de la création de la pièce, en 1935, au Théâtre de l’Athénée, faisait dire :
« Tout, absolument tout, vaut mieux que la guerre à Hitler et à l’hitlérisme ».[…] Ce pacifisme de principe n’est-il pas le message qu’entendait porter l’auteur de Pleins Pouvoirs et, bientôt, de Sans pouvoirs ? Je n’aime pas Giraudoux. Je n’aime pas ce mélange de républicanisme bon teint et d’ »antisémitisme bon chic bon genre » […].
Voilà qui est bien éloigné de la doctrine de Giraudoux selon laquelle « le théâtre n’est pas un théorème, mais un spectacle, pas une leçon, mais un filtre ». Et bien éloigné de la conclusion de Benjamin Crémieux :
» Votre pièce, quelle que soit sa valeur d’avertissement, est aux antipodes d’une œuvre de propagande. Et c’est là ce qui montre qu’on peut aborder les problèmes les plus délicats, les plus brûlants, les plus terribles, en gardant son entière liberté d’esprit et aussi en n’abdiquant pas toute cette part de « joie » qui est indispensable à l’œuvre d’art. »
La pièce de Giraudoux n’a pas empêché la guerre d’avoir lieu. La guerre n’a pas empêché la pièce de Giraudoux d’avoir cours sur toutes les scènes du monde. Les critiques, qui ne lui ont pas manqué, ne l’étoufferont pas. Elle rappelle les hommes à leurs devoirs d’humanité. Elle les invite à la réflexion, la polémique n’en est que l’écume. Et puisqu’elle ne s’arrêtera pas d’un coup, nous versons au dossier l’étonnant compte rendu signé Alfred Kerr, l’un des plus illustres critiques de théâtre de son temps.
De tant de représentations surnagent de grands moments de bonheur, des joutes verbales, phrase à phrase ou mot à mot, et aussi bien de vrais couplets incantatoires qu’un interlocuteur découpe et relance, chacun parlant sur le silence de l’autre, — sur la beauté de la femme idéale et celle de la forêt de bouleaux, sur la navigation amoureuse d’Hélène et Pâris —, morceaux d’anthologie, entremêlés de jeux de mots, de mots d’esprit, d’esprit gamin.
On n‘oubliera pas les paroles sobres et fortes qu’échangent Hector et Andromaque, couple exemplaire, ni l’anti-discours aux morts, ni le dialogue biaisé d’Hector et d’Ulysse. Persistent le refus du désespoir, et d’une pirouette de la pensée, cet élixir de sagesse :
« Tu as vu le destin s’intéresser à des phrases négatives ? »
Pour que la guerre n’ait pas lieu, peut-être faut-il plus que la volonté toute négative de l’empêcher : une volonté positive, des grands travaux, des projets plus grands qu’elle, et aussi, dans l’humilité, les petits actes quotidiens qui fondent la justice et la paix.
(extraits de la préface)
Jean Giraudoux
La Guerre de Troie n’aura pas lieu
Edition de Jacques Body
304 pages, 4,60 euros
Folio/Théâtre
18 Réponses pour Un titre problématique de Giraudoux
« Judith » reste une très belle pièce. Et qui dira le courage qu’il y eut à faire jouer dans ses années là face à l’AF des interprètes juifs? Cela change de l’abjecte vulgate justement dénoncée et qu’on a vu naitre dans les années 1980. Pour Troie,Je suis surpris que la traductrice allemande n’inclut pas un point d’interrogation dans son Kein Krieg in Troja, mais est-ce possible?
Vous avez raison d’évoquer Beucler. Je ne puis que recommander ses « Instants de Giraudoux » ou il nous fait voir ce que pouvait etre la conversation d’un tel homme.
Poincaré traverse ces derniers temps une sorte de descente aux Enfers. Ses origines Lorraines méritent d’etre rappelées, son honneteté intrinsèque aussi, quoi qu’il y ait entre Giraudoux et lui.
Bien à vous.
MC
ce n’était pas au futur maais au passé que le titre dans Libération « la guerre du golfe n’a pas eu lieu » en a hérissé plus d’un
apparemment, je ne peux donner la date de l’article et le contexte : tant pis!
Anette Kolb, avec son « Kein » privatif (un négatif très neutre voire feutré, « à la J. Beuys », encore assez barthien, tiens) aura sans doute eut dans un coin de sa tête un rappel du titre du roman de E.M. Remarque.
« Im Westen Trojas nichts Neues » aurait pu servir d’alternative (je plaisante.)
En tout cas, certains historiens remettent sur le tapis la possibilité d’une intervention armée, politiquement hitléricide,à l’occasion de la remilitarisation de la Rhénanie en 1938.
George Bataille n’y était pas opposé à l’époque (lui qui plut tant à Heidegger plus tard, après guerre), contrairement à beaucoup qui préférèrent prendre le funiculaire d’Ödön von Horvâth (« Der Bergbahn »), mais sans les mêmes talent ni courage intellectuels, peut-être, vers le Sacré-Coeur de Montmartre pour y déposer des cierges laïques.
Mais convenir aussi que si la guerre n’avait pas eut lieu, alors c’est sûr que le théâtre de Franz-Xaver Kroetz n’aurait pas eut lieu non plus.
Nous pouvons remercier Churchill (que Kroetz aime détester un peu, beaucoup, passionnément.)
« eu lieu » x ², entschuldigen Sie, bitte.
Ce titre ne prend vraiment son sens que dans le contexte de 1935. Confronté au « Elle aura lieu » de la fin, il trahit le pessimisme de l’auteur, pour qui, très vraisemblablement, les efforts des pacifistes (parmi lesquels nombre de combattants de 14/18) ne pesaient pas lourd face à la montée des menaces d’un nouveau conflit armé majeur. Reste à savoir si, en dépit de grandes beautés et de moments très forts (comme le discours d’Hector aux morts), cette oeuvre est encore capable de nous émouvoir. Son statisme discoureur, anti-théâtral au possible, est très représentatif des limites de Giraudoux dans le genre qui a pourtant le plus contribué à asseoir sa notoriété. Tout le monde ne peut pas être Brecht ou von Horvath.
Son statisme discoureur, anti-théâtral au possible, est très représentatif des limites de Giraudoux dans le genre qui a pourtant le plus contribué à asseoir sa notoriété. (moi)
Je n’ai pas revu « La Guerre de Troie n’aura pas lieu » depuis la mise en scène de Vilar à Chaillot : ça remonte ! C’était un grand déploiement frontal de beaux costumes sur le vaste plateau. C’était conventionnel et assommant. Bien entendu le public était conquis. Le moment le plus révélateur de l’incapacité de Giraudoux à faire avancer l’action dramatique par le moyen du discours fut, à la fin, la grande confrontation Hector/Ulysse. La musique de scène était de Maurice Jarre, qui avait imaginé, pour que le public sente mieux la montée du péril, d’accompagner le texte par un roulement de tambour continu, pianissimo d’abord, puis allant crescendo. Broum broum broum ratabroum. En somme, cet artifice passablement grossier et ridicule tâchait de suppléer à la parfaite inertie de ce texte, beau en soi, mais dépourvu de toute vertu dramatique. Ce n’est pas avec un texte pareil que Giraudoux avait des chances de devenir le Racine du XXe siècle. J’étais jeune alors, et cette expérience de spectateur me fit plus rapidement comprendre, par défaut, ce que ne doit pas être le théâtre. Quant à savoir ce qu’il doit être, c’est plus compliqué.
Si l’on admet que, dans « art dramatique », l’étymologie pose l’action comme nécessaire ingrédient du programme, « la guerre de Troie n’aura pas lieu » est en grave déficit de ce point de vue, comme le sera aussi « la Folle de Chaillot ». A cet égard « Electre » lui est très supérieure, c’est même probablement la seule pièce de Giraudoux où il se passe vraiment quelque chose (« Ondine » peut-être aussi). Il faut dire que l’auteur bénéficiait du renfort de Sophocle.
Mais si l’on admet que la structure théatrale n’est pas toujours, à travers les ages, un enchainement de péripéties et de scènes à faire, alors le théatre de Giraudoux acquiert sa pleine légitimité entre conversation, jeu sur le mythe et l’anachronisme, et profondeur du sujet, sans tomber dans le néo-Sénèque ou dans le chant empétré d’un Montherlant façon Guerre Civile.
MC
alors le théatre de Giraudoux acquiert sa pleine légitimité entre conversation, jeu sur le mythe et l’anachronisme, et profondeur du sujet (Court)
Dit comme ça, c’est séduisant. Le problème est que, scéniquement, ça ne tient pas la route. L’incarnation scénique est la pierre de touche de la théâtralité vraie, et le théâtre de Giraudoux ne me paraît pas résister à cette épreuve de vérité.
Je reprends à mon compte la citation de MCourt faite par Onésiphore.
Une conversation, oui, c’est ce que je ressens, mais comme tirée d’un rêve, celui d’un dramaturge qui aurait réussi la retranscription exacte de quelque chose qui lui fut soufflée dans la nuit et mis en scène par le travail du sommeil, aux forces d’énonciation insoupçonnées, locuteur natif d’une poésie coulant d’une source inconnue. Pour moi c’est un tour de force qui ne montre rien d’un effort, en effet.
1935 représente peut-être l’année des derniers feux de la gigantomachie intellectuelle opposant deux parties européennes prépondérantes de la pensée.
Nous avons Debussy qui après avoir passé un peu de temps à commenter l’oeuvre de Wagner, la sublime enfin et permet de diluer un peu plus les brumes légèrement mystificatrices d’un théâtre wagnérien, hanté par les dieux du Nord.
Le style de Giraudoux étant peut-être aussi une tentative d’endiguer la furia du fleuve romantique d’un morceau de la culture allemande, goulue de bien des méandres.
On accuse les deux d’un manque de chair ? Il y a pourtant une superbe méditation, dans la musique du compositeur et l’écriture du poète, sur le « körperlich » et le « seelisch » (je cite des termes allemands exprès, en pensant à Frau Kolb et à l’auteur de l’article dont le nom s’incarne « per se ») qui n’ont pas toujours besoin de s’affronter dans les oeuvres d’art. Il peut exister belle cohabitation sinon symbiose entre les deux.
Il y a de merveilleux moments dans la GdTn’APL, l’emploi du « on’ dans la bouche de Cassandre, dans la première scène par exemple, et bien d’autres choses.
J’ai vu la pièce à l’âge de treize ans dirigée par un professeur de français de classe de troisième, beaucoup n’avaient que d’yeux pour la fabuleuse corporéité de l’élève qui jouait Hélène, aux longs cheveux blonds.
En sortant de la représentation, j’avais cette réplique qui me restait en tête, « Pâris ne tient plus à Hélène ! Hélène ne tient plus à Pâris !, comment était-ce possible, me disais-je ? Historiquement tout ça fut résolu par le de Gaulle-Ulysse qui, à la question d’Hitler « Brennt Pâris ? », répondit : « Non ! »
Le destin s’intéressait enfin aux réponses lapidaires négatives.
Onésiphore
Raisonnement existentialis
-te qui suppose l’existence d’une théatralité pure et immuable, mais ce n’est pas vrai.Le père Musset n’a-t-il pas écrit son spectacle dans un fauteuil? Et quoi de commun entre la dramaturgie de Racine et celle de Michel Strogoff version Chatelet ou de Cyrano?
Par ailleurs, je n’ai pas l’impression que le discours aux morts ou que l’ action finale du démagogue soient du mauvais théatre, voyez-vous.
MC
Pardon, lire raisonnement essentialiste! Il a du se produire une interaction avec Les Mouches!
Le père Musset n’a-t-il pas écrit son spectacle dans un fauteuil? (Court)
Je serais le dernier à nier qu’il y ait grand plaisir à lire Giraudoux. Mais si le jeu du théâtre en est la vérité, comme le suggère Molière dans la préface à « L’Ecole des femmes » (si je me souviens bien, à moins que ce ne soit dans celle à « L’Impromptu de Versailles »), je suis d’avis que l’abus des couplets, des mots d’auteur et des joliesses purement textuelles multiplie, dans les pièces de Giraudoux les obstacles au déploiement de ce jeu. On m’objectera que le texte n’est pas moins prédominant dans les tragédies de Racine que chez Giraudoux. Mais les textes raciniens sont des textes authentiquement dramatiques qui font incessamment avancer l’action; tandis que, chez Giraudoux, l’action est presque toujours inexistante, sous quelque forme qu’on l’envisage. Je reste étonné qu’un comédien aussi expérimenté que Jouvet ait fait de Giraudoux son auteur de prédilection.
Le niveau monte! Il était temps.
Devant la peste rouge de Moscou, comment ne pas croire que le choléra brun de Berlin puisse faire antidote? Et lorsque les deux firent alliance, comment ne pas trembler de peur? J’étais bien jeune à l’époque, trop pour comprendre. «Laissons ce monsieur Hitler mettre les soviétiques à leur place!» disait-on dans les chaumières. Il a bien tenté, mais il eût fallu l’y aider, pour ensuite le prendre à revers. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une autre peste, la verte, et je ne parle pas de l’écologie. Je lis sur Internet qu’au Québec les musulmans louent des locaux sous de faux prétextes pour s’y réunir tranquillement et répandre cette idéologie mortifère qui leur tient lieu de religion. Les autorités sévissent. Et dire qu’il n’y avait pas 100 musulmans au Québec en 1960! Ils ont encouragé l’immigration musulmane parce qu’elle était francophone et que nos cousins avaient comme nous cessé de faire des enfants, eux qui étaient passé de 70 000 en 1760 à 7 000 000 deux siècles plus tard! Ils en paient le prix: des lycéens partent rejoindre les terroristes mahométans, pauvres enfants en mal de sensation forte. Giraudoux, où es-tu ?
Ce serait un « Mohammed et le Limousin » qu’il lui faudrait écrire , Bihoreau!
Bien à vous.
MC
Je lis sur Internet qu’au Québec les musulmans louent des locaux sous de faux prétextes pour s’y réunir tranquillement et répandre cette idéologie mortifère qui leur tient lieu de religion. (Bihoreau de trucmuche)
Cela s’appelle des salles de prière, ou éventuellement des mosquées, Bihoreau. Il faudrait vous tenir au courant. J’approuve la discrétion de ces gens. L’été dernier, dans mon village, la collégiale étant fermée pour cause de réparations, j’ai dû subir, bien malgré moi, le sermon de l’archiprêtre diffusé en plein air, avec micro et sono, lors de la messe dominicale. Cet olibrius ne craignait pas de déverser son idéologie mortifère en public, en dépit de ma présence et de celle de nombreux touristes. Il y développait notamment la thèse, éminemment contestable, que la morale ne saurait se passer de la croyance en Dieu. Les autorités municipales avaient, semble-t-il, délivré leur autorisation. Je ne voterai pas pour elles aux prochaines élections. J’aurais pu déclamer « La passion considérée comme course de côte », d’Alfred Jarry — texte que je connais par coeur. Mais je m’en abstins, par un vague reste de charité je crois. Et puis, une de mes maîtresses figurait parmi les paroissiennes.



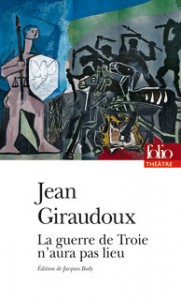
18
commentaires