
Une fois retraduit, plus tout à fait le même livre
Au fond, mieux que par un critique, un universitaire, un correcteur, un éditeur, un libraire et même mieux que par son auteur, un livre n’est jamais aussi bien désarmé que par son traducteur. Lui seul peut lui faire rendre les armes au sens propre, le défaire de tout ce qui le protège. Tout auteur dont l’œuvre a été transportée dans une autre langue peut en témoigner : en l’interrogeant sur ou tel point obscur, son traducteur a mis le doigt là sur une incohérence, ici sur un oubli, plus loin sur une contradiction, ailleurs encore sur des fautes, des lacunes qui avaient échappé à tous. Sans la ramener, il est l’implacable inspecteur des travaux finis, et même publiés, agissant non en correcteur mais en relecteur pointilleux. C’est aussi pour cela qu’il faut lire les traducteurs non seulement dans leurs traductions mais dans leurs paratextes. Plusieurs parutions nous y engagent ces jours-ci.
Ecrivain et éditeur, Frédéric Boyer poursuit une singulière aventure dans ce domaine en ce qu’il semble se situer en marge de la communauté des traducteurs, ceux dont c’est l’unique métier, ou le principal. Il avait déjà donné un aperçu de son goût de l’écart en 2001 en se faisant le maître d’œuvre d’une nouvelle traduction de la Bible confiée à des exégètes et des écrivains. Puis il a poursuivi en solitaire en donnant des versions très personnelles de classiques, les Sonnets et la Tragédie du roi Richard II de Shakespeare, et des Confessions de saint Augustin rebaptisé au passage Les Aveux et du Kamasûtra. Cette fois, il s’attaque aux Géorgiques de Virgile qu’il intitule Le Souci de la terre (250 pages, 21 euros, Gallimard – à feuilleter ici)
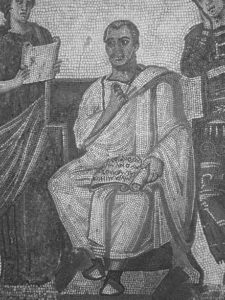 Divisé en quatre parties, ce long poème didactique composé entre 37 et 30 av. J.-C. est long de quelques 2000 vers. Ce livre « étrange », qui est aussi un livre sur la guerre, reflète le monde en crise dans lequel il a été conçu. Mais si le pari est osé, c’est d’abord que l’œuvre est beaucoup moins attrayante que L’Eneide. Le plus souvent, ceux qui eurent à plancher dessus dans leurs jeunes années en ont conservé un souvenir assez ennuyeux ; il est vrai qu’il est plus difficile de séduire sans la dimension épique du style noble, ou mythologique du style moyen. Là, c’est surtout le Livre II sur les arbres et les forêts qui retient par ses résonances avec nos préoccupations ; ce qui explique les libertés que Frédéric Boyer avec le titre canonique des Géorgiques ; il est vrai que Le Souci de la terre résonne comme le titre d’un essai de René Dumont ou d’André Gorz. Après tout, l’idée des travaux de la terre est toute entière contenue dans georgicon. La remarque de Ludwig Wittgenstein citée en épigraphe éclaire mieux que tout commentaire et tout discours le projet du (re)traducteur :
Divisé en quatre parties, ce long poème didactique composé entre 37 et 30 av. J.-C. est long de quelques 2000 vers. Ce livre « étrange », qui est aussi un livre sur la guerre, reflète le monde en crise dans lequel il a été conçu. Mais si le pari est osé, c’est d’abord que l’œuvre est beaucoup moins attrayante que L’Eneide. Le plus souvent, ceux qui eurent à plancher dessus dans leurs jeunes années en ont conservé un souvenir assez ennuyeux ; il est vrai qu’il est plus difficile de séduire sans la dimension épique du style noble, ou mythologique du style moyen. Là, c’est surtout le Livre II sur les arbres et les forêts qui retient par ses résonances avec nos préoccupations ; ce qui explique les libertés que Frédéric Boyer avec le titre canonique des Géorgiques ; il est vrai que Le Souci de la terre résonne comme le titre d’un essai de René Dumont ou d’André Gorz. Après tout, l’idée des travaux de la terre est toute entière contenue dans georgicon. La remarque de Ludwig Wittgenstein citée en épigraphe éclaire mieux que tout commentaire et tout discours le projet du (re)traducteur :
« Mon idée n’est pas de rafraîchir un ancien style. Il ne s’agit pas de prendre d’anciennes formes et de les ordonner selon les exigences du goût nouveau. Ce dont il s’agit en réalité, c’est de parler, peut-être inconsciemment, la langue ancienne, mais de la parler de telle manière qu’elle appartienne au nouveau monde, sans pour autant appartenir nécessairement au goût de celui-ci »
Ceci posé, Frédéric Boyer s’autorise dès l’entame de sa préface un bref moment d’egohistoire, et c’est bienvenu. Quelques phrases pour dire qu’il a traduit comme on fait son deuil, entre-deux-morts, celle de sa compagne Anne Dufourmantelle et celle de son éditeur et ami Paul Otchakovsky-Laurens. Une manière pudique et nécessaire de rappeler implicitement qu’un traducteur est aussi un auteur, qu’il écrit dans un état d’esprit et un environnement mental particuliers. Conscient que le deuil défait les rythmes quotidiens, il lui a fallu chercher néanmoins un autre rythme dans la langue moderne, qui puisse faire écho à la scansion latine de l’hexamètre dactylique. Le premier traducteur français de cette œuvre en 1519 avait opté pour les décasyllabes ; ses successeurs en firent autant jusqu’à ce qu’en 1769 l’abbé Delille leur préfère les alexandrins rimés ; d’autres ensuite oseront les vers ou la prose.
« Notre ambition, plus modeste, plus intime, a été de composer un poème contemporain, interprétant librement le rythme du vers latin, suivant autant que possible l’ordre des mots de la phrase latine. Et faisant apparaître un poème nouveau »
Tout en conservant la dramaturgie du poème de Virgile, Frédéric Boyer a donc choisi la forme des versets libres aux rythmes divers, en n’oubliant jamais que le poète lisait lui-même ses œuvres publiquement et qu’il avait imaginé les Géorgiques au repos, dans la campagne de Naples, en rêvant et contemplant. C’est aussi cela qu’il s’est fixé pour tâche de rendre en français., cet état-là alors que tout semble s’y déployer dans le royaume des morts. Sous sa plume, le fameux final où le poète dit qu’il aura écrit ces vers dans un retraite sans gloire, ignobilis oti devient un « désoeuvrement sans éclat ».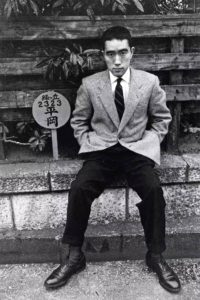
Il y aussi quelque chose d’un « nouveau livre » lorsqu’on lit à nouveau Confessions d’un masque (仮面の告白 Kamen no Kokuhaku, 234 pages, 20 euros, Gallimard), la fameuse autobiographie intime de Yukio Mishima, son propre « gouffre de la sexualité », mais cette fois dans la nouvelle traduction du japonais de Dominique Palmé. Et c’est aussi pour une question de rythme, le nerf de cette guerre des mots. La traductrice a voulu y rendre la voix authentique du jeune écrivain enfin débarrassée du parasitage de la double traduction (la première fois en 1972, Renée Villoteau était partie de la version anglaise, pratique qui n’est pas si rare, hélas…). Après avoir déjà fait l’expérience de rendre en français La Musique (2000) du même auteur, elle a donc travaillé à partir de l’édition originale japonaise de 1949 afin de restituer sa ponctuation (notamment des tirets longs de plus d’un cadratin et des six points de suspension enchainés) car c’est aussi là que se déchiffre le rythme particulier de Confession d’un masque. Et effectivement, ce n’est plus tout à fait le même livre… D’ailleurs, sur le large bandeau ceinturant le roman, l’éditeur a mentionné en surimpression par-dessus son portrait « nouvelle traduction ».
C’est devenu un argument promotionnel et ça se conçoit tant des classiques ont souffert de longues années durant de traductions, disons, datées, fautives, inappropriées (Le Guépard, La Montagne Magique…). En l’espèce, réviser ce n’est pas seulement réparer : traduire à nouveau signifie traduire à nouveaux frais. Certains (re)traducteurs préfèrent même ignorer la version antérieure pour conserver une certaine fraîcheur au premier regard. Ceux-là n’hésitent pas à bombarder l’auteur de questions, à supposer qu’ils soient toujours de ce monde. Dans L’Atelier du roman (Conversacion en Princeton con Rubén Gallo, traduit de l’espagnol par Albert Bensoussan et Daniel Lefort, 296 pages, 21 euros, Arcades/Gallimard), Mario Vargas Llosa est revenu en détail et en profondeur en 2015 sur son travail d’écriture. Une poignée de pages y sont consacrées aux théories de la traduction. C’est bien le moins pour un auteur dont l’œuvre nobélisée a été de longue date éditée dans de nombreux pays. Celui-ci est du genre à entretenir une correspondance suivie avec ses traducteurs dès lors qu’ils le poussent à s’expliquer et à préciser. Exemple : l’usage du mot cholo dans Conversation à La Catedral (1969). Pour l’édition du livre en anglais, le traducteur Gregory Rabassa ne cacha pas ses difficultés à le rendre autrement qu’en employant… deux mots, selon le contexte : soit half-breed qui a une connotation raciale, soit peasant où elle est plutôt sociale ; et si il veut mettre le paquet et faire fort, il n’en fait qu’un : peasant half-breed et inversement !
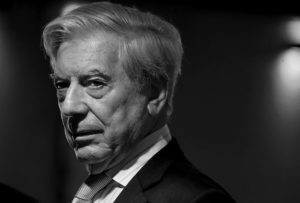 Or l’auteur récuse peasant au motif que tout dépend de la personne qui use de cholo dont le sens originel est « métis ». Dans la bouche d’une mère ou d’une amoureuse, c’est affectueux ; dans celle d’un Blanc vis à vis d’un Indien, c’est insultant. Le nuancier est large de mi cholito lindo à cholo de mierda. « Et puis, on peut toujours être le cholo de quelqu’un » observe Vargas Llosa pour bien souligner l’éventail des variantes qui se présente dès que l’on entre dans la complexité d’une langue, ce à quoi un traducteur consciencieux est toujours confronté. Un problème du même type dès l’incipit de Qui a tué Palomino Molero ? (1987). Le premier mot est : « jijunagrandisima ». Lorsqu’un traducteur l’a rendu en anglais par son of bitches, l’auteur lui avait reproché de faire l’impasse sur la couleur locale. Comme si en français c’était devenu simplement « mon Dieu ! quelle horreur » alors qu’Albert Bensoussan en avait fait avec bonheur « Bordel de merde de vérole de cul ! » et cela avait suffi pour que, dès le début du roman, on soit de plain pied dans l’ambiance.
Or l’auteur récuse peasant au motif que tout dépend de la personne qui use de cholo dont le sens originel est « métis ». Dans la bouche d’une mère ou d’une amoureuse, c’est affectueux ; dans celle d’un Blanc vis à vis d’un Indien, c’est insultant. Le nuancier est large de mi cholito lindo à cholo de mierda. « Et puis, on peut toujours être le cholo de quelqu’un » observe Vargas Llosa pour bien souligner l’éventail des variantes qui se présente dès que l’on entre dans la complexité d’une langue, ce à quoi un traducteur consciencieux est toujours confronté. Un problème du même type dès l’incipit de Qui a tué Palomino Molero ? (1987). Le premier mot est : « jijunagrandisima ». Lorsqu’un traducteur l’a rendu en anglais par son of bitches, l’auteur lui avait reproché de faire l’impasse sur la couleur locale. Comme si en français c’était devenu simplement « mon Dieu ! quelle horreur » alors qu’Albert Bensoussan en avait fait avec bonheur « Bordel de merde de vérole de cul ! » et cela avait suffi pour que, dès le début du roman, on soit de plain pied dans l’ambiance.
Quoique polyglotte, Maria Vargas Llosa n’est pas le genre d’écrivain qui s’impose et pèse sur ses traducteurs. Il ne s’en mêle que s’il est sollicité, le plus souvent pour préciser le sens de ses péruanismes. Et même dans ce cas, il dira toujours sa préférence pour une traduction qui soit véritablement « une création originale », une réécriture dans la langue cible même au risque que la langue source soit trahie ; en ce sens, il se soucie davantage de l’excellence de la propre langue de son traducteur plutôt que de sa parfaite connaissance de l’espagnol.
« Il n’y a rien de pire que de lire un livre et de sentir que c’est une traduction, de sentir que quelque chose grince dans l’expression, que c’est une langue factice, que les personnages ne parleraient jamais comme on les fait parler. »
Et d’évoquer les fameuses libertés que Jorge Luis Borges prenait lorsqu’il s’emparait de textes qu’il traduisait en espagnol : il allait jusqu’à supprimer des passages trop longs ou modifier la chute d’une nouvelle si elle laissait à désirer, enfin, selon lui… C’est pourquoi certains lecteurs hispanisants avisés lisent ses traductions de livres de Faulkner, Swift ou Whitman avant tout comme du… Borges !
Après tout, qu’est-ce qu’un traducteur sinon un interprète ? C’est notamment le cas lorsqu’une seule et même personne se fait le truchement d’un écrivain à l’écrit comme à l’oral, dans ses livres et articles comme dans ses conférences et conversations. Valérie Zenatti, elle-même écrivain et scénariste, a eu le bonheur et le privilège de vivre cet état particulier pendant quinze ans avec l’écrivain israélien Aharon Appelfeld. Un genre de collaboration parfois évoqué comme une conversation silencieuse. Elle l’a d’abord rencontré en lisant fascinée Le Temps des prodiges et de là est née aussitôt chez l’agrégée d’hébreu le désir irrépressible de le traduire, c’est à dire « de ramener ses livres sur la terre d’Europe qui leur avait donné naissance ». 
Quand le vieux monsieur venait en France, la jeune femme se tenait toujours à ses côtés. A la fin, ils ne faisaient qu’un, unis par une profonde affection mutuelle. Tant et si bien que lorsqu’il disparut à 85 ans, il y a un peu plus d’un an, il fallait se garder de présenter ses condoléances à sa traductrice et interprète. Un livre est né tant de cette relation que de sa fin, un récit bouleversant intitulé Dans le faisceau des vivants (16,50 euros, 152 pages, éditions de l’Olivier). Une fois passée l’état de sidération dans lequel la nouvelle de sa mort l’a laissée alors qu’une fois de plus, elle s’apprêtait à prendre l’avion pour Israël afin de l’y retrouver, elle est partie sur ses traces du côté de Czernovitz, désormais en Ukraine, mais autrefois en Bucovine roumaine puis en URSS, là où il avait vu le jour et où il avait grandi jusqu’à sa déportation (comme le poète Paul Celan qui, un mois avant de se suicider, lui avait confié : « Je t’envie, tu écris dans la langue maternelle du peuple juif ») dans un camp d’où il s’évada à 10 ans pour se réfugier des mois durant dans la forêt.
En retournant chez lui, des phrases lui reviennent de leurs innombrables conversations, des choses vues, des explosions de mémoires en marge de ses livres, des flashs du monde d’avant, des éclats qu’elle inscrit aussitôt en creux de son récit mais en italiques pour que l’on sache bien que c’est lui qui parle. « Où commence ma mémoire ? » se demande-t-il en permanence sans être sûr de savoir la réponse. Dans son flux de paroles restitué avec grâce, quelques mots suffisent à Appelfeld pour dire pourquoi on est de son enfance comme on est d’un pays : enfant du ghetto, du camp et de la forêt, il sentira toujours la neige d’Occident mais jamais le sable d’Orient ; jamais il ne se débarrassera de l’instinct de survie, de certaines taches de mémoire, de traces indélébiles.
« La face sombre de Dieu. Nous étions entre ses mains et il nous déposait d’un endroit à l’autre ».
C’est un récit bref, sensible, plein de larmes retenues et d’émotions à peine maitrisées mais sans le moindre pathos. Une écrivaine s’y interdit de parler à la place d’un écrivain, ce qui ne va pas de soi pour qui a passé quinze ans de sa vie à superposer sa propre voix à celle d’un autre, admiré, aimé.
(« Virgile et les muses » mosaïque anonyme du IIIème siècle, musée national du Bardo, Tunisie ; « Yukio Mishima » ; « Mario Vargas Llosa; « Aharon Appelfeld et Valérie Zenatti » photos D.R.)
1 350 Réponses pour Une fois retraduit, plus tout à fait le même livre
Echt blöd… Qu’on se le tienne pour dit.
https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/blöd.html.
Phil,
Dans les livres peut-être…Mais dans la vie, quand on dit « Gott, der ist echt blöd », ca veut dire ce que ca veut dire. Variante : « bescheuert ».
Phil, sortez de vos livres pour apprendre la langue parlée contemporaine, mon avis est que vous ne perdez rien.
Ed, vous avez raison mais Mann ne dirait ni n’écrirait jamais « complétement con » ! ni « beklopft/bescheuert usw…
dear Bérénice, parfois vous êtes à côté de vos pompes !
Langue contemporaine Ipodée pour bac à sable.
Évidemment, je me suis égarée par rapport au contexte de votre exemple (un extrait du Journal de T. Mann, donc) pour penser la langue dans sa globalité, dans ses variations à l’oral.
« Bescheuert » par contre, non. Jamais à l’écrit. Aucune équivoque sur ce terme.
« Langue contemporaine Ipodée pour bac à sable. »
C’est une plaisanterie j’espère. On parle d’une expression qui était déjà employée par T. Mann. D’où est-elle contemporaine ? Vraiment la phrase de vieux c.on qui ne veut surtout pas chercher à comprendre. J’espère que vous faîtes une dédé et maniez l’ironie, sinon c’est grave !
17h30 ?
https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/bescheuert.html
Comment s’écrit en allemand s’il s’écrit et ne se contente pas d’être dit ou pensé le mot « con » et s’il a un equivalent en terme populaire mais reconnu par une académie ?
» Bérénice, parfois vous êtes à côté de vos pompes ! »
Constat simple : elle ne parle pas un mot d’allemand mais veut absolument se mêler à la conversation pour m’em.merder (et parce qu’elle s’em.merde aussi hein). Je ne la lis plus, mais ca doit pas être brillant, comme d’hab.
Pour les Cuisines , il s’agissait de corporations masculines, Bérénice, jusqu’à la Loi Le Chapelier qui les abolit. Et je n’y peux rien si c’est Carême qui, en pleine révolution, sauve tradition et savoir-faire. Le vedettariat féminin était alors dans le genre tricoteuse.
Delaporte.
Vous avez beau faire, personne ne croit à votre numéro de grand chrétien autoproclamé. Claudio Bahia ne vous l’a pas envoyé dire, et moi non plus. Vous êtes la parodie d’un christianisme figaresque, vous agenouillant devant le dernier prélat médiatisé. On pense irrésistiblement en vous lisant à la terrible phrase de La Bruyère: « un dévot est quelqu’un qui sous un Roi athée serait athée ». Sans doute combinez-vous l’un et l’autre.
Le post precedent était adressé à qui pourrait répondre. Un point de detail resultant d’un echange qui pour moi ne clot ou ne résout pas ce problème de traduction, les info communiquées me paraissant douteuses. merci .
« figaresque »
Un nouveau mot à noter dans mon cahier 😀
Hier, j’ai relu la démolition – juste et violente – de CB. Je n’aurais pas changé une virgule. Il fallait que quelqu’un lui dise.
Petit rappel, Delaporte est un personnage de theatre.
« Delaporte.
Vous avez beau faire, personne ne croit à votre numéro de grand chrétien autoproclamé. »
Vous connaissez bien mal la religion catholique, Petit Rappel. J’ai passé beaucoup d’heures à m’instruire en lisant des livres sur cette pensée, et je ne le regrette pas. Mais je ne suis pas un mondain, ça non.
@renato dit: 10 avril 2019 à 13 h 58 min
À propos de champignons, ce soir à 20:15 sur la télévision suisse romande (RTSun) : « Le retour des psychédéliques ».
[« Après des années de diabolisation, les psychédéliques font leur retour dans le champ de la médecine. Des chercheurs espèrent pouvoir utiliser LSD et champignons hallucinogènes pour soigner dépressions et autres troubles psychiatriques. »]
Les bretons bretonnants en pointe du revival et précurseurs visionnaires
https://www.youtube.com/watch?v=89NxQooymZw
(Journal de mes horaires de train).
Aujourd’hui, me suis payé le luxe d’une descente librairiale dans Paris après avoir rejoint un pote bordelais à la gare de M., histoire de bâtir le plan d’introduction d’un dossier commun à paraître pour la revue. Etais tellement heureux de cette escapade rare que j’ai payé le repas (La Ruche ; viande goûteuse). Après qu’il eut rejoint son autre rencart au Lutetia, j’ai marché jusque chez Gibert Joseph. Et du petit stock des romans butinés que je me suis offert, au retour dans ma banlieue, ai réfléchi au choix de ce que j’avais emporté (100 euros). Suis bien obligé de reconnaître qu’au fil du temps, les erdéliens m’influencent de plus en plus, bien plus que les membre de mon cercle littéraire dont je reconnais trop les goûts pour me surprendre désormais. Donc, ce petit message est de gratitude. Et il va au premier des erdéliens, Jazzman, à tout soigneur, tout honneur pour « son goût de la marche » à 4,40€ (pas trouvé « le goût du printemps », déjà épuisé, hélas, mais je n’aurais fait que le feuilleter. Il manquait à mes marcheurs, et je pense souvent à Claudio B.). Son 1er best seller à jzman prendra donc sa place entre G. Bakker et R. Barthes. Ensuite, je lirai Quatrevingt-treize et Claude Gueux dans la foulée des Misérables et de l’Homme qui rit de ces derniers temps (merci à CT et à rose de m’avoir désinhibé d’Victor Hugo…, en dépit de Paul Edel, vous n’imaginez pas ce que…). Sur les conseils d’icelui et d’autres enthousiasmes néanmoins, je vais découvrir bientôt « l’esclave vieil homme et le molosse » de Chamoiseau et surtout deux Hyvernaud retrouvés in extremis (« le wagon à vache » et « la peau et les os »). « Le commis » de Malamud m’avait tellement enthousiasmé que je ne vais pas bouder mon plaisir avec « l’homme de Kiev » et le « tonneau magique », et tout ça, c’est grâce à DHH qui sait dénicher et exhumer, et reconnaître ses déceptions, parfois : Oz !). J’ai tellement honte de n’avoir jamais lu Bouvard et Pécuchet de ma vie que cette fois-ci, j’y suis allé franco. Et maintenant, je sais aussi pourquoi nous n’aurons sans doute pas d’abricot cette année. J’ignore par quel canal « Un autre pays » de James Baldwin s’est retrouvé dans la besace…, peut-être à cause de la « chambre de giovanni » que jzmn ne connaissait pas, ce qui m’avait surpris… Hélas, le ‘Hawl’ d’Alec Ginsberg est toujours aussi introuvable et épuisé (et je n’irai jamais commander sur l’amazone, ça non !), mais comme c/° Nadaud venait d’annoncer la sortie des carnets de route de l’honorable centenaire L. Ferlinghetti, allez… soyons fou…, me suis-je dit (25 euros), allons nous replonger un brin dans les ‘années Beat’ avec l’infatigable musicien Langoncet, amateur des années beat et hip, ça pourra pas nous faire de mal !
Tout cela devrait donc nous amener tranquillos jusqu’à cet été d’août, où les tomes 3 et 4 des mémoires d’outre-tombe nous attendent patiemment, à l’ombre bleue du figuier… en pente douce. Bravo, chers ami.es. pour ces aides indirectes et bénéfiques. Merci à tous autres erdéliens si cultivés, si savants, si littéraires, si passionnés, sous la moulette de pierrassouline, non, je n’en oublie aucun. Cer celles et ceux qui ne lisent rien prennent la peine d’écrire, et de sentir leur présence pacifique ou maléfique, c quand même qq chose. Ca compte.
« Bravo, chers ami.es. pour ces aides indirectes et bénéfiques. Merci à tous autres erdéliens si cultivés, si savants, si littéraires, si passionnés, sous la moulette de pierrassouline, non, je n’en oublie aucun. Cer celles et ceux qui ne lisent rien prennent la peine d’écrire, et de sentir leur présence pacifique ou maléfique, c quand même qq chose. Ca compte. »
Vous avez une maladie incurable ? Vous nous inquiétez là ? Attendez, faisons un test : remerciez-vous également Chaloupe ?
Ah ! Jean Langoncet ! lespsilocybes. Il arrivait que vers la moitié du mois d’août, le producteur d’acide étant en vacances « aux Indes », on aille dans la montagne à la recherche de buse de vache. Merci Hofmann.
C’est quoi une moulette ?
Je suis content de vous influencer, JJJ.
Bon que manger ce soir ?
Des champignons ? 🍄
oui, ed. 18.22, chachale aussi. Je n’ai jamais pu haïr longtemps les gens qui me font pitié, tant ils se haïssent eux-mêmes. Un jour, je sais bien qu’il me faudra clarifier cela, peut-être n’est-ce pas sain comme attitude.
mais voui, D., vous m’influencez, n’en doutez point. Vous me faites tellement sourire et parfois rire que je m’aperçois allez vers des livres qui vous ressemblent, ce qui n’avait jamais été ma pente (sauf la bible de jérusalem), mais enfin, il n’y a pas que ça. Etonnant, non ? Croyez bien que vous comptez hyper sur ce blog, que votre modestie légendaire en matière de lectures SF uchroniques (dont vous pensez qu’elles ne sont pas un genre noble-), gagnerait parfois à s’étoffer de vos indispensables propos de table. Hein ! En outre, je commence à apprendre à faire de la cuisine grâce à vous et quelques autres, ce dont je n’aurais jamais eu l’idée auparavant, vu la manière déplorable dont on m’avait élevé jadis. Il y a du bon à prendre de tout le monde, voilà ce que je dis, aujourd’hui, et tant pis si demain, je nuance un brin.
Il y a donc un Alec Ginsberg qui aurait composé un cris ?!
Sans doute un cris de faim.
( Il se trouve aussi des vaches en plaine https://www.youtube.com/watch?v=lrbtoEX9nhs – des Dylan et Ginsberg plus rarement )
https://www.babelio.com/livres/Ginsberg-Howl-et-autres-poemes/47535
ok, howl et pas hawl ! Sorry. thank’s,
( mais qui se trouve du “mauvais côté de la butte” ? https://www.morrisonhotelgallery.com/photographs/6k3Ae2/Bob-Dylan-and-Allen-Ginsberg-Lowell-MA-1975 )
Si je lis le Figaro, c’est surtout parce que Marion Cotillard s’y trouve souvent en photo. Pour le reste, il n’y a qu’Ed pour croire ce qu’on lit dans les journaux.
Mais aussi Allen pas Alec :
https://blogfigures.blogspot.com/2013/06/bob-dylan-allen-ginsberg-at-grave-of.html
Bon. A 19:02 on comprend que JJJ n’est pas malade. Je suis rassurée.
« les info communiquées me paraissant douteuses »
pour le dire très précisément, je trouve ceci mesquin.
Poussière, cela ne rentre pas dans mes caractéristiques mais s’il faut appeler un chat un chat , il convient de redonner au lexique définissant la bêtise, la stupidité, l’idiotie à ses différents degrés , son ampleur et sa precision le permettent . J’ai découvert qu’il existait d’autres termes en allemand qui expriment précisément ce mot » con » . J’ignore , n’étant pas utilisatrice de cette langue s’ils appartiennent au langage populaire ou s’ils marquent une graduation supplémentaire voulue à l’emploi. Les gens corrects les boudent peut être preferant ce qui peut être révélateur soit d’un respect de l’autre quelles que soient les circonstances ou l’hypocrisie d’une politesse éduquée ou encore l’ironie de l’euphemisme.
Merci, JJJ, et bonne marche, à votre rythme !
Bérénice, Ed faisait référence à un usage courant. Et considérant sa fréquence dans le langage de tous les jours, ses occurrences, blöd convient à mon sens parfaitement pour traduire l’adjectif con tel qu’il est utilisé de nos jours chez nous.
On pourra dire que ce n’est pas une traduction classieuse, que c’est idiot, stupide etc mais à mon avis y a pas photo.
Ed dit: 10 avril 2019 à 19 h 47 min
Bon. A 19:02 on comprend que JJJ n’est pas malade. Je suis rassurée.
A moins qu’une telle concentration de bêtise ne soit tout de même un symptôme.
Déshérité, concluait votre amie, jamais à l’écrit. Surement pas à l’époque de Mann , pas si sûr actuellement. Ce mot n’appartenait qu’à la langue parlée. Sur ce qu’on découvre des différentes traductions, ils signifierait tous deux avec blöd, stupide , idiot. En revanche pour con, quelques mots s’accordant au contexte sont bel et bien référencés. Cela ne remplace évidemment pas l’expérience de la langue des usagers. Je vous accorde le bénéfice du doute bien que ma récolte ne prouve pas que les deux termes amenés soient exclusivement employés pour disqualifier ou affubler un individu d’une qualité peu élogieuse.
Bescheuert, pas desheritee, désolée. Correcteur.
Chamonix, la bêtise présumée des autres n’atteindra jamais le niveau de la vôtre. Cela et quelques unes de vos qualités rares, Dieu merci. Vous êtes unique avec comme il se doit une cour dans votre genre.
sinon il y a doof aussi mais je crois que là on vire dans le pathologique
https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/doof.html
il faut du monosyllabique pour bien rendre le truc bérénice…
Une autre entree
https://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/con#Arschloch
Une autre correspond à votre attente, poussière
https://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/con#Arsch
du Schlager pour vous, j’abandonne
https://www.youtube.com/watch?v=iP0lwK3M4W4
C’est nul.
Chaloux, je reviens sur votre intervention humoristique. JJJ en fin d’année avait donné l’ aperçu de ses nombreuses lectures, plus de 80 livres lus l’an passé de difficultés variables. Si c’est un symptôme, ce n’est pas celui de la maladie. Excusez, je n’ai pas le moral et je vous accable.
ça suffit, ce couplet,maintenant,laissez venir l’inspiration
Poussière,
Connaissez-vous le Schlagermove ?
Museum of Jewish Heritage
36 Battery Place, New York City
Robert Alter: On Translating the Hebrew Bible
Sunday, May 19, 2019
Chaloupe,
T’es à Bourmont ? Fais un détour par Grand. Tu ne peux quitter la région sans aller à Grand.
Non Ed, le Schlager me fatigue vite, je ne connais pratiquement que Anton aus Tyrol.
info@jewishreviewofbooks.com or 646-218-9045
Encore heureux ! Le Schlagermove c’est le week-end où je me barricade.
Le Schlagermove, c’est la Reeperbahn envahie par des (grand-)mères et peres de famille qui pissent et vomissent partout. Mais comment leur en vouloir ? Les Schlager ne peuvent s’écouter à jeun.
Oui, Bourmont-Grant… on a compris. À ne pas rater
une love parade du Schlager ? quel cauchemard !
21h20 je ne vous ai pas sonné, occupez vous de vos oignons. Merci. Sans gène et culotté. Puante
Vous êtes unique
On me l’a dit cet après-midi. Une très jolie femme de quarante ans, et intelligente.
Deux fois dans la même journée…
(Ed, c’est où Grand? Code postal? J’avais envie de faire un tour à Colombey et un autre à Domrémy, mais je n’en aurai sans doute pas le temps. Et à Charmes, mais il ne reste rien du bourg barrèsien, je crois).
D, tout est dans la légèreté des allusions. L’art du labour.
Attention poussière, ne parlez plus de love parade ! Rien que s’y penser…
Dede je t’accorde la palme de la lourdeur. J’étais très sérieuse. Chaloupe doit aller à Grand, ne serait-ce que par amour 😀
Mais je n’y suis pas encore, courant de semaine prochaine…
Votre charme, sans aucun doute, Chaloux, se déploie à l’approche d’une joliesse intéressante. Condition subsidiaire toutefois vos importations me paraissent sujettes à caution. Surement une affaire de correspondance.
. Sans gène et culotté. toujours vos problèmes de slip? et decorrecteur? de slip of tongue? Comment il le traduit votre correcteur malodorant ? parce que c’est passé dans un séminaire de philo ,ça, vous qui aimeriez être au parfum! et flute
Elle était ivre ?
En même temps les critères de beauté haut marnais sont très bas. Quand on voit des vaches toute la journée, le premier être d’apparence à peu près humaine fait craquer ! Ahah.
Le mémorial et la tombe du général de Gaulle sont des grands classiques, mais il suffit de traverser les villages. Celui qui sort du lot, y compris pour sa faune, c’est Grand.
slip of THE tongue
Et aloi, corrigez si cela vous chante mais vous ne n’empêcherait pas de penser : sans gène, puante et déculottée. Je s’attaquera pas le chapitre de la probité, de l’apparence, etc etc. Du crime.
Vous ne m’empecherez pas de penser: sans gène, puante, culottee. Je laisserai le chapitre probité, apparences. Le crime.
Ah. Ca bousille mon explication. Mais que voulait dire cette charmante dame ? On a envie de crier :
vous ne n’empêcherait pas de penser :ET L’ ORTHOGRAPHE ?
The Book of Genesis
http://ataways.net/dessin-de-robert-crumb/
Ed n’a toujours rien compris. JE NE SUIS PAS EN HAUTE MARNE, JE SUIS A PARIS. Cela s’est passé à Paris. Cette fille m’adore, je n’ai toujours pas compris pourquoi. Mais c’est plaisant, j’ai plus de dix ans de plus qu’elle…
Mais ton Grand, Ed, il a un code postal? Google l’ignore…
t: 10 avril 2019 à 21 h 48 min elle est
insensée et inconsistante :ça se soigne peut-être mais il vaut mieux ne pas se tromper d’adresse
t: 10 avril 2019 à 21 h 51 min
vous êtes sur que ce n’e’st pas impudique?que votre charte admet ça?
Toujours ce problème de correcteur, et à lui. Je vous laisse les toilettes sèches. Je ne me souviens pas avoir confié des » problèmes de slip » et sachez que je déteste tout ce qui est malodorant. Pour l’hygiène et le plaisir. Mon masochisme connait quelques limites.
88350
Et alii, et l’orthographe? Ah quel malheur!
En fait Chaloupe est un tombeur. On le prend pour un aigri moche comme tout mais il a son succès. Le piano sans doute.
Et alii, je n’ai semble t il pas rencontré les memes problèmes que ceux qui continuent d’alimenter votre compte. Vous appartenez à la catégorie des psychopathes en plus d’être une perverse narcissique, j’en passe par souci de la loi. Je n’aimerais par votre faute connaitre d’autres avaries .
J’oubliais, maniaque.
Alors Chaloupe je vais te confier un secret. Ca reste entre nous. J’ai tellement hâte que tu nous parle de ta virée dans mon pays que je t’y voyais déjà. Alors maintenant que j’ai compris, j’aimerais, QUAND TU SERAS DANS LE COIN, que tu ailles à Grand. Et le fameux secret est le suivant : je voulais prendre ce village pour décor d’un roman. Tu comprendras pourquoi quand tu y seras.
Un aigri? Mais pourquoi donc? Un tombeur, certainement pas, j’aurais détesté. Mais j’ai beaucoup aimé et on m’a répondu. On me répond encore. Cela dit, je suis aussi extrêmement fidèle, ce qui simplifie d’autant la vie.
Pour te donner une idée, Ed, un peintre russe que j’avais souvent croisé avant qu’on ne se parle m’a dit qu’il me prenait pour un membre de la noblesse russe. Ma première femme me disait souvent : même en bleu de travail, tu as l’air d’un notaire.
Fais une moyenne, tu m’auras sous les yeux.
Chaloux, or donc elle a 53 ans car vous 63 . Elle peut avoir 40 ans, ce qui serait pour vous une agréable compagnie à circonscrire puis séduire, annexer et quitter dans un avenir indéterminé. A moins qu’elle soit partisane des rencontres éphémères.
Béré, j’ai 52; elle 40.
UN CAS clinique intéressant sur un site du monde que je lis régulièrement:un vrai médecin et un vrai journaliste qui lui ne fait paé&s dans le psy pour se faire mousser ;au contraire porrait on dire:il met en garde :
Que retenir de ce cas clinique ? Tout d’abord, qu’un décès de cause inexpliquée, surtout chez un sujet jeune et lorsque le cadavre porte des traces de sang, ne doit pas tout de suite donner lieu à des spéculations pouvant se révéler infondées par la suite (soupçons sur le compagnon).
lisez l’histoire du cure dent , celle du jour, voilà un journaliste qui a appris à « penser » et parler en introduisant le lexique professionnel scientifique de manière appropriée, et à poser les questions à propos:pas de collection de slips dans les histoires ni de fantaisies de correcteurs ni de confusions dans ses rédactions
bonne soirée traduisez bien votre charte!
http://realitesbiomedicales.blog.lemonde.fr/
pourrait-on dire
22h15 plus personne n’obéit à vos injonctions de lecture. Bonne nuit.
Roh c’est bon. Pas la peine de te la péter . On a compris : tu as la classe et nous sommes tous des vendeurs à la criée à côté de toi.
« On le prend pour un aigri moche »
Il faut se méfier. On predn souvent les autres pour ce qu’on est soi-même.
Allez Chaloux, à qui voulez vous faire gober cela? Vous faites votre age physiquement, dedans plus encore.
C’était toi avec le serpent?
Ma pauvre Béré, les serpents que vous crachez vous mordront, et les crapauds que vous pétez vous donneront de l’urticaire.
Moi? Non, je suis la femme invisible.
t: 10 avril 2019 à 22 h 02 min
et où avez vous fait vos études? (toile à part)
parce qu’il y a des psys qui fréquentent des séminaires de traduction ou qui en tiennent un dont ils sont le « maître »
A.Berman, c’est sa femme qui était psy si je me souviens bien mais elle manquait d’intuition por le séminaire!
Chaloux dit: 10 avril 2019 à 22 h 19 min
C’était toi avec le serpent?
@Ed, sur la photo, c’était toi?
Moi je ne t’ai jamais pris pour un aigri moche, mais peut-être le suis-je tout de même.
Chaloux, je n’ai rien d’une gorgone, vous mélangez.
Est-ce que c’était toi sur la photo?
Ben non ! C’était une touriste fort courageuse.
Et alii joue les prolongations, attendons le tir au but.
Il pose la question 3 fois ? Mais qu’est-ce qu’il a ? Il se b.ranle où quoi ?
Molo Paulo.
(Moi quand je mets un bleu de travail, je ressemble à quelqu’un avec un bleu de travail).
Tant mieux.
Non, Ed, d’ailleurs je n’aime pas les blondes. Brunes à peau mate exclusivement.
je nuance un brin.
au marteau- piqueur ?
🙄😘
10 avril 2019 à 22 h 19 min
vous pouvez ajouter que certains reprochent aux autres ce qu’on leur a reproché -c’est plus que banal!
mais remarquez l’erreur d’age que vous avez relevée : cela vous donne une idée de l’attention;moi, j’ignorais tout et on ne me demande rien ,cher pianiste
Mon Dieu qu’est-ce que je vais devenir si Chaloupe n’aime pas les blondes.
Moi je n’aime pas les mecs qui aiment les blondes. La dernière fois en boîte, un Espagnol m’a dit que je ressemblais à Drew Barrymore. Pour certains, les blondes, c’est comme les Chinois en fait. Elles se ressemblent toutes. Alors non merci hein.
c’est vous qui continuez votre jeu préféré:débiner l’autre ;moi ça m’emmerde trop,bonsoir
Mais à 50 ans, avoir des critères physiques aussi précis, ça montre un manque de maturité assez impressionnant. J’espère pour Chaloupe qu’il plaisantait une fois de plus.
Bon allez, je retourne à ma traduction sur les transgenres.
Montaigne : de la traduction des autres à la traduction de soi [article]
sem-linkAntoine Compagnon
Fait partie d’un numéro thématique : La farcissure. Intertextualités au XVIe siècle
https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1984_num_55_3_2232
Toujours pas couchée ? Quelle gorgone vous faites, il faudrait vous empailler afin que morte il reste une trace de votre existence non virtuelle.
Chamonix, né trop tard
Jazzi.
L’Histoire de Régnier, Louys, et Gérard d’Houville, alias Marie de Heredia, est bien documentée dans « Le Mariage de Pausole » de Jean-Paul Goujon me semble-t-il. ses penchants saphiques via l’inévitable Comtesse Bulteau dite Toche aussi. D’Heredia, on peut dire qu’il a vendu sa fille au plus renté pour éponger ses dettes de jeu. De Régnier, que, parfait gentilhomme, il a laissé sa femme fricoter avec Louys, d’où Tigre de Régnier légitimé par Henri.
L ‘essentiel reste tout de meme l’oeuvre.Nous sommes quelques uns à penser que Régnier est souvent un bon poète doublé d’un bon fantastiqueur. (les romans,eux, se divisent entre Dix Huitièmeries pas toujours mauvaises et ratages mémorables dés qu’il s’agit de peindre son siècle!) Qu’ Heredia dans les Trophées n’est pas un mauvais poète . Que, si Claudel dit le contraire, c’est qu’il a le sonnet « lorsque la sombre croix » en travers de la gorge. Gérard D’Houville a longtemps eu un public discret et fidèle. il suffirait d’une biographie sur elle pour que sa cote remonte. Peut-être ce film aura-t-il cette vertu? Ou une recherche américaine grand public?
Bien à vous.
MC
Tiens, à propos de traduction, à paraître demain la trad. It. De Spooky Action at a Distance de George Musser, où on peut lire : « Un trou noir n’est pas un corps solide; son bord, ou horizon des événements, est une surface hypothétique dans l’espace, qui marque le point de non retour pour les objets qui tombent. »
Ma dernière expérience d’objet qui tombe c’est un crayon que je venais juste de tailler.
Le syndrome mine de plomb / graphite
https://www.youtube.com/watch?v=smpREW0d5gM
French Sculptor Claude Lalanne Dead at 93
sur le mortel cure-dent (au singulier), mort tragique !
(club sandwich mangé communément dans les clubs de voile anglais (clubs nautiques huppés) et en entrée une coupe de coktail de crevettes dans un verre à pied.
———
merci pour le remerciement à l’appel du pied vers Hugo Hugo.
De mon côté, cela s’est fait par hasard : je fus happée et consentante.
Je vais continuer par La légende des siècles. Illustrée.
Au moins, j’aurai les images.
De manière générale, ces livres illustrés, je les empile pour quand je serai à la retraite, les petits doigts de pied en éventail sur l’île Tuamotu.
Sur ce billet, heureusement que nous avons Paul Edel qui nous a parlé de Thomas Mann.
Merci Paul.
L’inventorium des injures, surtout concernant un terme issu du sexe féminin, m’y suis pas attardée.
Victor Hugo, l’inénarrable.
Bonne journée à tous,
Rose, aucun inventaire, je tentais de savoir si les allemands en dehors d’une langue châtiée pour ne pas dire castrée avaient à disposition un terme semblable à celui que nous utilisons en France pour designer un individu, un fait, une chose, un événement, un mode de pensée, un propos … nous apparaissant nul, bete, idiot, méchant, débile, injuste, injustifié, injustifiable, Illogique, affolant de bêtise, non objectif,aberrant, stupide, creux, prétentieux, nocif, dangereux, irréfléchi, etc etc selon la sensibilité des utilisateurs. C’est un terme lexique , imprécis qui comme vous le soulignez et quoiqu’il soit employé fréquemment par des personnes de tous les sexes prouvent une fois de plus le machisme des sources et bien que d’aucuns usent d’autres expressions mais plus longues et peut être de ce fait moins spontanée comme con come une bite , moins distinguée, j’en conviens.
Même les micropenis pensants en usent et abusent. Un bienfait que ce mot d’utilité publique. Voilà, ce sera tout pour ce vocable.
« L’inventorium des injures, surtout concernant un terme issu du sexe féminin, m’y suis pas attardée. »
Moi non plus, d’autant plus qu’en italien c’est le sexe masculin qui sert la volonté — ou le plaisir — d’injurier.
@janssen, vous pouvez trouver « Hawl » sur livre-rare-book, une édition bilingue publiée chez Bourgois, pour trente euros…livre-rare-book est un site créé dans les années 90 par un bouquiniste lyonnais, Pascal Charrier, ce site est un portail qui référence les stocks de libraires du monde entier et qui ne prélève aucune commission sur les ventes…
Ed, Grand dans les Vosges, l’amphithéâtre romain ? La traduction française des « Buddenbrook » en poche biblio est très mauvaise.
Merci Phil ! Enfin un qui suit.
Je l’ai lu il y a 10 ans et l’ai détesté. Je tiens peut-être un début d’explication là…
Merci M. Court. Je connaissais surtout le Henri de Régnier écrivain de Venise. Un peu plus Pierre Louÿs et pas du tout Gérard d’Houville…
Salut de nota, tu te fais rare !
une belle orthographe sur le monde:
Les 4 neurotransmetteurs responsables du donheur
@merci de nota (oui d’apparition rare, why ?…) En fait, je cherchais Howl, comme on me l’a aimablement fait remarquer. Etes donc fort aimable d’avoir respecté ma bévue, mais surtout pour votre conseil d’aider à échapper à l’amazon. P’tête que l’boncoin serait moins cher pour mon cordon…, parait qu’il y’a des gens qui y vendent des livres, selon un modèle économique plus sain que celui de feu Pablo75 aux Puces Recluses… L’boncoin, oui, c’est un site à deux seins, plus moral que l’amazone mauvais genre d’amputée.
Bonne journée aussi à notre autre amie hugolienne, tombée dans le trou noir par hasard. Et maintenant, ell’contempl ! peut plus s’en sortir. Par les égouts, à droite, à condition évidemment d’aller plus vite que la vitesse de la lumière. On nous dit que c’est scientifiquement impossib’. Mais moi je dis qu’avec l’amour de Totor, comme pour jeanval, tu peux t’échapper, pas comme une spaghettie aspirée et condamnée à l’oubli.
Non, ça s’peut pas, ce serait pas narrab’. Et l’amour, c plus fort que la lumière qui disparait dans le black hole.
On voyait des micro fissures sur son micropénis.
Mais si…, tu sais bien de qui on parle !
JJJ, sans aller dans les frais, vous trouverez Hawl ici :
Je me pose une question (qui a dit : « Tu m’étonnes ! »).
De nota, renato, Giovanni Sant’Angello et moi n’avons jamais éprouvé le besoin de nous cacher derrière un pseudo. Est-ce que les Italiens seraient plus francs que les Francs ?
Frédéric Boyer a donc choisi la forme des versets libres aux rythmes divers,
pourquoi verset et pas vers?
Bérénice, Elle vieillit plutôt bien Ali Mac Graw et elle drague toujours !
Les brunes vieillissent-elles mieux que les blondes ?
https://www.manrepeller.com/2017/05/ali-macgraw-ibu.html
Est-ce que les Italiens seraient plus francs que les Francs ?
Mon identité est facilement vérifiable et on peut sans doute jusqu’à Clovis sans trouver de sang non Francs chez mes ancêtres.
@ vous trouverez Hawl ici :
merci renato et pour Allen G… Vous êtes étonnant comme garçon italien, avec votre Hawl. J’avais vu votre lien bien sûr, mais j’ai besoin d’une traduc en français sur support papier et pour pas trop cher, si possib’, histoire de rester dans le post à passoul.
« Les brunes vieillissent-elles mieux que les blondes ? »
Physiquement, je ne sais pas, mais dans le cerveau, il y a une odeur rance chez Deneuve et BB. Donc j’ai envie de répondre « oui ».
En fait, jazzi, le matin, il pose des questions fermées dont il a déjà les réponses et je suis assez débile pour tomber dans le panneau.
ali mc graw ? c’était pas cette blonde qui mourrait d’un cancer à la fin, dans les bras de barry lyndon, non ? (excuses…, c’est mon 1/4 d’heure d’atelier-mémoire, et j’ai pas le droit d’aller vérifier).
Suis présentement consterné par le choix des Israéliens, une fois de plus. Mais on me dit que j’ai pas le droit d’avoir une opinion à ce sujet, n’étant pas. Je la dis quand même, en n’espérant rien relancer qui soit susceptible d’aller encore au point G. J’ajoute être également consterné par ce que la France a produit en Lybie avec les Sarko-BHLévy en 2011 (et on va le voir maintenant !), avec les Mitterrand-Fabius en 1994 au Rwanda (plus jamais ça ?), et avec les macronistes d’en avant-marche pour se délester d’ADP et toucher 10 millards qui seront jamais reversés aux nécessiteux, vu « xfaut éponger la dette ». Ras le bol. Alors, évidemment l’archipel des Tuamotu, OK, mais comment y aller pour oublier ? à la rame peut-être ?
Malade d’un summum d’indignations, des bêtises sans doute. Tant mieux, si vous êtes à l’aise dans vos basquettes, vous autres !
Mes questions peuvent vous paraitre fermées, Ed, mais je reste très ouvert !
Ali Mac Graw est une brune de chez brune, JJJ. Oui, c’est bien elle qui meurt d’une love story, mais moi, dans mon souvenir, d’une Mac l’autre, elle reste surtout la femme battue de Steve Mac Queen !
JJJ, j’avais cru comprendre que vous le cherchiez en VO ; « Hawl » c’était un joke sur votre première entrée en jeu, j’aurais dû l’encadrer avec des guillemets, mais peu importe…
Julian Assange arrêté par la police britannique dans l’ambassade de l’Equateur. De quoi est-il coupable ? D’avoir divulgué des documents qui montraient la malhonnêteté des Américains. C’est un grand démocrate, un héros des temps modernes, un homme nécessaire : j’espère que nous allons tous nous révolter, et que Julian Assange sera également soutenu par nos gilets jaunes. C’est le même combat ! Polanski est en cavale, Julian Assange est sous les verrous, et va probablement être extradé aux USA, où il sera peut-être condamné à mort ou à la prison jusqu’à la fin de ses jours : cherchez l’erreur.
Un héros de notre temps :
Dear JJJ, Aéroport de Paris, les deux mais surtout Ch. De Gaulle, est dans un état déplorable. Aucune possibilité décente de boire une coupe de champagne comme à Zürich, saleté et transports vers Paris épouvantables. La privatisation ne sera pas un luxe. Luxe et lowcost, c’est l’avenir déplorable mais faut y aller avant que les Chinois rachètent et mettent tout le monde d’accord.
L’avantage des mauvaises traductions, ED, est d’inciter à lire les vo. Dans l’édition biblio, toutes les traductions du dialecte des « Buddenbrook » sont ratées.
Les Anglais, c’est le Brexit, mais c’est aussi l’arrestation de Julian Assange. Aujourd’hui est un jour de honte pour le Royaume-Uni !!!
« Les Oiseaux de passage » de Cristina Gallego et Ciro Guerra, réalisateurs et scénaristes colombiens.
Un film magnifique, qui se déroule chez les indiens de la Guajira dans les années 1960-80.
Il se trouve que par le plus grand des hasards, au printemps 1986, j’ai pu passer 48 heures dans une réserve du même genre, à la frontière de la Colombie et du Venezuela.
J’y ai retrouvé la confirmation de cette impression d’étrangeté et de danger dont je n’avais pas vraiment eu conscience à l’époque.
Invité à découvrir son pays par un ami Colombien, nous avions alors sillonné la Colombie, trois semaines durant, tandis que le pays était en plein conflit avec les cartels de la drogue…
Ce serait trop long (trop douloureux pour moi de relire les deux cahiers de notes, jamais relues, que j’en avais rapportées) de vous raconter comment je me suis trouvé là, pourquoi et avec qui, mais j’avais alors été plongé dans une situation qui est proche de celle évoquée par le film.
Il faut le voir pour le croire !
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577989&cfilm=260353.html
« Aucune possibilité décente de boire une coupe de champagne comme à Zürich »
Comme on dit dans la langue de Goethe, Was hast du denn für Probleme?!
Ah non Les Buddenbrooks, en allemand ou en chinois, je ne le rouvrirai plus jamais. Dommage pour le dialecte, il m’aurait intéressée puisque je le cotoie un peu tout de même.
Peut-être lirai-je La Montagne magique. Vous avez tous détesté la chronique de Clopine ? Eh bien tremblez, je ferai pire !
Connaissez-vous le vallenato ?
Moi, au grand étonnement de mon ami Colombien, qui trouvait ce genre un peu populaire, j’ai tout de suite adoré. Dès que j’en entendais, je me mettais à trémousser !
https://www.youtube.com/watch?v=AlqLeugr9xk
Paul Edel ne parle jamais de Julian Assange, il doit être jaloux de son succès. Il devrait s’ y intéresser au lieu de perdre du temps à lire Sollers.
Et vous Jacuzzi, aimez-vous Julian Assange?
@ Luxe et lowcost, c’est l’avenir déplorable mais faut y aller …
Et j’en restions pantois… comme si 1 – les aéroports étaient des lieux de vie où le don périgonon avait sa vocation à y couler à flots dans des coupes en bacarrat ; et 2 – comme si les fonds de pension chinois n’allaient pas, de toute façon, rafler la mise…
Ergo, voyions point en quoi la propreté du lieu serait mieux assurée à l’avenir, quand on connait un minimum la structure des marchés déjà privatisés de la sous-traitance du nettoyage en cascade qui sévit à CDG, au risque du délit de marchandage.
Enfin brefl…, la rdl ne va pas organiser un sondage pré-référendaire à ce sujet, vu qu’on aurait à y engranger de drôles de surprises !
Les Oiseaux de passage, ça n’a pas l’air mal – bien que je n’aie pas apprécié grandement le précédent film de ce cinéaste, le Serpent, je crois. la critique n’est pas très bonne, elle fait référence au Parrain de Coppola, comme si le réalisateur colombien n’avait pas été beaucoup inspiré par lui-même. On va voir un film colombien, pas américain. Je me méfie des avis de Jacuzzi, souvent très léger dans ses jugements. Est-ce vraiment un film à voir ?
@ il y a une odeur rance chez Deneuve et BB
… un moment, votre humour (?!) féministe « anti vioques » n’est plus tolérable, je vous le dis tout n-ed. Aucun mec n’aurait jamais osé écrire ça, désolé, mais après l’indigne arrestation d’Aussange par la police du Brexit, je supporte pas trop… Ca va m’passer.
J’ai vu la bande-annonce du prochain Téchiné, avec une Catherine Deneuve dont le petit-fils s’est converti à l’Islam et s’apprête à partir pour le jihad : ça promet !
C’est titré « L’Adieu à la nuit », alors que l’on entre plutôt dans l’obscurité et l’obscurantisme !
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582896&cfilm=262092.html
JJJ,
Vous n’avez rien compris, mais ce n’est pas grave. En revanche, il faudrait passer vos nerfs sur quelqu’un d’autre car je n’ai rien dit de sexiste ni d’anti-vieux. Je ne suis pas responsable de l’arrestation d’Assange hein.
J’attends toujours ton jugement sur « Y’a du soleil » de Ruffin, le film 100% gilets jaunes, Delaporte !
Fenoglio — Pavese :
https://blogfigures.blogspot.com/2011/06/fenoglio-traduttore-di-pavese.html
L’odeur rance de CD et BB n’est ni dans la blondeur, ni dans l’âge : elle se dégage juste de leurs propos, surtout pour la seconde d’ailleurs. M’enfin la première n’est pas en reste de conneries réactionnaires…
« Catherine Deneuve dont le petit-fils s’est converti à l’Islam »
Dommage qu’il ne se soit pas converti au féminisme. La grand-mère effarée par les convictions de son petit-fils n’aurant pas été un rôle de composition pour elle. Ca lui aurait évité d’être grotesque, comme dans tous ses films (ex : son « Jean-Baptiste, il est encore temps que notre histoire ne commence pas » à pisser de rire dans le film Indochine). Bref. On a les monuments nationaux qu’on mérite.
Oui, Delaporte, les références des critiques sur le film colombien sont très approximatives. Rien à voir avec la mafia new-yorkaise, mais avec un code de l’honneur ancestral des plus archaïques et des plus redoutables…
« odeur rance de CD et BB n’est ni dans la blondeur, ni dans l’âge »
Sans dec ! Clopine, on en est où au niveau des portes ouvertes à enfoncer ? Je répondais à la question volontairement idiote posée par jazouille la fripouille.
Faut tout expliquer ici, en fait.
« la question volontairement idiote posée par jazouille la fripouille. »
Dit-elle, après avoir répondu positivement à la question, hi hi hi !
Mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes dans une nouvelle ère, l’ère post #MeToo. Les masques tombent et les victimes relèvent la tête.
« L’humoriste Pierre #Palmade a été placé GAV dans une affaire de viol présumé sur un jeune homme, ainsi que pour usage de produits stupéfiants. «
Jazzi, si vous pensez que je pense (désolée hein) sérieusement que les blondes vieillissent moins bien que les brunes, je ne peux plus rien faire pour nous deux. Je ne peux pas remonter d’un niveau si bas dans votre estime. Tant pis !
ED, si je puis, parvenez au 10 ème du résultat de toutes les sommes de Catherine Deneuve et il vous serait possible d’en parler munie de vos emportes pieces. En attendant, vous me paraissez un tantinet désoeuvrée et en mal de notoriété . Il vous reste à vous gargariser de vos diplômés inutiles, de votre statut de traductrice qui n’a pas déniché la destination idéale. C’est bien peu en retard de la carrière de cette femme célèbre .
Mauvais esprit cancanier, quand tu nous occupes, il nous faudrait en un reflexe salvateur tirer la sonnette d’alarme.
ed, 16.06 : j’allais donc vous faire crédit d’avoir mal interprété, vu le secours de CT à votre rescousse… Mais en fait vos propos, via une réponse opportune de jzman, montrent qu’ils disaient bien ce que j’ai compris, même si je n’avais pas pigé l’ironie de la réponse… Et cela reste juste pas corrèque du tout !
Quoiqu’il en soit, tout le monde passe son temps à se justifier avec la dose de mauvaise foi qui sied à chacun.e pour se rattraper.
Et je bats ma coulpe… car je n’avions point à vous faire payer mon atrabile sur l’affaire aussange.
Quant à CT qui nous explique pourquoi Deneuve et Bardot ne puent pas des aisselles ou de la gu.., mais bel et bien leurs croyances réacs, je veux bien l’entendre, mais cela n’excuse rien, désolé, ma bonne dame.
Du coup, l’être asexué et agenré que je m’efforce d’être sur ce point vous demande obstinément : qu’est-ce qui est le plus grave pour une femme, telle que vous en représentez ici deux éminents spéci-mens : de puer de la gu. et du con ? ou de puer des idées ? Hein, hein ?….
…. Alhors, qu’on vienne pas emm.erder les mecs avec ça, OK ? les filles, les meufs, les humaines, les bien pensantes, les genrées, comment faut-il vous appeler ? Vous n’êtes pas mieux qu’eusses, parfois et même bien souvent… Des saintes patouches, pt’êt bin, qui foutent la honte aux autres erdélien.ness moyens !
Ed, Clopine, me semble-t-il, répondait à JJJ et venait à votre secours. Mais non, vous n’êtes pas tombée très bas dans mon estime.
Bien sûr que ces généralités sur les blondes et les brunes sont sans objet. Mais j’avais à l’esprit une anecdote que je m’en vais vous raconter.
Quand nous nous sommes engagés sur la piste désertique pour rejoindre la réserve des indiens Guajani, juste après être descendu de l’autocar, une indienne, à la fine silhouette et aux longs cheveux noir de jais nous précédait. Quand nous l’avons dépassée, j’ai pu voir que celle que je prenais pour une jeune fille était une femme hors d’âge au visage ridé comme une vielle pomme ! M’étonnant sur sa chevelure auprès de mon ami Colombien, celui-ci me déclara que les Indiens ne blanchissaient pas…
Ce n’était que le début de mes surprises. Celle-ci disparut derrière un buisson et s’engagea sur un autre chemin. Peu après nous vîmes la carcasse d’un hydravion qui s’était écrasé la veille de notre arrivée. Plus tard, j’appris que les autochtones étaient à la recherche de son pilote, qui avait survécu à l’accident, un gringo venu chercher de la marchandise illicite. C’est alors que, seul blond aux yeux clairs dans les parages, j’ai commencé à m’inquiéter…
Pour la suite, mieux vaut aller voir le film ci-dessous mentionné !
» j’allais donc vous faire crédit d’avoir mal interprété, vu le secours de CT à votre rescousse… »
« Ed, Clopine, me semble-t-il, répondait à JJJ et venait à votre secours »
Trop de quiproquos. Restons-en là les amis !
Jean Langoncet dit: 9 avril 2019 à 21 h 47 min
Extraordinaire dessin d’enfant de 1948 ! Les bras devenus encombrants… Ce face à face est époustouflant. Merci ! :
“A ‘social situation’ as depicted by a young child.” Psychological atlas. 1948. »
https://66.media.tumblr.com/3fba7f11f5e544e59842ca71a1a85e77/tumblr_p1fc8uZ4Gy1tn7avwo1_1280.pnj
« J’attends toujours ton jugement sur « Y’a du soleil » de Ruffin, le film 100% gilets jaunes, Delaporte ! »
C’est une série de témoignages souvent émouvants de ces Français qui ont des fins de mois difficiles, bien qu’ils travaillent dur. Rien de spécial à en dire, sauf que j’ai été voir ce film un samedi soir. Il y avait plein de gilets jaunes dans la salle, qui vibraient aux images du film, qui rouspétaient (en voyant des images de Macron). Le spectacle était dans la salle. Je me disais qu’un jour, quand sera instituée et votée démocratiquement l’abolition légale du travail, ces gens seraient enfin heureux, et qu’ils le méritent car ce sont de braves gens. Le film de Ruffin dit bien la nécessité impérieuse de ce mouvement social, et fait comprendre pourquoi les gilets jaunes vaincront. C’est Macron qui périra !!!
« Oui, Delaporte, les références des critiques sur le film colombien sont très approximatives. »
Merci pour cette précision. Je vais aller voir ce film, sans doute samedi soir. J’ai envie de contempler ce monde sud-américain aux couleurs ocres. C’est aussi un monde qui essaie de survivre, comme disait Derrida. On oublie Derrida, pourtant c’était un philosophe formidable. On peut relire Spectres de Marx, avec Marx et plein d’auteurs comme Shakespeare qui ont des choses à dire toujours sur notre vie contemporaine, et pourquoi nous devons survivre, comme les gilets jaunes. Certains privilégiés, certains oisifs, notoirement homosexuels, et esthètes par cinéphilie, se la coulent douce à déambuler dans Paris et à écrire des « goûts de » : mais ce n’est pas le cas de tout le monde !!!
« C’est une série de témoignages souvent émouvants de ces Français qui ont des fins de mois difficiles, bien qu’ils travaillent dur. Rien de spécial à en dire »
Sur le fond, je suis d’accord avec toi, Delaporte. Mais sur la forme c’est plutôt le degré zéro. Un film de potaches, qui est au documentaire cinématographique ce que le travail du photographe de mariages est à l’art photographique ! Ruffin, un peu trop intrusif à mon goût, fait le tour des ronds-points, parlent avec les gilets jaunes présents puis en suit un ou une chez lui, chez elle. Une démarche systématique, du Nord au Sud de la France, avec une image misérabiliste, permettant à Ruffin de dérouler son couplet politique…
Mon grand étonnement, c’est que l’ensemble de la presse : Le Monde, les Inrock, Libé, Télérama bien sûr et même les Cahiers du cinéma ont mis quatre, voire cinq étoiles à ce film ! Un jugement qui traduit plutôt le malaise des bobos parisiens face à un monde et un problème qu’ils découvrent. Mais en aucun cas un travail de critique !
derrida ?
donner le lien
https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1306021008.html
« C’est bien peu en retard de la carrière de cette femme célèbre . »
Est-ce que la célébrité justifie que l’on dise n’importe quoi ?
derrida (lien communiqué)
. Rien ne revient jamais à du vivant, au porteur du nom – tout ce qui revient revient seulement au nom. Et pourtant d’autre part, nous sommes tous hantés par un désir testamentaire : que quelque chose survive et soit transmis. Hériter, c’est témoigner, c’est réinterpréter, c’est traduire, c’est maintenir en vie ce dont on hérite et qui reste en partie étranger et secret. L’héritage n’est pas laissé intact : il est transformé, relancé.
La survie est toujours aporétique, ambigue. Du côté de la permanence, de la répétition d’une substance, d’une identité, elle insiste sur le cycle de la vie, qui est répétition et mort au-delà de la vie. Du côté de la restance, de l’itérabilité, de l’altération de la marque, elle ouvre la possibilité du surgissement de la « re-marque » qui transforme ce qu’elle répète. Toute sur-vie, même à partir du même matériau biologique (clonage), altère, modifie, décale. Tout nouveau contexte ruine l’identité.
Certes non, renato, mais est-ce que la célébrité doit vous interdire de dire ce que vous pensez ?
« Du côté de la restance, de l’itérabilité, de l’altération de la marque, elle ouvre la possibilité du surgissement de la « re-marque » qui transforme ce qu’elle répète. »
Là, et Alii, il conviendrait de fournir un glossaire !
Il suffit de ne pas penser n’importe quoi, Jacques.
jazzi,
Elle a parfaitement le droit de s’exprimer, tout comme les gens ont celui de dire qu’elle enchaîne les co.nneries depuis quelques années. On ne va pas en faire la liste ici, elle est connue de tous.
« Vous avez détesté la chronique de Clopine? Je ferai pire ».
Il est des sommets, quels qu’ils soient, auxquels on ne se mesure pas…
suite à Derrida (le lien explicite le lexique!)
Psychanalyse et traduction : voies de traverse — L’auteure présente les diverses voies
d’approche abordées dans cette livraison, de la traduction du texte psychanalytique,
aux transferts du traducteur freudien, en passant par la psychanalyse en traduction
(lorsque la psychanalyse se fait elle-même opération traduisante entre les discours). À
partir de réflexions en forme d’associations libres, elle interroge également certaines
positions de Jean Laplanche, J.-B. Pontalis et Jacques Derrida qui éclairent les
échanges se produisant entre psychanalyse et traduction.
https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/1998-v11-n2-ttr1489/037332ar.pdf
@ le malaise des bobos parisiens face à un monde et un problème qu’ils découvrent
Téh !? c’est une catégorie qui existe ast’heure, les bobos parisiens ?…
Si je comprends bien, suffit de sentir ne pas penser comme les medias dominants pour qu’ils se mettent à représenter une catégorie sociale que par ailleurs on nie ou dont on vous explique qu’on ne sait pas ce qu’elle est ! Bah !… Plaisante justice, qu’une rivière ou une montagne borne, etc.
@ « On ne va pas en faire la liste ici »…,
Mais si justement : établissez la donc, cette liste des horreurs de C. Deneuve, plutôt que d’insinuer des salades ! A moins que vous n’évoquiez celles de BB. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ?
@dlp et alii, « Spectres de Marx » de Derrida ?… Une féministe black US y a trouvé une source d’inspiration en fabriquant le concept « d’hauntologie ». Entre nous, pas sûr qu’elle ait été bien inspirée !
https://journals.openedition.org/champpenal/9168
« insinuer des salades »
JJJ, à un moment donné, c’est où on est de bonne foi et on discute, où on trolle et je vous ignore comme bérénice et delaporte. À vous de voir. Perso, ca me fait moins de lecture.
https://www.youtube.com/watch?v=mDFk-1uz_bA
https://www.youtube.com/watch?v=7-6uvFPkWng
+ la tribune du monde sur la liberté d’importuner, parce que les frotteurs sont de pauvres êtres souffrant de misère sexuelle.
Donc on va pas tergiverser pendant des heures. Si vous me demandez une énième fois de me justifier et m’accusez d’affirmer des choses qui n’existent pas. On arrête tout.
Pour BB je retire. Quand elle critique les musulmans et leur fête moyenâgeuse de l’Aid, elle est tout sauf rance. Mea culpa.
« insinuer des salades »
Défense de Weinstein et de Polanski. Si vous ne le saviez pas, c’est que vous viviez sans doute dans une autre planète ou ne souhaitez pas savoir, ce qui revient au même.
On va pas tergiverser. Ou bien on discute entre gens de bonne foi, ou vous traitez de menteurs tous ceux qui ne vont pas dans votre sens, et j’abandonne. C’est comme vous voulez.
je suis malade, je n’arrête pas d’éternuer,je veux me reposer bonsoir
je suis malade bonsoir
Jacuzzi, je suis d’accord avec ce que vous dites sur ce film. C’est dommage que les gilets jaunes n’aient pas donné lieu à un documentaire vraiment travaillé et pensé. Le film de Ruffin est une improvisation bonhomme.
Sur Assange, événement important, la déclaration de son avocate :
« Jennifer Robinson, l’une des avocates de Julian Assange s’est exprimée devant les journalistes jeudi soir, quelques heures après l’arrestation de Julian Assange:
« Cela instaure un dangereux précédent pour tous les médias et les journalistes en Europe et ailleurs dans le monde. » a-t-elle déclaré. « Ce précédent veut dire que tout journaliste peut être extradé pour être poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié des informations véridiques à propos des Etats-Unis », a-t-elle estimé.
Elle a également confirmé le fait que Julian Assange allait s’opposer à la demande d’extradition venant des Etats-Unis. »
Je croyais que les USA étaient une grande démocratie ! Je suis fort déçu.
Les USA n’aiment pas qu’on divulgue des informations véridiques. Ils préfèrent les fake news. Ils ne veulent pas d’un nouveau Watergate !
Angela Merkel Purges Artworks by Emil Nolde From Her Office as a New Exhibition Explores His Nazi Past
The exhibition confronts the artist’s long hidden anti-Semitism.


1350
commentaires