
Vers un humanisme numérique
Convenons qu’il ne va pas de soi d’accoler deux mots a priori aussi antinomiques que « humanisme » et « numérique ». On se frotte les yeux. On doit à l’historien des religions Milad Doueihi, l’un des rares à avoir entrepris une anthropologie de l’homo numericus dès sa naissance, d’avoir répandu l’expression dans le public par ses essais et ses articles. Il y est revenu à l’occasion d’une conférence prononcée il y a un peu plus d’un an et reprise dans un bref livre intitulé Qu’est-ce le numérique ? (55 pages, 7 euros, Puf). Un titre qui sonne hélas un peu comme « Le numérique pour les Nuls » et qui, paradoxalement, réussit à être réducteur tout en ouvrant trop largement le compas. Quelques rappels y sont certes utiles : la distinction entre numérique et informatique trop souvent mêlés ; la notion de partage comme idée-maîtresse ; la conscience que la terre habitée chère à Lévi-Strauss n’est plus ce qu’elle était tant elle s’élargit désormais à une spatialité hybride et en mouvement ; l’idée que le numérique a finalement réussi là où la démocratie a échoué, à savoir exporter partout dans le monde un modèle parfaitement occidental (valeurs du document, concept de patrimoine et d’archive, icônes etc)… Soit, mais encore ?
Si ce petit livre offre matière à réflexion, c’est aussi parce qu’il revient sur l’humanisme numérique. Si nous sommes effectivement, comme l’auteur en est convaincu, dans une période de transition, et si nous ne sommes qu’au début d’une période de mutation, il est indispensable de penser cette transformation culturelle. L’humanisme numérique considère que la technique est une culture. Aux yeux de Milad Doueihi, le danger ne vient pas tant des détracteurs de la Toile, dont les raisonnements sont souvent trop archaïques pour être durablement commentés ; ils ne se rendent pas compte que Big Brother, ce n’est pas le numérique mais l’informatique, et qu’il est bêtement réactionnaire de faire tout un Golem de la lecture numérique, mais passons. Le danger, ce sont les écoles transhumanistes. Il les présente comme les prophètes d’une nouvelle humanité, partisans d’une sorte de cyber New Age, qui s’abritent derrière le concept de « Singularité » pour appeler de leurs vœux une convergence plus radicale de l’Homme et de la machine. Inutile de préciser qu’ils placent au-dessus de tout le pouvoir de la science. Doueihi nous invite à nous méfier de la dimension religieuse de ces transhumanistes 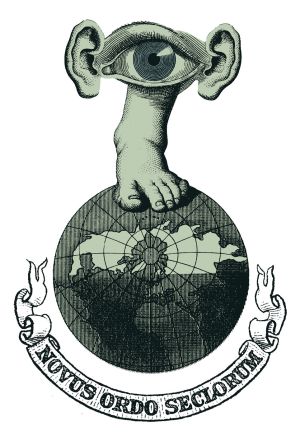 américains, qui se réclament des Lumières (Enlightenment 2.0) pour mieux oublier l’Histoire et proposer un système qui n’a pas seulement le goût et la couleur du polythéisme. Même Vinton Cerf, l’un des co-fondateurs de l’Internet, allait dans ce sens il y a quelques jours dans une interview aux Echos en plaçant tous ses espoirs pour l’avenir dans l’intelligence artificielle –et l’on veut croire que son haut poste chez Google n’y est pour rien.
américains, qui se réclament des Lumières (Enlightenment 2.0) pour mieux oublier l’Histoire et proposer un système qui n’a pas seulement le goût et la couleur du polythéisme. Même Vinton Cerf, l’un des co-fondateurs de l’Internet, allait dans ce sens il y a quelques jours dans une interview aux Echos en plaçant tous ses espoirs pour l’avenir dans l’intelligence artificielle –et l’on veut croire que son haut poste chez Google n’y est pour rien.
On voit par là qu’il est urgent de repenser nos rapports avec la mémoire, effet majeur de la révolution numérique. La conserver, l’interpréter, l’exploiter, la diffuser : il faut tout revoir. Pour y parvenir, l’auteur invite à bousculer la dualité mise en place il y a plus d’un siècle par le sociologue Max Weber entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Il propose une troisième voie adaptée aux nouveaux temps, mais ne l’explicite pas. Aussi, lorsque je l’ai récemment rencontré à l’occasion d’un entretien sur le sujet à France Culture, je l’ai naturellement pressé d’en dire davantage. Sa réponse tint en deux mots : « confiance sociale ».
Le phénomène de l’humanisme numérique est d’autant plus passionnant à observer qu’il est né et qu’il grandit sous nos yeux. Evoluera-t-il comme l’humanisme autrefois ? Un bel article vient de paraître dans la revue des Annales (juillet-septembre 2013, No 3) qui ouvre des pistes. S’appuyant sur une considérable bibliographie internationale, Clémence Revest (Ecole française de Rome) y raconte de manière aussi dense que lumineuse comment au tournant du XVème siècle (les années 1400-1430 en Italie), l’humanisme, aspiration à un retour de l’Antiquité, est devenu l’Humanisme. Culture alternative conquérante puis modèle dominant mis en pratique par des dominants, il ne s’est pas concrétisé à travers des institutions propres, mais dans un mouvement. C’est le mot-clé : « mouvement » avec ses corrélatifs « masse », « agrégation », « affiliation ». Tout à sa passion de l’imitatio Ciceronis, Pétrarque avait hâté la résurrection de l’éloquence. L’empreinte fut durable. On trouve d’ailleurs sous la plume de Proust épistolier, et peut-être même sous celle du romancier, le charmant néologisme « pétrarquiser ». Cela dit, Clémence Revest ne se demande pas qu’est-ce qu’un humaniste, mais qu’est-ce qu’un humaniste peut être. Certainement pas un citateur des Anciens. Non un imitateur de Cicéron mais un autre Cicéron.
En relisant cette étude sur une figure éthique de l’homme de savoir, on se dit que l’homo numericus lettré gagnerait à en méditer les leçons. « Si l’humanisme est né, c’est d’abord parce que ses partisans l’ont eux-mêmes proclamé » assure Clémence Revest. Il est permis d’en faire autant à condition de se garder des écoles, de se méfier de toute récupération académique visant à encadrer la chose, et de privilégier le mouvement. C’est déjà le cas sur les réseaux où l’entretien permanent (textos, facebook, twitter etc) est à mettre en parallèle avec la conversation épistolaire que les auteurs de la Renaissance concevaient comme « un signe visible de l’amitié ». Si ce mouvement a pris corps et s’est fait récit, c’est surtout parce que ses acteurs partageaient un même imaginaire au sein de leur aventure collective. Conservons les valeurs héritées des humanités, elles-mêmes fruit d’un plus ancien héritage, non pour les dupliquer dans un souci d’imitation, mais pour les adapter et en faire un rempart contre la religion de la science, la soumission à la technique et le culte de la machine.
(« Illustrations de R. Kikuo Johnson et de Max »)
898 Réponses pour Vers un humanisme numérique
. Or, travailler ensemble demande souvent de casser les rapports d’autorité… ce que l’entreprise a bien du mal à faire.
http://www.internetactu.net/2013/10/25/industrie-et-nouveaux-bricoleurs-faire-ensemble/
« faire les choses en douce pour ne pas être reconnu pour ce que l’on est : un misanthrope qui déteste les femmes et qui est très attiré par les hommes… »
Hihihi…
Euh, christiane, vous ne poussez pas un peu, là?
(Les affects et l’imaginaire, objets de l’humanisme numérique)
Croyez moi ou pas, Daaphnée est une femme brune très sexy.
Maintenant… Elle n’aime pas trop ses frangines, ça c’est sûr.
(Une peu reine des abeilles, n’est-ce pas Daaphnée?)
Nous, on est cool.
Les femmes sont des arbres ravissants ou des écorces puissantes, et nous les mecs, il nous arrive de penser qu’on est des petits doigts.
je crois que là, sur ce coup, avec ce livre de 55 pages à 7 euros nous avons touché le fond du fond du degré zéro de la pensée pensante.
à la question : pourra-t-on descendre encore plus bas ? la réponse est oui.
Ah bon Hamlet, je comprends mieux votre définition de 20h24
u. !
vous tombez à pic !
figurez-vous que nous nous demandions à quoi pouvait bien ressembler un humaniste digne de ce nom.
certains l’imaginaient roulant à vélo, d’autres prenant plutôt le taxi.
certains le voient vêtu d’un manteau, portant un chapeau, un parapluie et une petite sacoche à la main avec à l’intérieur des livres de le Clezio.
et d’autres le voient plutôt en jean, ou survêtement et basket, genre sportif ou lecteur des inrocks abonné aux inrocks et à médiapart.
en un mot nous nageons en pleine confusion…
« u : Croyez moi ou pas, Daaphnée est une femme brune très sexy. »
u. désolé mais sur ce coup il faut laisser tomber la gaudriole, sachez que l’humanisme est une chose éminemment sérieuse.
je suis désolé mais l’humanisme exige de nous que nous fassions quelques sacrifices.
L’humaniste?
Chapeau pointu, natte, longue moustache, pyjama en soie, ombrelle.
Facile.
Depuis 5 000 ans.
n’est pas humaniste qui veut.
« je suis désolé mais l’humanisme exige de nous que nous fassions quelques sacrifices. »
Is Dasein gendered?
Question d’Américaine.
Prudence de rigueur.
« faire les choses en douce pour ne pas être reconnu
quel passif pour cette passion
et pour ne pas se reconnaître !
voici ue cit
u., un humaniste chinois ?
je vous assure que nous essayons d’aborder cette question sérieusement.
j’y crois pas : un humaniste avec un chapeau pointu…
sachez que le dernier humaniste en date vivant sur ce continent portait des culottes coutes et des chaussettes hautes en laine à pompons tricotées par Elfride et vivait dans une cabane en bois, il suffisait de la croiser dans la rue pour se dire : voilà un vrai humaniste !!!
un chapeau pointu et des nattes… on croit rêver.
une citation que je ne préciserai pas
« je les ai insultés si fort qu’ils auraient dû se donner la mort eux-mêmes, de honte et d’humiliation ; un turc aurait agi ainsi, mais parce que Bussy est un Franç
( Elle n’aime pas trop ses frangines, ça c’est sûr.
Pas du tout, U.!
D’ailleurs ce ne sont pas mes frangines, non .
Elles seraient beaucoup plus vives . )
« le dernier humaniste en date vivant sur ce continent portait des culottes coutes »
Des culottes courtes ou des culottes scoutes?
Il y a une nuance, bon dieu.
mais parce que Bussy est un Français, il a juste reculer .Nous ne pouvons pas nous racheter de tout cela.
une date? 1757
Des culottes courtes avec des nattes, c’est extrêmement suspect.
Je vois la confusion s’épaissir ..
reculé (excuses)
« reculé (excuses) »
Mais non.
On a entendu pire.
Convenons qu’il ne va pas de soi
ah bon? et si je m’étonne qu’il y ait des gens pour lesquels il y ait quoi que ce soit qui aille de soi , ça va de soi, ou de qui ?
une spatialité hybride et en mouvement
C’est ma Josette toute crachée
suffit juste de lire les journaux
rien que des vassaux de la reine de SABA
Oct. 25, 2013 — At least 441 new species of animals and plants have been discovered over a four year period in the vast, underexplored rainforest of the Amazon, including a monkey that purrs like a cat.
proposer un système qui n’a pas seulement le goût et la couleur du polythéisme.
Alors là, je suis preneur. Rien de plus assommant, de plus monotone que le monothéisme. Vive Vénus ! Vive Moloch ! Vive Cybèle ! Vive Odin ! Vive Toutatis ! Oui au polythéisme transhumain, transculturel, transnational, transtextuel !
bon, ça sent toujours la ligne de coqs en poulailler commandés par quelques poules, et les oeufs cachés sous les culottes scouts ne sentent pas l’air frais
C’est déjà le cas sur les réseaux où l’entretien permanent (textos, facebook, twitter etc) est à mettre en parallèle avec la conversation épistolaire que les auteurs de la Renaissance concevaient comme « un signe visible de l’amitié ».
A lire des conneries de ce calibre, on va finir par croire que Finkielkraut est un génie
ça c’est de l’identifiacation
Contaminé par un parasite du bétail, un biologiste s’extrait un ver de la joue
nouvel obs
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20131021.OBS1946/contamine-par-un-parasite-du-betail-un-biologiste-s-extrait-un-ver-de-la-joue.html
Dans le débat entre P.Assouline et M.Doueihi cette remarque sur la mémoire est passionnante. (etc etc; par Christiane à 12h18)
Dans l’exercice du cirage de pompes, Christiane semble absolument imbattable.
Mouais… Quelle bouillabaisse, indigeste. (Philippe régniez à 0h35)
C’est fou ce qu’une bouffée de lucidité peut faire du bien
pour ne pas être reconnu
les potiches sont parfois aussi postiches, la différence c’est le mélange recto/verso du collant/piquant
bon, quand on n’aime pas ça fait très vite moins humaniste
ayant lu dans le monde, il y plusieurs années un article, voici un entretien sur la toile
selon le philosophe Jean-Michel Besnier, qui n’y voit, lui, aucune fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à devenir posthumains à condition qu’une prise de conscience massive survienne. « La fascination pour les techniques est le revers d’une mésestime de soi et de l’humanité, affirme-t-il. On ne supporte plus la vieillesse, la maladie et la mort, et surtout pas le hasard de la naissance. Se réconcilier avec notre finitude, accepter nos faiblesses…, c’est le prérequis pour sauver l’humanité. »
Ce qui énerve vite Bouguereau car cela lui rappelle le temps des cerises.
D. je ne voulais pas raser les beliebers !
On ne supporte plus la vieillesse, la maladie et la mort, et surtout pas le hasard de la naissance. Se réconcilier avec notre finitude, accepter nos faiblesses…, c’est le prérequis pour sauver l’humanité. (J.-M. Besnier)
Mais si, mais si. Bien obligés. C’est qui, « on » ? C’est tout le monde et c’est personne. S’extraire des platitudes à la J.-M. Besnier, c’est le prérequis pour sauver la philosophie.
Alors, U. je remplace par misogynie (que vous approuvez semble-t-il.)
John Brown dit: 26 octobre 2013 à 21 h 32 min
C’est M.Doueihi qui dit cela, pas P.Assouline…
il y a bien assez de pages de philosophes et critiques professionnels sur on
m’intéressent dans les histoires comme celles du nématode leurs relations avec « la littérature », et q’elles sont plus fortes que la comédie du « consultez un psy «
la nouvelle plate-forme et l’heure d’hiver
J’admettrais tout à fait que ça vous en bouche un coin.
« J’admettrais tout à fait que ça vous en bouche un coin. »
Moi, ça me troue le cul, D. !
C’est en effet cette tension entre intériorité et extériorité que l’auteur prend en compte quand
il décrit l’hybridation opérée par le numérique. Hybridation du réel et du virtuel, d’anciennes et
nouvelles pratiques, de concepts et d’objets : « le numérique représente le triomphe de
l’hybridation généralisée aux objets et aux pratiques »
10. Mais cette hybridation consiste toujours
pour le numérique en une appropriation : le numérique englobe en lui-même tout ce qui est
externe à lui ; il n’y a pas de place pour quelque chose d’extérieur. Et évidemment, il n’y a pas
non plus de place pour une réflexion qui lui sC’est en effet cette tension entre intériorité et extériorité que l’auteur prend en compte quand
il décrit l’hybridation opérée par le numérique. Hybridation du réel et du virtuel, d’anciennes et
nouvelles pratiques, de concepts et d’objets : « le numérique représente le triomphe de
l’hybridation généralisée aux objets et aux pratiques » Un grand mérite du livre est d’avoir
compris cette totalisation numérique qui empêche une pensée de l’extériorité en tant que pensée non-culturelle, ou super-culturelle.oit extérieure.
http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_MVitaliRosati_Milad_Doueihi.pdf
Moi, ça me troue le cul, D. !
Barozzi
blog booming you pi*°°° dit: 26 octobre 2013 à 22 h 42 min
C’est en effet cette tension entre intériorité et extériorité que l’auteur prend en compte
Hasard heureux de la lecture prise à la suite!
à la suite… ou en enfilade!
Information littéraire :
« Esprit critique
« L’esprit critique, qui a été le produit des idées contenues dans les livres papier, pourrait extraordinairement s’appauvrir si les écrans finissent par enterrer les livres », a déclaré l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Le prix Nobel de 77 ans s’exprimait en marge du Congrès international de la langue espagnole à Panama, qui se déroulait cette semaine.
« Je suis convaincu que la littérature qui s’écrirait exclusivement pour les écrans serait une littérature beaucoup plus superficielle, de pur divertissement et conformiste », a-t-il ajouté. Evoquant « une problématique nouvelle posée par la grande transformation que le développement des nouvelles technologies a signifié pour le livre et la culture en général », il a appelé à tout faire pour que le livre papier ne disparaisse pas. Pour le prix Nobel de littérature 2010, il est « difficile de prévoir » la fin complète du livre papier.
Mario Vargas Llosa partage sa vie entre l’Espagne et le Pérou, où il fut candidat libéral à la présidence en 1990. «
la comédie du « consultez un psy «
il en est qui commencent avec la bénédiction d’un médecin de famille, vous le savez non ?
la puissance de travail de P.Assouline est sidérante et par dessus tout ses choix d’orientation qu’il met en partage
ai tout juste feuilleté sciences et vie sur papier
Il faut bien voir que l’on choisit le numérique parce qu’il est plus facile à utiliser que l’analogique, du fait justement de l’échantillonnage. Mais corollairement, toujours du fait de l’échantillonnage, l’analogique est dans l’absolu une infinité de fois meilleur. Si jamais un jour l’on a les capacités de revenir à l’analogique, après un détour de plusieurs dizaines d’années par le numérique, va-t-on parler d’humanisme analogique ?
Finalement, le seul truc qui est pas noir, c’est le chat…
non pas dictionnaire amoureux de l’humanisme mais dict de l’humanisme amoureux
il est important d’apprendre à se passer de bénédictions et de compliments »
ne dites plus « il en est », mais il y a des gens qui, « , ou « certaines personnes » …..
Celui qui n’accepte pas ce monde n’y bâtit pas de maison. S’il a froid, c’est sans avoir froid. Il a chaud sans chaleur. S’il abat des bouleaux, c’est comme s’il n’abattait rien; mais les bouleaux sont là, par terre et il reçoit l’argent convenu, ou bien il ne reçoit que des coups. Il reçoit les coups comme un don sans signification, et il repart sans s’étonner. … Ainsi à l’écart, toujours seul au rendez-vous, sans jamais retenir une main dans ses mains, il songe, l’hameçon au coeur, à la paix, à la damnée paix lancinante, la sienne, et à la paix qu’on dit être par-dessus cette paix.
Henri Michaux, Vers la sérénité
ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
blog booming you pi*°°° dit: 26 octobre 2013 à 22 h 42 min
–
tout ça c’est le genre de fadaisesèlangue de bois qu’on peut entendre sur France Culture.
Sergio dit: 26 octobre 2013 à 23 h 17 min
Il faut bien voir que l’on choisit le numérique parce qu’il est plus facile à utiliser que l’analogique, du fait justement de l’échantillonnage. Mais corollairement, toujours du fait de l’échantillonnage, l’analogique est dans l’absolu une infinité de fois meilleur. Si jamais un jour l’on a les capacités de revenir à l’analogique, après un détour de plusieurs dizaines d’années par le numérique, va-t-on parler d’humanisme analogique ?
_
Vous fatiguez pas,Sergio. A par moi ici personne ne peut piger ce discours. Ce sont des littéraires, des psys ou des artistes. Je ne dis pas ça péjorativement. Il en faut. Je dis qu’il est inutile de vous fatiguer ainsi pour rien. Sauf si ça vous fait plaisir, bien entendu.
J’ai déjà essayé au moins dix fois de leur explkiquer que le numérique c’était une technologie d’arrière-garde saupoudrée par des entités venues d’ailleurs, faite pour intoxiquer les terriens, que la véritable intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas du tout sur du numérique, mais sur des états probabilistes de degrés progressifs à travers des ordinateurs à structure en pelure d’oignon construits par d’autres ordinateurs : autant pisser dans un violon. Ils s’en foutent.
D. dit: 26 octobre 2013 à 23 h 47 min
autant pisser dans un violon
Oui, mais quand même, ce chat qui ostensiblement n’est pas noir, il faut lui mettre un coup de mortier !
Vie de la rdl. Dix ans.
Le pire ?
TKT ?
Non bien sûr, mais toujours et encore la folle représentante des pompons roses, celle qui
exemple vivant du numérique totalitaire (zéro, un) ne sait jamais réfléchir au-delà de ses fantasmes.
Pauvre d’elle.
« Série B, épisode 26, Soap – Synopsis »
Ah, le pastiche est savoureux ! Pour faire autorité la démonstration devrait sérieusement être étayée, ce qui est loin d’être le cas, ici. Toutefois, JC, en ange exterminateur de l’apocalypse, est irrésistible. Merci pour le divertissement.
U. 20:43 et D. 21:39
Une « brune sexy d’un… certain âge »… Je change le travestissement puisque vous témoignez de son identité féminine : une « femme », donc, qui se désolidarisant totalement de ses consoeurs a tendance à n’échanger qu’avec des hommes comme si elle faisait désormais partie du monde masculin et ceci avec une séduction exacerbée. (Une stratégie de défense la conduisant à se protéger de celles qui pourraient lui porter ombrage ? cela avait déjà était analysé par Rose à propos de ses agressions verbales répétées envers Clopine. Elle reprend un certain nombre de préjugés sexistes pour mieux se couler dans ce monde devenant, non reine des abeilles (piètre destin de pondeuse) mais reine incontestée de l’intimidation envers les femmes dans cet espace commentaire où le masculin l’emporte souvent sur le féminin.
allo Minux, alloooooooooooooo
« Se réconcilier avec notre finitude, accepter nos faiblesses…, c’est le prérequis pour sauver l’humanité. (J.-M. Besnier)
S’extraire des platitudes à la J.-M. Besnier, c’est le prérequis pour sauver la philosophie. »
Mais monsieur Brown, je peux vous appeler John? ce ne sont pas des platitudes, ce sont des âneries de philosophes, même pas des âneries c’est de la violence à l’état pur de philosophe qui s’imagine s’arroger le droit de posséder la définition de ce qu’est ou doit être l’Homme.
Croyez-moi c’est une violence extrême qui a commencé avec Socrate, ensuite Descartes, Kant, passé par un point d’orgue avec Kant, pour finir avec Huesserl et la cerise sur le gâteau : Heidegger.
Certains pensent que l’homme a appris la violence en même temps qu’il apprenait à peindre sur les murs de sa caverne, quand on pense à tous ces débiles qui s’extasient sur ces graffitis préhistoriques de ces premiers tagueurs alors que cela signifiait ni plus ni moins que le point de départ des premiers massacres de masse et génocides de néandertaliens.
En vérité la violence à grande échelle ne commence pas avec ces peintures rupestres mais avec la philosophie, aussi il ne faut pas prendre ces propos de ce philosophe pour des platitudes mais pour des appels au crime.
Misère de misère, combien de crétins l’histoire des hommes n’a-telle pas produite, plus malins les uns que les autres pour dire ce qu’est l’humanité.
ce qu’il n’a pas compris cet imbécile c’est que s’il faut accepter les tares et les faiblesses humaines alors il faut les accepter jusqu’au bout, il n’y a pas de bonnes faiblesses qui font l’humanité et les mauvaises faiblesses.
vous me répondrez que s’il faut accepter toutes faiblesses humaines du coup il faudrait aussi accepter celles de tous ces philosophes à côté de leurs pompes, et bien non ! de toutes les faiblesses humaines celles qu’il faut combattre avec force sont celles de ces philosophes et de ces types qui pondent des bouquins de 55 pages à 7 euros sur l’humanisme : l’humanisme en 55 pages à 7 euros est devenue le pire fléau de l’humanité, de toutes les cupidités celle des philosophes est la pire.
le mot « hybridation » n’est pas le bon, il faut parler d’inséparation entre les objets humains et non humains, une transcendance issue du nivellement et l’enchâssement des intensités et es valeurs, c’est le clou du « cloud ».
web 3.37
Houston, do you copy that ?
Un erreur, je répète, une erreur.
Identifiez-vous, mal ou femelle ?
« u. dit: 26 octobre 2013 à 21 h 00 min
« le dernier humaniste en date vivant sur ce continent portait des culottes coutes »
Des culottes courtes ou des culottes scoutes?
Il y a une nuance, bon dieu. »
u. ça vous ennuierait de mettre une majuscule à Dieu svp.
une Vérité des vérités, un Savoir des savoir, une Science des sciences : un Dieu des dieux.
et puis n’essayez pas de m’embrouiller avec vos nuances, je vous connais trop bien pour me laisser embobiner par vos combines, si vous voulez savoir à quoi doit ressembler un vrai humaniste et point barre !:
http://www.google.fr/imgres?start=148&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=Z-i5Zy5welOLrM:&imgrefurl=http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-heidegger-oeuvre-photographie-98711.html&docid=W7TOFmLbdu2AlM&imgurl=http://www.devoir-de-philosophie.com/images_dissertations/98711.jpg&w=2013&h=3031&ei=BK1sUpKpLMqU0AXa94GICg&zoom=1&iact=hc&vpx=652&vpy=92&dur=722&hovh=276&hovw=183&tx=97&ty=140&page=5&tbnh=150&tbnw=95&ndsp=40&ved=1t:429,r:64,s:100,i:196
« Il faut oublier pour vivre »
F. Nietzsche.
———————————
Nouvel Existentialisme,
le Numérique est un Humanisme;
Absolument.
Déjà à l’heure d’hiver; seul
le Nudisme est un anti-Numérique
théoriquement.
(Louis Althusser, Maspero, Zéro EURO)
——————————–
Christiane, je suis désolé mais vous devez apprendre à accepter les faiblesses des autres humains comme Daaphnée.
les réactions de Daaphnée que vous décrivez sont des réactions humaines.
ces faiblesses devraient vous attrister alors qu’elles vous mettent en colère, la colère est ce qui nous fait basculer dans le côté obscure de la force.
à l’époque je l’avais dit à Clopine : Daaphnée vous gifle ? tendez l’autre joue ! faites preuve de bonté envers elle, sa violence n’est que la preuve elle doit être bien malheureuse.
Je sais ce n’est pas facile, mais il y a tellement de colères accumulées en ce monde, et tellement de bonnes raisons d’accumuler ces colères, par des gens si malheureux, ce malheur est si puissant qu’il en estt perceptible, comme des ondes magnéitques qui se propagent sur toute la surface de la terre, comment tout cela finira-t-il ?
La misogynie, U. ?
Il faudrait alors considérer qu’à travers de pauvres bonnes femmes, c’est LA femme qu’on voit.
Mais c’est là que le bât blesse.
On voit bien que ces femmes pas très épanouies, je ne vois pas ce qu’elles incarneraient de la féminité. Sinon, pour celles-là – à les entendre gémir continuellement et ressasser leurs vieilles aigreurs – considérer que le ressassement, la plainte et la supplique caractérisent le féminin ! Beurk !
Vous risquez de vous retrouver en mauvaise posture … mon cher U. !
Humanisme ou charité chrétienne?
En ce jour du seigneur,
cherche l’intrus …
Dieu ne t’aime pas, Hamlet!
jour u seigneur ?
les humanités comme « un rempart contre la religion de la science, la soumission à la technique et le culte de la machine. » ?
http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/#|m=#inaugural-lecture|q=/site/claudine-tiercelin/inaugural-lecture-2010-2011.htm|p=../claudine-tiercelin/inaugural-lecture-2011-05-05-18h00.htm|
Je sais ce n’est pas facile, mais il y a tellement de colères accumulées en ce monde, et tellement de bonnes raisons d’accumuler ces colères, par des gens si malheureux, ce malheur est si puissant qu’il en estt perceptible, comme des ondes magnéitques qui se propagent sur toute la surface de la terre, comment tout cela finira-t-il ?
Quelle burne!
Christiane ferait mieux d’aller faire la moule chez Popol!
C’est bien ce qu’elle fait, hélas!
Alors avec la taxation des assurances-vie la promotion Fauteuil Voltaire introduit, a posteriori, non seulement les contribuables mais aussi la double imposition en redondance de l’ISF ?
Videz vite vos assurances-vie et allez les claquer en bouffe a Monop et à McDo. Vous n’aurez pas le temps de crever d’obésité.
Ophélie dit: 27 octobre 2013 à 8 h 03 min
Dieu ne t’aime pas, Hamlet!
oui je sais, mais c’est réciproque, Il m’en veut plus que je ne lui en veux, notre pardon est parfois plus grand que le sien.
l’être et temps, moi aussi Daaphnée j’ai été un beau brun sexy, vous verrez les ravages du temps ne pardonnent rien, votre colère contre la plainte et le ressassement qui caractérise l’humain ne fera que s’accroitre au fil du temps.
mais nous savons bien comment tout cela finira, n’est-ce pas ?
> non seulement les contribuables
outre le contribuable
Oui l’humanisme numérique se monte à 15,5 % et à cru.
T’en fais pas, Montescul, les alcools forts c’est pas comme les antibios, tu pourras toujours en acheter 15 bouteilles à la foie.
Vdqs épicétou.
σμειδαω
Smiles is an usage.
Bon alors le claviste de garde maintenant c’est à toi de jouer parce que j’ai pas prévu de te faire tout ton boulot gratos.
Celui qui n’accepte pas ce monde n’y bâtit pas de maison. S’il a froid, c’est sans avoir froid. Il a chaud sans chaleur. S’il abat des bouleaux, c’est comme s’il n’abattait rien; mais les bouleaux sont là, par terre et il reçoit l’argent convenu, ou bien il ne reçoit que des coups. Il reçoit les coups comme un don sans signification, et il repart sans s’étonner. … Ainsi à l’écart, toujours seul au rendez-vous, sans jamais retenir une main dans ses mains, il songe, l’hameçon au coeur, à la paix, à la damnée paix lancinante, la sienne, et à la paix qu’on dit être par-dessus cette paix.
Henri Michaux, Vers la sérénité (cité par icann)
Il m’arrive de m’étonner que les admirateurs fervents de Michaux (j’en suis) n’aient pas songé à réunir à partir de son oeuvre les éléments d’un livre de sagesse.
Relisons tout Michaux (trois gros volumes dans la Pléiade, illustrés, en plus, de reproductions des oeuvres du magique peintre et dessinateur qu’il fut, que du bonheur
Pêcheur de couilles molles dit
Quel merveilleux pseudo. Admirons le génie du pêcheur de cette perle (quelque peu piriforme) d’un orient parfait
Bonjour Hamlet,
j’ai bien ri en vous lisant. Vous êtes champion du non-dit… Serein. Ça dit toujours autre chose ce que vous écrivez… Un jeu de cache-cache, de l’inter-dit. Une langue assez proche de celle de Marivaux…
S’identifier à l’ennemi pour lui échapper ou répéter sans fin le passif avec la mère… lourde. Ça pourrait être la douleur, oui… Certains êtres ne peuvent faire autrement, captifs, tentant de se détruire en détruisant l’autre. C’est aussi ce qui fait son charme… paradoxe. Elle danse avec elle-même.
Quant à l’affrontement, il a du bon. Dans cet entre-deux on se définit. Que serait un volcan sans son possible d’éruption ? Une montagne ronde et trop sage…
il s’agit bien de l’homme qui cherche à prendre la place de Dieu.
péché mortel
Si ce petit livre offre matière à réflexion, c’est aussi parce qu’il revient sur l’humanisme numérique.
La première réflexion qu’on se fait en lisant ce billet, c’est que, s’il y a sûrement matière, la réflexion ne dépasse pas la saveur d’une honnête bouillie pour les chats, et ce ne sont pas les pseudo-pensées de Clémence Revest qui en relèvent le goût. Je sais bien que le dada du culturel numérique fait partie de ceux qu’Assouline aime enfourcher, mais,quand il préfère chevaucher celui de la critique littéraire, il est plus à son aise.
Christiane
vous qui vous amusez des sifflements du reptilien de porquerolles, ne vous occupez donc pas de cette poissarde, ce n’est que du vent, un éventail crasseux et parfumé
On ne touche jamais deux fois le même Pactole.
« brune sexy d’un… certain âge »
elle gagne sa vie à la sueur de son…
@John Brown dit: 27 octobre 2013 à 9 h 29 min
Du même Henri Michaux (La nuit remue) pour Hamlet !
« La colère chez moi ne vient pas d’emblée. Si rapide qu’elle soit à naître, elle est précédée d’un grand bonheur, toujours, et qui arrive en frissonnant.
(…)
« Hein ? Quoi ? Qu’est-ce qui veut se faire casser en deux par ici ? Tas de taciturnes ! Écornifleurs ! Roufflards ! Saletés ! Guenuches ! Coucougnasses ! »
(…)
Cependant, après un certain temps, ma colère cède… par fatigue peut-être, car la colère est un équilibre qu’il est pénible de garder… Il y a aussi la satisfaction indéniable d’avoir travaillé et l’illusion encore que les ennemis s’enfuirent renonçant à la lutte. »
la plainte et le ressassement qui caractérise l’humain ne fera que s’accroître au fil du temps.
‘tain, la Christiane a pas fini!
@ edmond dit: 27 octobre 2013 à 9 h 45 min
« L’aigle – Je te pince la serre !
Le homard – Je te serre la pince !
Ni ange, ni bête, ni homme, ni escargot, ni moule – oiseau. »
Jacques Prévert – Fatras
‘tain, la Christiane a pas fini!
Elle commence à refouler!
Poliziano était un humaniste… par exemple… Mitterrand était bibliophile… ce n’est pas la même chose.
Cela dit, peut-on parler d’un humanisme de l’imprimerie ou d’un humanisme du maillet et du ciseau ? Peut-on parler de l’humanisme du marchand de glaces ou de l’humanisme du représentant en bouchons synthétiques ? Et, la différence entre bouchons synthétiques et bouchons de lièges bien à part, est-ce que l’on peut parler de production humaniste pour les fabricants de bouchons ou pour un glacier qui se limiterait à préparer les glaces sans les vendre au détail ?
Un café le jour du Seigneur, c’est une heure de méditation.
Mais j’ai déjà pris deux claques.
Le doigt va encore se rétracter, un pas de plus vers la nanotechnologie.
« Et que u. ne la ramène que le moins possible dit: 27 octobre 2013 à 1 h 27 min »
Je prends ce message énigmatique comme un signe de charité.
« Je prends ce message énigmatique comme un signe de charité. »
Plutôt d’humanité.
Téléchargé un livre de Milad Doueihi, type remarquablement intelligent et brillant, mais j’ai choisi le livre « Pour un humanisme numérique» (Seuil, 2011), parce qu’il est publié dans la collection justement célèbre de Maurice Olender, et parce que depuis « Indignez-vous » on ne me fait plis le coup de la plaquette.
J’en lis des bouts.
Ça laisse à l’occasion perplexe.
Des développements parfois planants donnent l’impression de quitter terre et de devenir acosmiques comme disaient nos Allemands.
Beaucoup d’idées très justes ou en tout cas bigrement séduisantes, mais il arrive que lorsqu’on en vient aux études de cas, on ne sache pas s’il s’agit de recherches concrètes déjà faite où à venir.
De sorte que la réaction du lecteur qui commence est un peu celle de Pierre A. à la radio: « Mais encore? ».
La culture philosophique (par définition discutable) est là, et n’en déplaise à hamlet, ça peut fonctionner comme air bag, dans les cheminements les plus chaotiques.
Je ne peux pas encore jurer que tout ceci va plus loin que les spéculations de Pierre Lévy, ce chantre de l’intelligence collective (admiré par notre ami ML, probablement pour son messianisme) ou Michel Serres, affecté précocement par un véritable gâtisme machinique (te souviens-tu de la fable de « Petite Poucette » et de « Grand-papa ronchon »).
Mais je suis prêt à le parier.
Pour qui souhaitent déjà aller plus loin, un texte d’une concision qui confine parfois à l’hermétisme:
http://e-south.blog.lemonde.fr/2013/06/02/sur-lhumanisme-numerique-une-analyse-de-milad-doueihi-universite-de-laval-au-canada/
« Mais imaginons un instant un ministre hétérosexuel qui, dans un livre de souvenirs, décrirait à chaque page les « belles nanas » avec lesquelles il a été amené à négocier au nom de l’Etat, le « petit cul » de telle élue, commenterait les formes des secrétaires du ministère, « flasherait » sur les filles encore adolescentes de ses homologues étrangers et demanderait les numéros de téléphone des hôtesses d’accueil sexy. Que se passerait-il? »
monsieur Dupuis devrait faire un effort d’imagination, au lieu de poser des questions idiotes. Penser à DSK, par exemple.
En tout cas,
à en croire
non pas le bavardage
du commentarium
mais l’actu,
l’humanisme numérique
ne manque pas d’écoute.
Vacalmement.
Il faut savoir faire temporairement confiance.
Quand un littéraire ou philosophe évoque l’inévitable Mandelbrot, pour ses fractales ou ses « rugosités », ça évoque des essais plus anciens et peu concluants de sociologues sur l’auto-organisation (Prigogine) ou d’épistémologues sur la catastrophe (Thom).
On aimerait y croire.
Mais on se dit que débarrassé de ses analogies, le texte, s’il est bon, devrait pouvoir tenir debout tout seul, comme un grand.
8:21… 9:56… 10:05
Pour que le numérique reste un humanisme…
Francis Ponge Le parti pris des choses
LE MOLLUSQUE
Le mollusque est un être – presque une – qualité. Il n’a pas besoin de charpente mais seulement d’un rempart, quelque chose comme la couleur dans le tube.
La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu’elle y tient en l’abritant soigneusement, dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle.
Ce n’est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses.
Le mollusque est doué d’une énergie puissante à se renfermer. Ce n’est pas à vrai dire qu’un muscle, un gond, un blount et sa porte.
Le blount ayant secrété la porte. Deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière.
Première et dernière demeure. Il y loge jusqu’après sa mort.
Rien à faire pour l’en tirer vivant.
La moindre cellule du corps de l’homme tient ainsi, et avec cette force, à la parole, – et réciproquement.
Mais parfois un autre être vient violer ce tombeau, lorsqu’il est bien fait, et s’y fixer à la place du constructeur défunt.
C’est le cas du pagure. »
Sergio dit: 26 octobre 2013 à 23 h 17 min
« Il faut bien voir que l’on choisit le numérique parce qu’il est plus facile à utiliser que l’analogique, du fait justement de l’échantillonnage. Mais corollairement, toujours du fait de l’échantillonnage, l’analogique est dans l’absolu une infinité de fois meilleur. Si jamais un jour l’on a les capacités de revenir à l’analogique, après un détour de plusieurs dizaines d’années par le numérique, va-t-on parler d’humanisme analogique ? »
Respect, patron.
Il y a dans ce livre comme une nostalgie pour ce qu’Aristote appelait la pensée des habitants de Lesbos (no sex).
« Les actions des hommes ne peuvent donc être jugées d’après une règle mentale droite et rigide; il faut au contraire, pour les considérer, se servir de la règle flexible des Lesbiens, qui n’oblige pas les corps à épouser sa forme, mais qui s’infléchit elle-même pour épouser la forme du corps » (Ethique à Nico, V, 10, 7).
L’éloge du corps tactile et mouvant comme interface généralisée, au sein de la « culture numérique » traduit peut être aussi cette espérance de rejoindre à nouveau le continu.
Respect, patron.
moyennement sergio, il est plus facile rapport à l’échange et a permit par le multiplexage de réduire dramatically les couts, des échanges, c’est tout cqui compte..c’est là qu’est l’huumanisme..ceci dit lassouline ton agars a pomper sur les prophètes post cyberpunk brit et américain de la fins des 90’s..de l’influence de la « dématérialisation » « de la copie » du numérique qui semble même ne pas avoir de limite dans la conception et la fabrication a distance (machine nupérique) et même dans relative suppression de la concentration du capital necessaire (imprimante 3d)..bref ce mec me semble out of date
« l’humanisme » est ici employé simplement comme un mot plaqué sur une technologie qui force a un changement d’échelle de paradigme de façon de penser accoler y tous les gamelles de vous voulez etc..le dommage c’est pas qu’il n’est pas pertinent ou bon ou moins bon qu’un autre, il obscurcit..il est évident qu’une technologie peut être un « humanisme »..dans le sens ou l’anthropologue parle de lage du fer..de la pierre poli..taillé..et que cela lui a semblé suffisamment déterminant..c’est pas compliqué
marrant le boudegras à jeun !
un ordinateur reconnait un pauvre con a ce qu’il rit de ce qu’il ne comprend pas..quelques remote test et prise d’empreinte par ta webcam a ton insu et envoie a la nsa..tu serviras de maitre étalon keupu
« qui confine parfois à l’hermétisme »
Se comprend-il toujours lui-même ?
La question peut se poser.
« Son œil est celui d’un miraculé qui sait que la vie est un miracle de chaque instant, à respecter dans ses formes les plus ténues, et dont il ne faut jamais cesser de se repaître » (p. 133), dit Bernard Maris de Maurice Genevoix, le père de sa compagne Sylvie (l’anémone Weil), dans un petit opus récent fort sympathique : « L’homme dans la guerre, Maurice Genevoix face à Ernst Jünger » (Grasset). Il offre une émouvante réflexion au sujet du contraste de l’attitude des deux témoins majeurs de la grande boucherie, « Ceux de 14 » et « Orages d’acier ». Et nous passionne, en réévaluant avec une gourmandise non dissimulée la mémoire de Jünger à l’aune de celle de Genevoix, là où on ne s’y serait jamais attendu. En effet, loin d’enfoncer Jünger, B. Maris aspire les deux écrivains vers les sommets de leurs communautés d’expérience de chairs à canon consentantes, plutôt que de les tirer vers le bas de leurs éventuelles divergences idéologiques ultérieures. L’apologiste du guerrier surhumain (des lansquenets) ne fera évidemment jamais le poids face à celui de la grandeur des petits (des valets), dans la mesure où Genevoix cherchait à raconter la vérité des hommes qui mouraient tandis que Jünger s’en préoccupait beaucoup moins. Pour autant, ce qui reste magnifique dans sa peinture obstinée du contraste de leurs attitudes, c’est l’effort méritoire de Maris pour justifier sa réelle estime à Jünger, en dandy et homme de fidélité. Ayant reconnu jadis avec délectation en Jünger l’anticapitalisme et l’antibourgeois forcené, l’expérimentateur des drogues ou le rebelle regagnant sa forêt protectrice, il veut honorer la mémoire de ce personnage contrasté plus que ses côtés les plus sombres et les plus désagréables. La figure de Jünger est aussi précieuse et indispensable à mobiliser que le fut celle Genevoix quand il s’agit d’aider à percer le mystère de leur adhésion à la guerre d’anéantissement totale. Maris combat la pulsion de mort inhérente à l’horreur économique qui plane plus que jamais sur nos têtes aujourd’hui, reconnaissant hélas qu’elle reste virtuellement tapie au fin fond de nos tripes… Il faut d’ailleurs bien constater qu’il n’y a décidément pas de grandes différences entre deux espèces de frères humais : les internautes numérisés décortiquant la nature de leur humanisme parfois haineux bien retranchés derrière leurs écrans ; les poilus ivres de peur, d’amour et de haine agonisant au fond de leurs tranchées bombardées par les shrapnels il y a cent ans. Ô vous, frères humains, nous sommes décidément les mêmes, hélas ou heureusement.
cette dichotomie informatique /numérique est complétement sotte et improductive (confronter les 2 termes sur wiki)..et même occulte une chose fascinante : que la recherche et la technologie allié au puissance du capital aurait pu prendre d’autres voies..pourquoi a t’elle pris celle là ? la connaissance et la technologie sont maintenant vraisemblalblement à jamais lié, c’en est fini d’un certain modèle grec..au fait a qui a t’on donné le prix nobel de physique cette année? à la « machine la plus complesque jamais concue par l’homme » et a ceux qui la montent
Il faut d’ailleurs bien constater qu’il n’y a décidément pas de grandes différences entre deux espèces de frères humais
la preuve que si, c’est que pour t’en convaincre tu te raccroche a la foi que tu as dans leur capacité de nuisance..un grenre d’humanisme négatif..sur que la machine ne saura le battre sur ce point..t’as juste trés peur qu’elle soit meilleur que lui..hurkurlkurk ou pas hurkurkurkurk ? that is the question
« cette dichotomie informatique /numérique est complétement sotte et improductive »
« Sotte » et pas « conne ».
Quand tu te mets à parler comme Hubert Beuve-Méry, bouguereau, je te lis deux fois.
Hamlet des journées dans les arbres vous irait en pseudo tant il semble que une partie non négligée de votre temps y fut passée, il est toutefois des arbres morts dont le feuillage subsiste un temps compté sans pour cela parvenir à projeter l’ombre nécessaire à la lumière aveuglante du soleil au zénith, bien qu’à ne pas vous suivre sur ces sentiers escarpés que vous proposez,me faudrait-il penser qu’à en descendre de cet arbre vous iriez pour en finir avec l’homme l’humanité et l’humanisme qu’il sécrète commencer par supprimer l’un l’autre parce qu’ils sont représentatifs de nos évolutions et sont incapables de parfaire l’idée qui serait la votre et que j’imagine parfaite forme et fond s’assemblant s’emboîtant pour proposer un objet actuel irrigué de toutes parts de tous nos passés destiné à effacer les traces les erreurs ajuster nos trajectoires virtuelles pour un réel qui porterait un avenir certain chargé de nouveautés bénéfiques et salvatrices
« la « machine la plus complesque jamais concue par l’homme » et a ceux qui la montent »
Le cheval ou la moto ya quand même une nuance .
« rempart contre la religion XXX, la soumission XXX et le culte XXX ».
Pas besoin de spécifier. Pas besoin d’ergoter
sur un numérisme qui n’est qu’une technologie
de codage, le plus souvent transparente
pour l’utilisateur. Puissante, donc répandue
et accentuant des questions préexistantes,
principalement de libertés.
Zéroüniqement.
nabilémoi dit: 27 octobre 2013 à 12 h 11 min
hermétisme auto-produit ?
« Sotte » et pas « conne ».
je répète, lisez les 2 termes sur wiki..malheureusement il faut aussi les lire en anglais, wiki est un formidable outil pour comparer les gaps culturels..ce mec vend du papier aux mals informés
…
…et dire queue l’on en arrive à faire des mots croisés à la sueur de son s(c)on,…
…
…Ah,…Oui,…les crêpes aux pissenlits,…trouver la faille sur l’usure de l’échiquier aux armes et lambrequins déployer,…devise » jamais outre « ,…
…un robinet bien gonflé,…pavillonne-moi l’escalope et le lézard,…un arbre généalogique de choux-mandarin,…déjà une plantation à l’exportation,…
…la diplomatie sociale,…en attendant que les poulets on des dents,…à la discipline du con-scrit à deux balles la tête aux paradis des médailles d’en être de la patrie mondialiste,…en diversion,…d’industries,…
…le roulements des salaires,…du bénéfice assurez les salaires, encore que l’état dirige l’usure des uns aux autres, en se prenant la primauté des sécurités et d’en assurés les règles,…sous domaines corporatistes,…
…la concurrence libre,…les inventions dirigés,…pour vivre d’administrer des consensus » humanistes « ,…
…
…déjà,…payer si cher,…le bordel diplomatique à rien foutre,…pour nous en mettre du Cinéma et James-Bond,…protecteurs,…
…
…donc, non seulement l’état se donne le droit légal administratif du seigneur,…de taxer et les industriels et les travailleurs-employés,…
…mais, cette administration est copier comme exemple à suivre,…en dirigeant l’économie politique et sociale, vers ses cadres incontournables de connivences avec les autres états copier/coller,…
…inventer des brevets,…déposés,…les états en usufruirons à leurs guise,…
…tout çà, au dessus de la tête de tous les particuliers,…
…
…les » problèmes actuels « ,…des diversions et stratagèmes,…pour rester en bouquet tailler dans le vase,…changer l’eau , et ne pas prendre racines,…
…ma Botte à Niques,…moi,…les pays en ranch’s,…etc,…Ah,…Bip,…Glu-Glu,…
…Stop ou encore,…les jean sans terre, aux médailles sous terre,…
…devise » jamais outre « ,…cris, écris, à voir en 3D,…la crise aux morpions,…etc,…
…
Faire d’une phrase simple un argument de bataille et réduire à quelques mots hatifs son auteur c’est le début du conflit, ne pas vouloir traduire étendre augmenter le sens c’est mépriser toutes positions qui ne seraient pas d’entrée de jeu un point culminant marcher sur des palte-bandes sans prétentions autres qu’un rappel à l’humilité et l’héritage qui fut reçu et sera laissé à ceux qui suivront dans cet après pour lequel les faiseurs et décideurs inscrivent une responsabilité, et si les philosophes font un pas de coté et prennent le temps de l’observation pour démonter en vue d’une analyse destinée à améliorer nos fonctionnements individuels et sociétaux bien que vraisemblablement je n’aie pas tout compris de ce que propose Hamlet, il me semble que ce n’est pas pour détruire mais pour tenter de rompre avec l’idée de la guerre consubstantielle à l’espèce.
« nabilémoi dit: 27 octobre 2013 à 12 h 11 min
Hamlet des journées dans les arbres vous irait en pseudo tant il semble que une partie non négligée de votre temps y fut passée »
désolé mais j’ai une sainte horreur de la nature, en plus j’ai des allergies, même la vue d’un tableau de Van Gogh ou d’un bouquet de tulipe me fait éternuer, de plus je ne suis jamais monté sur un arbre pour la simple raison que j’ai le vertige, j’ai déjà le vertige quand je monte sur une chaise alors monter sur un arbre c’est tout à fait hors de question.
je pense que vous devez confondre avec u. il ne passe son temps qu’à monter, et pas que sur des arbres.
@12.06, la preuve que si (NB / qu’il n’y a pas de grande différences entre internautes et poilus ?), c’est que pour t’en convaincre, tu te raccroches à la foi que tu as dans leur capacité de nuisance…(NB/ ce n’est pas une foi, mais plutôt un constat, et les deux ne sont pas réduits à cela, c’est-à-dire à leur capacité de nuisance, car pour Genevoix et Maris, et pour Diagonal par exemple, il y a vraisemblablement et peut-être surtout les valeurs de compassion, de fraternité et de pitié (relisez la page 114 de l’ouvrage examiné), un genre d’humanisme négatif… (NB/ non, n’employons pas ce terme dans cette acception aussi vulgaire) sûr que la machine ne saura le battre sur ce point (NB/ vous voulez dire que la machine n’aura jamais la capacité de nuisance qu’avaient les hommes à s’entretuer ? Mais ce serait méconnaître qu’elles ont déjà commencé à le faire, voyons donc !)… t’as juste très peur qu’elle soit meilleure que lui… (NB/ peur que la machine soit neutre, donc plus forte que l’homme ?… Non, pas vraiment… Le sujet n’est pas là, c’est drôle de penser cela, et surtout voilà bien une vue apparemment progressiste, passant très à côté de sa plaque de verglas).
12h33
C’est sympa d’avoir réussi à caser une virgule dans tout ça.
Hamlet je ne pige pas grand chose de façon générale, votre intervention de 6h et quelques heure d’hiver m’a interpellée et je n’ai pas réussi comme vous à comprendre Kant Platon Spinoza et tant d’autres, pour condenser une perception sans doute fausse de notre temps et en réaction à une logorrhée qui ne réussit qu’à proposer une solution alternative à l’absence à l’anéantissement au vide etc à ceux desquels elle ne cesse de couler du naufrage.
« en réaction à une logorrhée »
logorrhée, graphorrhée,
même combat.
u. il ne passe son temps qu’à monter, et pas que sur des arbres.
Et c’est reparti !
( Je pensais, U., que n’auriez fini de faire disjoncter que notre cricri, et 2 ou 3 autres vieilles rascasses – la pauvre, elle en a ânnoné l’alphabet de Marivaux à Ponge! Si c’est pas malheureux. Pffff ! –
avec votre « sexy » …
Hé non !
Memento quia pulvis es, il a fallu que Hamlet tombe de son escabeau ( est-ce un nain ? un main lubrique refoulé ?? )
Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! (3 fois sinon rien )
Quelle hécatombe .
« si les philosophes font un pas de coté et prennent le temps de l’observation pour démonter en vue d’une analyse destinée à améliorer nos fonctionnements individuels et sociétaux… il me semble que ce n’est pas pour détruire mais pour tenter de rompre avec l’idée de la guerre consubstantielle à l’espèce. »
j’espère que vous conviendrez avec moi que jusqu’ici ils n’ont pas eu, ce que nous pourrions dire « un franc succès ».
par contre, s’ils n’ont pas arrangé les choses, ils les ont fait empirer.
un exemple, au hasard : Hegel, la maitrise de l’Histoire, la construction, téléologie… Hegel est, en matière de pensée humaine ce qui s’est fait de plus violent et destructeur, la pensée humaine absolutiste et coercitive dans sa version la plus monstrueuse.
Mais Hegel est dans la suite logique des choses, depuis Platon : si la philosophie n’a jamais permis la moitié d’une once de bien être elle a su, par contre, engendrer bien des massacres.
Daaphnée dit: 27 octobre 2013 à 12 h 56 min
u. il ne passe son temps qu’à monter, et pas que sur des arbres.
vous avez les idées bien mal placées, je parlais de la pensée, u. monte sur les cimes de la pensée, comme Nietzsche.
maintenant si vous préférez l’interpréter autrement c’est votre problème.
u. monte sur les cimes de la pensée, comme Nietzsche.
Et vous vous bêlez dans le troupeau ?
J’avais déjà remarqué.
Cela étant, voyez si dans ce bouillon que vous nous faites … il n’y aurait pas quelques lentilles ..
hamlet dit: 27 octobre 2013 à 12 h 36 min
merci d’avoir répondu au téléphone à ma place.
Hamlet la philosophie ne sert plus qu’à argumenter dans l’espace privé de clubs tout aussi délimités, ne déploriez-vous pas l’absence de pensée autre que mercantile en cours dans toutes les bourses et plus que déterminante pour la plèbe majoritaire?
Dans ce genre, les terrains d’exploration multiples permettent à certains auteurs de poser une brique de plus sur l’oeuvre antérieure, en philosophe de la philosophie, ils ne sont pas les seuls.
Bon Hamlet, il faut que je vous dise.
J’avais projeté d’aller pour la Toussaint en Haute Engadine. Mais j’ai vu que le rocher de l’éternel retour était aussi fréquenté que le métro Châtelet aux heures de pointe. Du coup, je pense à autre chose.
Daaphnée dit: 27 octobre 2013 à 12 h 56 min
Et la vieille rancie repart.
Plus bornée que TKT.
Je crains Hamlet, que dans votre troupeau il y ait quelques vieilles brebis pelées et bien égarées ..
(Vous avez intérêt à assurer, mon cher !)
Je pense que Nabilémoi n’a pas digéré la leçon inaugurale de Claudine Tiercelin.
Elle en reste à un dogmatisme insensé,-in, préfixe privatif- et un radotage verbeux.
Non mais allô, quoi, c’est pas vrai, Hamlet ?
Bérénice, seule, pourrait comprendre les signaux que Nabilémoi envoie dans l’espace, disons sidéré.
bref ce mec me semble out of date
2 ou 3 choses tout de même sur les algorithmes qui présideraient à la logique du bidule et conduiraient – mais ce n’est pas développé – à une connaissance selective ?
Bref, c’est surtout son discours qui est mal foutu. Il aurait mieux valu qu’il série les limites de la technologie, pour les problématiser (« comme disent nos lycéens » .. oui, oui, U. )
Je trouve qu’il part tous azimuts se chercher des maîtres à penser .. de Levi Strauss à ..
D’ailleurs, passer d’un « âge » du numérique à un humanisme du numérique … (je simplifie)
C’est assez différent que de parler d’Humanisme, non ?
Le cauchemar d’un nietzschéen, c’est de rencontrer un autre nietzschéen.
Quand il en rencontre trente, c’est le massacre programmé.
En revanche le catho de gauche, le nietzschéen il aime bien.
« les internautes numérisés décortiquant la nature de leur humanisme parfois haineux bien retranchés derrière leurs écrans ; les poilus ivres de peur, d’amour et de haine agonisant au fond de leurs tranchées bombardées par les shrapnels il y a cent ans. »
j’aime bien lire cette réassurance de Diagonal, un peu fonctionnaire-qui fait son taf, sans plus-, sans prise de risque, un peu déshumanisée, en somme.
Des journées, plus simple, vous allez à St. Moritz — le musée Segantini mérite une visite : http://www.segantini-museum.ch/giovanni-segantini/segantini-im-engadin.html ; de là vous prenez le Glacier Express jusqu’à Disentis (Abbaye de Disentis, en romanche Claustra da Mustér, in allemand Kloster Disentis, en italien Abbazia di Disentis) ; puis, vous revoilà à bord du Glacier Express en direction de Zermatt où à cette date, avec l’aide d’un guide et si le temps le permet, vous pouvez encore monter sur ce gros Stück d’Afrique que les Italiens appellent Cervino et les Valaisans Matterhorn (rien à voir avec les mères… avec les pâtures, plutôt), et là vous aurez fait une expérience. Tandis que le « rocher de l’éternel retour » en vaut beaucoup d’autres…
Catho de gauche vaut catho-communiste ?
« Et c’est reparti ! »
Bah, c’est dimanche, Daaphnée.
Tout prochain devrait être bienvenu, assis à côté de notre prie-dieu.
J’ai été autrefois catholique une matinée. Je le suis maintenant une journée entière.
J’envisage mes futures semaines avec un mélange d’espoir et d’inquiétude.
Merci Renato, je vais étudier votre proposition; vous avez peut-être sauvé un « voyage découragé »; mais d’ores et déjà, cela se fera sans guide…
non mais on rêve.
u. vous qui avez été à l’école expliquez le problème, dites leur de votre plus belle voix : regardez autour de vous : pourquoi l’Europe vit-elle en paix depuis plus de 0 ans d’après vous ?
parce qu’il n’y a plus de philosophe pour pousser les gens à aller se massacrer dans les tranchées.
notre monde est paisible c’est bien parce que la philo c’est game over.
la philo ne set plus qu’à disserter sur des sujets à la noix du genre « qu’est-ce que l’humanisme », ou « est-il nécessaire d’être libre pour prétendre à la justice » ou « qu’est-ce que la sagesse » ou « les pauvres peuvent-ils être hédonistes » des trucs qui n’ont aucun intérêt d’un pont de vue hégélien mais qui ont l’intérêt de se bien se vendre.
aujourd’hui la philo est commerciale, et marketing, comme l’art moderne, et c’est tant mieux, qu’est-ce qu’on risque à se poser des questions du genre : l’humanisme passe-t-il par le numérique? qui va risquer sa vie pour des questions pareilles ? personne.
croyez-moi vaut mieux vivre paisiblement avec des crétins comme Onfray que partir à la guerre avec des Hegel.
« pourquoi l’Europe vit-elle en paix depuis plus de 0 ans »
u. oui je sais, j’ai oublié un chiffre, ou bien non c’est un lapsus, révélateur.
« u. oui je sais, j’ai oublié un chiffre, ou bien non c’est un lapsus, révélateur. »
Allez, hamlet, faisons encore un pas, disons que c’est profond.
« croyez-moi vaut mieux vivre paisiblement avec des crétins comme Onfray que partir à la guerre avec des Hegel. »
Ça se discute.
Et pourquoi ne pas envisager une ascension de la roche de Solutré, des journées entières dans les arbres, c’est un haut-lieu de l’humanisme traditionnel, de nature à vous changer un homme !
Le Matterhorn sans guide ?! vous êtes une bonne grimpeuse ?
Non, parce que 4 478 mètres : http://www.mountainphotography.com/photo/zermatt/?gallery=switzerland
qui sait si la langue française a un privilège serait-ce erdélien pour l’expression « ma religion me l’interdit « ?
« Je pense que Nabilémoi n’a pas digéré la leçon inaugurale de Claudine Tiercelin. »
Lisez ceci, c’ est instructif et distrayant!
http://lafrancebyzantine.blogspot.fr/2013/10/bouvard-et-pecuchet-font-un-mooc.html
u. dit: 27 octobre 2013 à 13 h 57 min
Ça se discute.
Effectivement, ici
http://lafrancebyzantine.blogspot.fr/2013/10/bouvard-et-pecuchet-font-un-mooc.html
vous êtes une bonne grimpeuse ?
Ce n’est pas tous les jours non plus que Jacounet met des ballerines et un tutu , Renato !
Bref, c’est surtout son discours qui est mal foutu.
j’ai lu un peu plus avant..c’est une bouillie infecte..c’est un gugusse
Eloignée depuis quelques semaines de la lecture de ce blog et de ces commentaires, ce que j’y retrouve aujourd’hui me fait penser à « suave mari magno….. », ces vers de Lucrèce, qui décrivent le bonheur de celui qui du rivage voir un malheureux se débattre au milieu des flots déchaînés, bonheur qui n’est pas la joie sadique de voir autrui souffrir ,mais la satisfaction de mesurer les maux dont on est exempt .
Et de fait comme il ne reste plus sur ce blog comme femme que cette pauvre Christiane, c’est elle qui la hargne vulgaire et jalouse de celle qui serait une belle brune , et je me dis, rassérénée, que j’ai de la chance d’être sur le rivage ,car je serais probablement mangée à la même sauce par celle qui sur ce blog s’est depuis toujours installée dans une posture agressive des femmes « qui ne la valent pas »,sans qu’on sache d’ailleurs si elle les méprise ou si elle les jalouse
ascension de la roche de Solutré
le dernier arrivé on l’encule ?
« Pour y parvenir, l’auteur invite à bousculer la dualité mise en place il y a plus d’un siècle par le sociologue Max Weber entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Il propose une troisième voie adaptée aux nouveaux temps, »
Ce n’est ni possible, ni souhaitable.
Avec ces deux notions, Weber formule assez bien le « tragique » de l’action politique,
Ça me semble indépassable.
A noter que Weber ne les oppose pas terme à terme.
L’homme qui a eu le culot de reconnaître la politique comme sa vocation (Beruf) et qui est à la hauteur de ce choix devrait posséder un caractère qui n’est pas à la portée de tous. Il devrait avoir non seulement le sens de la responsabilité mais aussi la passion et le « coup d’oeil » (la vision?) — Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmass…
M. Hollande a dit avant l’élection: « Je suis prêt ».
S’il avait lu de près Politik als beruf, il aurait sagement conclu: « Je renonce, je ne le serai jamais ».
Sais-tu que ce texte génial est accessible en français grâce à l’université du Québec?
dhh elle se voit toujours la dernière..
« j’ai lu un peu plus avant..c’est une bouillie infecte..c’est un gugusse »
Halt.
Je m’inscris en faux.
Malheureusement, n’ayant pas fini ma lecture, je n’ai pas le droit à la parole.
c’est un gugusse
Ils ne doivent pas être très regardants pour le recrutement au Quebec ..
Positivons, s’ils payent mieux qu’en France, c’est une piste (n’est-ce pas mon U. chéri ? ).
Remarquez, Genève aussi ..
devrait posséder un caractère qui n’est pas à la portée de tous
haaa le bénart à goeringue ne va pas a tout l’monde..sauras tu me dire si c’était du calçon ordinaire qu’il mettait dessous zouzou
« Il propose une troisième voie… »
On connaît le mythe de la troisième voie : tu n’as pas d’idée à propos de l’éthique de conviction ni à propos de l’éthique de responsabilité, et tu cherches un raccourci… Pour arriver où ? personne ne le sait…
Bon, on va proposer un axiome:
« Tout penseur prétendant penser l’essence d’une révolution technique ne peut être qu’un gugusse. »
Il aura tout le monde à dos (hybris philosophique, scientisme naïf, paganisme de mes deux…)
Reconnaissons qu’il est soit inconscient soit courageux.
Renato, le Cervin, bien sûr…
Simplement déjà foulé au pied, aux spatules, serait plus juste. Du côté de Cervinia.
Mais, oui, la Toussaint sera high, de toute façon.
Miettofulgor,
« Bouvard eut du mal à convaincre Pécuchet de l’intérêt d’internet »
excellent ! 😉
dhh elle se voit toujours la dernière..
Il y a des cas ..
Elle ne comprend pas tout non plus .
Hé oui .. n’en rajoutons pas mais là, que voulez-vous, on touche au douloureux du laborieux !
Halt.
Je m’inscris en faux.
allons..n’importe quel auteur de sf populo a une culture technique qui le ferait rougir..on lui a vendu matrix et wolfenstein et un vieux gibson sur son « interface numérique » (quel con!) et il est fumasse pasque tout le monde les a chargé gratos en 1999
n’importe quel auteur de sf populo a une culture technique qui le ferait rougir (b.)
Choisiras-tu la culture technique sans réflexion ou la réflexion sans culture technique?
— Qui a dit « troisième voie »?
« Tout penseur prétendant penser l’essence d’une révolution technique ne peut être qu’un gugusse. »
Mais enfin, U. !
« Révolution », quelle révolution ???
Du moulin à café à main de nos arrière-grand-mères à la machine Nespresso ?
Il faut arrêter avec ces illusions et ces interprétations délirantes des progrès la technique !
Choisiras-tu la culture technique sans réflexion
choisiras tu la culture litteraire sans réflexion..si tu étais..mettons ancien informaticien..et que t’étendrais le domaine du goatse..? kurkurkurk?
Bon, Le boug’, Bourdieu ne s’est pas risqué à l’extension du domaine du sexe.
Ouelbek, l’a sagement suivi.
( je me demande si certains ne vont pas finir de griller leur bougie, mais ne mégotons pas )
« Il faut arrêter avec ces illusions et ces interprétations délirantes des progrès la technique ! » (Daaphnée)
Mais non, il ne délire pas, il explore.
Il a évidemment raison de faire la différence entre la technique informatique (outil) et la culture numérique (environnement).
Mais la question est de savoir, comme il en fait l’hypothèse, si ladite culture numérique s’est suffisamment autonomisée pour affecter en retour l’ensemble de la culture – qui aurait progressivement changé de nature (si l’on peut dire).
On peut en douter.
Voyez les bagarres sur Snowden ou la NSA.
L’espace où ces conflits se déploient et les formes qu’ils adoptent sont partiellement nouveaux, mais les « causes efficientes » qui les mettent en branle (comme dirait hamlet) sont toujours facilement reconnaissables (intérêts d’Etat, profit économiques, différences culturelles ou idéologiques…).
Le basculement vers un « nouvel âge », c’est un mot d’ordre qui rend circonspect.
Mais son livre est très bien, enfin la première moitié, pas encore vu le reste.
Les trois années de Frédéric Mitterrand au ministère de la Culture ?
En 3 mots la troisième voie hyper mes tropes
Mais son livre est très bien, enfin la première moitié, pas encore vu le reste.
Vous savez quoi, U. chéri ?
Vous savez être prudent et circonspect, moi pas du tout, vous me rassurez et c’est pour cela que je vous aime.
Mais bon ..
Moi – pas moi-je-je-moi mais quand même, je ne dis pas vous .. – quand je lis les cent premières lignes d’un article … il m’arrive de sauter à la conclusion.
Oui. Pas tout le temps.
je pense que MOOC fait la nique à M.Douheini.
M. Doueihi.je ne mémoriserai pas. C’est tant mieux.
@13.40, un peu fonctionnaire -qui fait son taf, sans plus-, sans prise de risque, un peu déshumanisée
Ah bon ? l’Albert Cohen serait aussi un fonctionnaire de l’EN ou du BIT, sorte de petit prof de philo genevois comme tous les autres, quoiqu’un peu plus besogneux et mou du g’nou car moins nietzschéen, que lui aurait pas connu la vraie vie à Sils Maria, et qu’aurait la nostalgie d’avoir pas connu le frisson de la vraie guerre des tranchées ?… Heureusement que tout le petit monde d’ici vit bien plus dangereusement, vu la nature des « dialogues » censés PROUVER le nouvel humanisme d’avenir qu’ils (se) préparent, à partir des grandes largeurs de Solutré, sans doute…
@14h59, vous seriez bien aimable de ne pas faire un procès à Cohen, alors que Diagonal s’en sort bien planqué.
albert tu devrais te faire appareiller..y’a des plugs qui te collent des décharges dans l’cul quand tu dis une connerie..keupu a essayé..mais la pile tient pas l’coup assez longtemps pour lui
Il a évidemment raison de faire la différence entre la technique informatique (outil) et la culture numérique (environnement)
sauras tu m’espliquer ce qui veut rien dire.. sinon dans une université dirait jicé..hurrrrkukrukuuurk!
Albert Cohen, quelle outrecuidance quand même de votre part, une telle usurpation ,mais passons !, vous avez lu Diagonal à 11h 57 ou vous avez d’autres intentions, non avouées, d’en découdre n’importe comment ?
un lien trouvé dans God & Golem inc sur quelques points de collision entre cybernétique et religio
ed de l’éclat
http://www.revue-terminal.org/www/articles/61/identitespouvoirslacroix.html
bonne journée
Bon, Le boug’, Bourdieu ne s’est pas risqué à l’extension du domaine du sexe.
Ouelbek, l’a sagement suivi.
le rapprochement entre ouelbek et bourdieu..sincérement dafnoz je dois faire effort pour les voir ensemble..ce qu’il aurait pu se dire ? si t’en as une idée je t’écoute
religion
dans cette page
« Incidemment, celui-ci souligne un curieux phénomène d’amnésie collective portant sur cette période de notre histoire récente qui a présidé à la naissance, puis à l’essor, de l’informatique. Les années 1940 à 1955 (environ), ont été d’une extraordinaire richesse intellectuelle. Pourtant tous les débats qui ont eu lieu alors ont été complètement gommés de la mémoire collective. Aussi les discussions d’aujourd’hui, tant sur le plan théorique (avec la résurgence des modèles neuromimétiques en I.A) que sur le plan social (avec le chômage), reprennent-elles souvent des idées qui ont été exprimées dès le début de l’informatisation, en ignorant leurs sources.C’est un peu comme si l’histoire, étrangement, bégayait.
blogogolemite de la dernière heure
le « lien » c’est wiener, c’est un autre calibe
Si la communication a pris autant de place dans nos sociétés, ce n’est pas seulement à cause de la prolifération des machines à communiquer, mais parce que, pour Breton, cette communication a été théorisée dès la fin de la Seconde guerre mondiale par le mathématicien Norbert Wiener.
Le père de la cybernétique serait le promoteur d’une utopie de la transparence qui inspirerait ce que notre société actuelle a de plus réducteur. Non pas qu’il ait été mal intentionné, il aurait au contraire conçu son utopie de la communication « comme une arme absolue contre le retour de la barbarie », estimant naïvement que « la communication effacerait le secret, qui seul rendit possible le génocide nazi, Hiroshima et le Goulag ». Ce rêve généreux aurait des effets pervers dont Breton énonce les principaux traits : apologie systématique du consensus, identification de l’information médiatique à la connaissance des faits et une vision du futur étroitement déterminée par les nouvelles technologies.
Pourtant tous les débats qui ont eu lieu alors ont été complètement gommés de la mémoire collective
..allons
no, Wiener est l’auteur de God &Golem inc ;
le lien , c’est ce qui est indiqué en prêt à cliquer.
« sauras tu m’espliquer ce qui veut rien dire.. sinon dans une université dirait jicé..hurrrrkukrukuuurk! » (b.)
D’abord, je n’aurais jamais l’outrecuidance de vouloir t’expliquer quoi que ce soit.
Ensuite, si tu fous le bordel dans la classe, je ne vois pas comment je pourrais l’ouvrir.
le lien , c’est ce qui est indiqué en prêt à cliquer.
c’est dur de paraphraser la technique hin renfield.
cque dit le mec aussi est vite dit, sauf qu’évidemment la technique, « l’informatique » à la quelle hitler -heureusment- ne croyait pas (il avait aussi des fortiches pourtant), est un espoir pour empécher l’irrationnel irréparabe ..wiener est un demi dieu pour beaucoup de gens
Jacques Barozzi dit: 27 octobre 2013 à 14 h 01 min
Jacques barozzi, cette roche -là, non merci.
J’ai souvenir du nombre de journalistes qui ont fait cette ascension. Tous de grands « grimpeurs ».
le lire de Wiener, traduit de l’anglais par Christophe.Wall-Romana & Patricia Farazzi
préface de Charles Mopsik
postface de G.Scholem
non merci.
DHH,
Ce n’est pas si simple… maintenant que je sais que c’est une femme, je la trouve grandiose dans ses haines. Homme, elle me décevait voire me lassait. Femme à facettes… Ah, la guêpe, elle pique, oui, mais quel style ! L’affronter c’est un peu un tournoi médiéval, avec les cuivres, les chevaux, les lances. Et on s’en fout de qui remporte le tournoi, le vivre c’est un immense barouf, une folie de mots de pure altérité, presque amusante, une parodie. Ça gicle dans tous les sens et c’est le contraire de mourir d’ennui. Il ne faut pas s’adapter trop vite à l’autre. Les prédatrices sont toujours passionnantes. Se laisser embarquer dans ces joutes pour un mot qui ne passe pas c’est faire jouer la distance dans une danse où l’une veut prendre le pas sur l’autre. Un saut d’énergie. Ça flambe !
Bon, voilà une petite piste… bon après-midi.
que tu touches ta com aussi renfield?…c’est pour bientôt renfield, patience
épigraphe de Wiener
Non, l’avenir n’offre que peu d’espoir à ceux qui s’attendent à ce que nos esclaves mécaniques nous prodiguer un monde où nous pourrons nous passer de penser
Tiens, dafnouille a encore frappé.
une troisième voie ?
entre conviction et responsabilité ?
c’est bien. j’aime bien les troisièmes voies, lire Wittgenstein a toujours été le meilleur moyen d’entrer dans la rhétorique musilienne entre le probable et le possible.
la troisième s’inscrit dans l’ordre du possible.
c’est pour ça qu’il rien dit rien : autant on peut blablater sur le probable autant le possible est l’idée de se dire que, bien que sachant la façon dont les choses ne se produiront pas, nul n’a idée de la façon dont elles se produiront.
u. (par exemple) est un homme du probable, menant une existence probable, dans un monde probable… d’où sa réticence à la troisième voie.
l’homme du possible, voyant comment les choses se produisent se dira qu’elles auraient pu toujours se produire autrement, et que ma foi si elles se sont produites comme elles l’ont fait c’est qu’après tout elles devaient avoir de bonnes raisons de le faire.
ainsi, l’auteur d’un essai de 55 pages à 7 euros sur « humanisme et numérique » a plus de chance d’avoir une vision probable qu’une vision possible, dans la mesure où ce qui distingue probable et possible tient notamment à la patience : plus on attend et plus on a des chances de voir se produire une chose peu probable mais à priori tout à fait possible qui ma fois avait échappé à notre imagination, vu que comme le dit Hume, rien de notre imagination appartient au monde de l’impossible car après tout même si nous avons quelques chances de trouver un cheval et une corne il y a peu de chance un jour de croiser une licorne qui n’est pourtant, ni plus ni moins que l’adjonction de cette corne sur la tête de ce cheval : si la corne est la conviction et le cheval la responsabilité, la troisième voie, ma foi, risque fort de ressembler à une licorne.
aussi il est tout à fait compréhensible que notre auteur, bien que croyant fort bien, dans son for intérieur, à l’existence de cette troisième voie, il ne puisse, pas plus que nous, en donner aucun détail.
Sur ce point il est rasurant de constater que l’auteur érudit de cet essai et nous mêmes, les lecteurs, en sommes rendus au même point, et que s’il ne racontait des choses que nous savions probablement déjà, il existait peu de chance pour qu’il nous sorte un scoop qui eût mis en péril nos capacités imaginatives.
va donc pour la troisième voie.
pour 7 euros on ne prend pas un grand risque avec cette troisième voie.
c’est comment qu’il disait déjà Wittgenstein sur ce qu’on ne sait pas ?
Il disait: M’en parlez pas Hamlet, m’en parlez pas.
Passer du maillet au marteau pneumatique ou au SLS (selective laser sintering) ne modifie pas la conception ni la réalisation de l’œuvre.
demi dieu ?
et les échanges qui ne sont pas bouganimiques , ce ne sont pas des semis-feydeau du lien freddo?
une introduction à Feydeau de de la puce à l’oreille au fil à la patte http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Feydeau
c’est comment qu’il disait déjà Wittgenstein
lui aussi disait ferme ta gueule keupu ?..il remonte dans mon estime ce poseur
ne modifie pas la conception ni la réalisation de l’œuvre
si tu parles de ton autoportrait dans l’saindoux rénato..
hamlet, il n’y a que deux voies : l’éthique de conviction ni à propos de l’éthique de responsabilité — le probable et le possible ne sont que deux manières de les parcourir, pas des voies supplémentaires…


898
commentaires