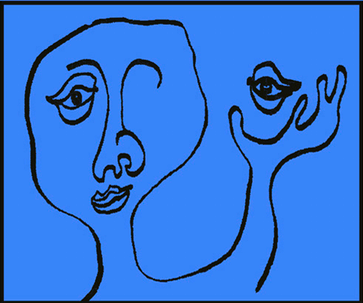
Caprice d’Echenoz, insignifiance du Kundera
Après la petite rentrée, comme on nomme désormais la rentrée de janvier, mars est le rendez-vous des poids lourds. Ils convient de les admirer. Ils ont la carte. Le club est sélect : Kundera, Modiano, Le Clézio y côtoient Carrère, Echenoz, Ernaux, Ndiaye, Toussaint…. Autant d’écrivains que l’on a aimés, et que l’on est tout prêt à aimer encore, mais sans complaisance ni indulgence coupables. Sur la durée, certains (Modiano) sont remarquablement constants dans la qualité ; d’autres, moins. Leurs nouveaux livres sont pourtant loués systématiquement par un effet d’emballement médiatique qui demeure l’un des plus étonnants mystères de la vie littéraire. Comme si l’esprit critique renonçait par principe à s’exercer à de telles hauteurs. Il y a là un curieux phénomène de paralysie par l’admiration. De toutes façons, dès qu’un livre est annoncé comme un événement pour des raisons diverses et variées (l’âge de l’auteur, son métier etc), c’est mauvais signe.
L’écrivain semble le seul artiste à échapper à l’examen critique qui lui signalerait gentiment, mais fermement et publiquement, une perte de valeur, une baisse de qualité, une petite traversée du désert. Les plus grands ont connu ça : Welles, Fellini et même Chaplin, pour ne pas parler des dramaturges et des peintres. Les classiques modernes de la littérature, pour peu qu’ils soient encore de ce monde, semblent immunisés contre ce genre de désagrément. Si l’on en croit la critique, ils ne connaissent pas de hauts et de bas contrairement au reste de l’humanité créatrice. On ne peut même pas dire, comme on le fait parfois avec Philip Roth, que lorsque c’est moins bon, c’est tout de même meilleur que la plupart de ceux d’en face.
Ils racontent des histoires et manifestement, cela leur fait plaisir. Dommage qu’ils n’aient songé à l’art et la manière de le partager. C’est flagrant avec Caprice de la reine (128 pages, 13 euros, éditions de Minuit) de Jean Echenoz. Sept récits, sept lieux, le tout bien emballé, même si la musique de l’auteur y semble assourdie. Rien de ce qui nous avait récemment enchanté du côté de Ravel et de Courir, ou fasciné avec 14, pour s’en tenir aux souvenirs les plus récents. Une impression de déjà lu, et pour cause, certains de ses textes ayant déjà été publiés ailleurs. Or, comme le savent d’expérience éditeurs et fleuristes, un lien jamais ne suffira à faire un bouquet. Mais surtout quel ennui ! C’est peu dire que l’intérêt y est faible ; on ne voit même pas, à la fin de chaque histoire, pourquoi l’auteur nous a amené jusque là. Pas indigne mais vain. (ici un extrait). A croire que la publication de ce livre obéit à un caprice autorisé par l’auteur à l’éditeur, à moins que ce ne soit l’inverse. Vite, le prochain, le vrai ! Le rapport avec le dernier Kundera, outre le statut d’intouchable et l’ampleur de la déception ? Le jardin du Luxembourg. Ils l’ont en partage.
On le sait que depuis quelques temps, de crainte qu’une ou deux voix discordantes ne se manifestent chez ces incorrigibles français, Milan Kundera préfère publier ses livres d’abord à l’étranger ; c’est ainsi que La fête de l’insignifiance est paru en Italie en « Prima edizione mondiale » comme l’indique fièrement le bandeau d’Adelphi ! Précaution inutile car là-bas comme ici, l’accueil fut et sera kunderolâtre. Des amis se rencontrent et se racontent. Voilà. Il nous ôte le goût de raconter l’histoire, car ce serait aplatir ce qui l’est déjà. Il en faudrait plus pour élever le non-sens au rang d’un des beaux-arts. Par moments, une échappée dans le ton donne l’illusion que l’on est dans une BD filmée par Alain Resnais. De trop courte durée, hélas. Au début, on craint le retour en force de la prostate ; en fait, c’est du nombril en majesté qu’il s’agit, directement, métaphoriquement ou subliminalement. Il y a des histoires de perdrix dont on croit comprendre qu’elles ont faire rire, s’étrangler ou inquiéter Staline, Kalinine, Khroutchev, Brejnev (mais moi, rien, si je puis me permettre). Titres et intertitres déconcertent.
On sent qu’il s’est bien amusé à brocarder ainsi l’esprit de sérieux ; facile de deviner son petit sourire penché sur la page ; pas contagieux, hélas. Peut-être s’est-il joué de nous, comme on peut se le permettre à 85 ans, mais non : La fête de l’insignifiance (144 pages, 15,90 euros, Gallimard) n’a rien d’une Plaisanterie. Les personnages, vite guignolisés en pantins pathétiques, parlent d’une même voix. On ne retient rien. Pas un son, pas un trait. Même citer s’avère impossible car rien ne le mérite. A peine des néologismes : « excusard », « conduisible »… Et puis il faut savoir gré à Milan Kundera de déterrer de temps en temps des auteurs français d’autrefois que plus personne ne lit, hélas : la dernière fois Anatole France ; cette fois, Françis Jammes.. C’est tout ? Ah, si, la définition de l’humour comme l’infinie bonne humeur ; sauf qu’à l’examen, l’auteur nous donne lui-même à vérifier, c’est aussi écrit en allemand (unendliche Wohlgemutheit) et c’est de Hegel. Pour le reste, si poussif… Il ne suffit pas de dénoncer la lourdeur de ses contemporains pour apparaître léger. Pesante en est la lecture, heureusement rapide (gros caractères, triple interlignage, peu de pages). Où est passé le rire rabelaisien de Kundera ? (ici dans un Apostrophes de 1984 à lui spécialement consacré)
 On guette la chute, en vain. A la dernière page, rien ne vient. Et l’excipit nous laisse en l’air, pétrifié par le doute tant sur l’auteur que sur le pauvre lecteur : sommes-nous donc si bêtes, comme contaminés par la bêtise dénoncée avec condescendance dans ces pages, que nous n’avions rien vu, rien aperçu, rien compru à la profondeur de cette sotie qui fait le bonheur des critiques (si l’on en croit leurs articles ici ou là) et du public (si l’on en croit l’entrée du roman au plus haut de la liste des meilleures ventes) ? Car immanquablement, à la fin de chaque histoire, on se demande : et alors ? et après ? Rien pourquoi ? « Il est facile à lire mais difficile à comprendre » nous rassure son éditrice espagnole Beatriz de Moura, tout en nous révélant des détails de son prochain livre. Certes… On entend aussi de telles choses à propos de Michel Serres et sa Petite Poucette.
On guette la chute, en vain. A la dernière page, rien ne vient. Et l’excipit nous laisse en l’air, pétrifié par le doute tant sur l’auteur que sur le pauvre lecteur : sommes-nous donc si bêtes, comme contaminés par la bêtise dénoncée avec condescendance dans ces pages, que nous n’avions rien vu, rien aperçu, rien compru à la profondeur de cette sotie qui fait le bonheur des critiques (si l’on en croit leurs articles ici ou là) et du public (si l’on en croit l’entrée du roman au plus haut de la liste des meilleures ventes) ? Car immanquablement, à la fin de chaque histoire, on se demande : et alors ? et après ? Rien pourquoi ? « Il est facile à lire mais difficile à comprendre » nous rassure son éditrice espagnole Beatriz de Moura, tout en nous révélant des détails de son prochain livre. Certes… On entend aussi de telles choses à propos de Michel Serres et sa Petite Poucette.
Pauvreté des dialogues, faiblesse du style, sécheresse de l’exposition. La technique narrative chère à Kundera pourtant éprouvée, inspirée de la partition musicale, cette fois rate son effet. Son goût du fragment ici tombe à plat et ne donne qu’une impression de décousu. L’esprit de sérieux a subi en littérature des assauts autrement plus convaincants. C’est à se demander si, après ce quatrième roman écrit directement en français, il ne gagnerait pas, du moins pour sa fiction, à se remettre à sa langue natale, celle qui lui conférait un authentique génie du conte philosophique le distinguant de la masse des écrivains.
Si l’on osait, et pourquoi n’oserait-on pas, on dirait que Milan Kundera a eu assez d’ironie, de cette ironie mordante, lumineuse, puissante et si réjouissante qui porta ses livres autrefois, pour nous tendre la perche en suggérant par le titre de cette fantaisie que tout cela est effectivement insignifiant. Cette fable qui se veut le livre du rire mérite l’oubli. Finalement, le plus réussi, c’est le bandeau de couverture : un dessin de Milan Kundera.
(« Dessin de Milan Kundera » ; « Jean Echenoz attend son heure » photo Daniel Mordzinski ; « Milan Kundera assailli par un groupie » photo Vincent Bitaud)
1 175 Réponses pour Caprice d’Echenoz, insignifiance du Kundera
bon, je m’efface devant monsieur le petit professeur
Giono n’a pas eu une Libération facile, victime de rumeurs, etc..lot habituel de ceux qui n’ont pas fait suffisante allégeance à l’air du temps.
Intéressante exhumation de Widergänger. quelle est la raison ? manqué un wagon depuis les débats clopinesques.
Attali est un expert en micro-crédit.
Dans le roman de Giono, pour ceux qui aurait eu du mal à comprendre, c’est le narrateur qui parle, inclus dans le « nous » qu’il emploie. (Widergänger)
Je sais bien qu’il doit encore se rencontrer, en cherchant bien, des inconditionnels du narrateur impersonnel façon Zola ou Maupassant, mais tout de même. Même déjà chez Flaubert : « Nous étions à l’étude quand le proviseur entra »…
(Lycée Jean Marboeuf)
Giono n’a pas eu une Libération facile (Phil)
C’est le moins qu’on puisse dire. En tôle, pour un homme qui avait caché des Juifs et des résistants, c’était de la justice pour le moins expéditive. Et sur l’ordre de qui ? Sur celui de Raymond Aubrac, alors haut responsable de la gestion de la Libération en Provence. N’empêche q’on rencontre encore des gens pour traiter Giono de collabo. Il y a des gifles qui se perdent.
Dans le roman de Giono, pour ceux qui aurait eu du mal à comprendre, c’est le narrateur qui parle, inclus dans le « nous » qu’il emploie. (Widergänger)
» Nous étions à l’étude quand le proviseur entra »… Ce « nous » inaugural est un sacré coup de maître, quand n y pense. D’emblée, et jusqu’aux derniers mots du récit,il ôte tout caractère impersonnel à la narration. Celui qui raconte, c’est un de ceux du groupe d’élèves présents à l’étude ce jour-là. J’étais,je suis du groupe, mais je ne vois pas ni ne juge forcément comme les autres membres du groupe. C’est déjà du Giono…
Passouline, est-ce que c’est une invitation à mettre ABP https://adblockplus.org/fr/firefox
L’élection de Finkie à l’Académie redonne des ailes à Mauvaise langue.
Miroir de la méchanceté, de la bêtise, de la prétention, de la société de spectacle, des procureurs & apparatchiks de ts pays qui se valent bien, de la conspiration des agélastes qui l’attendaient au tournant — hommage à Sterne et à Fielding (mais maintenant son montreur de marionnettes à lui serait hautement estimé pour son refus du rire et de la bonne humeur — Cachez ce Punch que je ne saurais voir … TJ Bk XII)
Il faudrait aller une spirale plus loin : insignifiance de la critique.
Personne parmi ts ces amateurs officiels de transgression pour apprécier la métalepse narrative ? Dommage, vraiment.
Le moulin de Pologne, portrait des gens de village tous médiocres et mesquins, est peut-être un écho de ces années difficiles, vengeance tardive.
Le livre est assez prémonitoire, il suffit de changer le village en métropole et la prédiction attalienne se réalise.
Ces mêmes années, Félicien Marceau écrivait un bon livre sur Capri. Espérons que l’impétrant Finkielkraut y fasse référence.
>Ce ne sont que des ombres ?
L’ombre parle aux ombres ?
Il n’en a pas toujours été ainsi sur la Rdl, Widergänger/mauvaise langue, et nous avons une responsabilité collective ( et vous, particulière!) sur le dévoiement constaté de ce lieu.
Au départ, en gros, deux lignes se dressaient en opposition : ceux qui considéraient qu’un blog comme celui-ci ne devait traiter que de littérature et d’art en général, avec considérations esthétiques et exhibition, non des boîtes à outils intellectuelles, mais des catalogues de références détenus par les uns et les autres. Oh, il y avait bien un peu d’ostentasion dans la façon dont celui-ci, ou celui-là, tenait à faire connaître l’étendue de son érudition, mais le plus souvent, l’érudition était bien réelle, l’intérêt pour le sujet non feint, et certains débats (sur des philosophes, etc.) étaient vraiment prenants, même s’ils étaient parfois si « pointus » qu’une béotienne dans mon genre n’y comprenait pas tout, d’autant que la propension à l’obscurité était de mise chez certains ; l’avantage de cette position était que le blog était d’une haute tenue. Les inconvénients, au départ, à part qu’on évitait d’expliquer patiemment à la piétaille de quoi il retournait, ce qui donnait un certain effet « d’entre soi », il n’y en avait guère. Certains débats étaient certes passionnés, mais on évitait les attaques personnelles, les spéculations sur les névroses des uns et des autres, l’affirmation du mépris, bref, tout ce qui rend le blog d’aujourd’hui étouffant, indigeste, et l’alourdit dans la vacuité, si je me peux me permettre cet oxymore.
Cependant, un débat récurrent comme celui autour de l’héritage de la Shoah (j’appelle ça comme ça pour aller vite, vous voyez sans doute à quoi je fais allusion la Mauvaise Langue) a provoqué des dégâts, parce que les barrières de la courtoisie ont cédé, et qu’au nom de la sacro-sainte « liberté d’expression », les insultes y sont allées bon train. Dans le même temps, il y avait une rigidification du blog.
Car une autre sorte d’internautes commençait à fréquenter les lieux, ceux que je pourrais appeler « les curieux innocents ». Ils venaient ici, attirés certes par la littérature, mais aussi par ce que les uns et les autres laissaient échapper de leurs vies et de leurs goûts. J’assimile cette posture à une promenade en ville, la nuit, quand on passe devant des fenêtres éclairées et que, le temps d’un coup d’oeil, on surprend un intérieur, une silouhette, uns scène domestique… Perso j’ai toujours adoré ça, parce que cela enchante mon imagination. Servies en plus au milieu des livres, je trouvais parfaitement raisonnable de laisser traîner, ainsi, des bouts de vie, ramassés ou non.
C’était parfaitement insupportable à quelques uns des beaux esprits de ce blog, qui ne supporte pas l’expression d’une quelconque émotion et qui, barricadés derrière leur savoir brandi comme un bouclier, n’ont que fort peu de cette générosité que les créateurs, généralement, répandent, comme Le Clézio et Rabhi par exemple. De sèches rappels à l’ordre, un certain mépris, ont commencé à s’installer…
Et puis il y a eu la parution de brèves de blog, qui a déchaîné tous les démons d’internet autour de ce blog. Les querelles des uns et des autres ont tourné à une ambiance de matches de catch. Et vous, la Mauvaise Langue, avec votre posture d’imprécateur, avec le fouet avec lequel vous cingliez les doigts de ceux que VOUS ne jugiez pas digne de participer aux débats, vous n’avez pas été le dernier à empoisonner l’atmosphère…
Les choses ont été s’envenimant, jusqu’à ce que le plus grand nombre des internautes qui avaient réellement quelque chose à partager entre eux tournent les talons. Les filles en premier, car les dérives machistes ont envahi le blog, avec de constants rappels à leur sexe adressés aux malheureuses inconscientes qui venaient ici. La seule à qui semblait plaire ce climat de machisme déchaîné, c’était Daaphnée. Il faut dire qu’elle n’aime guère la « concurrence »…
Longtemps, longtemps, j’ai répliqué à ce climat qui grimpait dans la violence, la raillerie, et vous avez raison ML, la méchanceté, en refusant absolument de me servir des armes de ceux que j’estimais pourrir le blog. A une insulte grossière, je répondais par une formule la plus polie possible, mais contenant cependant une réponse de bergère à l’agresseur. Je réclamais inlassablement de la courtoisie dans les échanges, et pauvre de moi, je tentais de « donner l’exemple »; je plaidais pour la bienveillance…
Peine perdue. Les trolls, si je me faisais discrète par exemple, ou si je quittais le blog, trouvaient instantanément une autre tête de turc, TKT en premier. Le seul conseil utile qui ait été donné était d’arrêter de « nourrir le troll », c’est-à-dire d’ignorer absolument les messages émis par ces plaisants personnages, venus ici dans l’unique but de se divertir en se moquant de l’objet de leur mépris. Un certain « Bergeret », sur son blog, a même été jusqu’à revendiquer tranquillement venir troller à mes trousses, ici, juste pour voir comment j’allais réagir, et pour se « réparer » de l’insupportable prétention que j’avais à m’intéresser à la même littérature que lui (dont c’était évidemment la chasse gardée). Et ce, quotidiennement, pendant trois ans, sans aucune pertinence, juste pour ricaner de mes réactions et tenter d’arriver au but suprême : me faire taire…
Depuis, la violence n’a fait que croître, en même temps que les positions des uns et des autres se durcissaient. Perso, j’ai cessé de pratiquer la bienveillance (qu’on assimilait ici à de la faiblesse), et j’ai commencé à renvoyer à ceux qui me déplaisaient, comme Jc, Daaphnée qui attaquait des filles que j’aimais beaucoup, D. qui venait simplement occuper la place sans jamais apporter une discussion qui en valait la peine, Christiane quand elle s’avance sournoisement et part dans ses affabulations (elle est l’amie de Chéreau, Proust doit être assimilé à un écrivain de la spiritualité religieuse et semble croire à l’immortalité, j’ai écrit une histoire érotique en me mettant en scène avec Clopin sur fond de fellation, etc.
Mais je le fais parce que je suis exaspérée, et surtout triste de voir un si bel endroit être ravagé comme ça .
Certes, si c’était à refaire, je crois que tous, enfin tous ceux qui aimaient la Rdl, son hôte, et la littérature, nous nous y prendrions autrement. J’avancerai beaucoup plus masquée, et j’éviterai de « raconter ma vie ». la ML, vous pourriez prendre l’engagement de laisser tomber les fils qui se rapportent à l’identité juive, car vous êtes incapable de traiter de ce sujet en mettant de côté votre subjectivité exacerbée sur ce sujet. D. ou Puck, vos si plaisantes, parfois, plaisanteries, seraient vivifiées par de vrais débats littéraires, et ne seraient pas de petites crapuleries adressées aux personnalités des uns et des autres. Jc, ah, Jc est un cas, parce que lui demander un effort, c’est faire dégonfler la baudruche qu’il ravitaille patiemment, tous les jours, en air vicié. Daaphnée, eh bien, vous pourriez nous parler un peu plus de vous, non comme une sorte de pin-up extravertie, mais comme la femme qui gagne sa vie que vous êtes. Et nous pourrions peut-être, en mettant de côté, chez les plus assidus et les plus virulents participants « sincères » de ce blog, nos plus gros défauts, arriver à déloger les trolls qui, comme les démons chez le Paphnuce d’Anatole France, sont entrés ici, se sont installés comme chez eux, en haut des étagères, sous les tables, et nous regardent de leurs yeux jaunes, avant de souffler sur nous leurs haleines empuanties de bêtise et de méchanceté.
Je vois qu’il y en a qui connaisse. « Hommage à Sterne et Fielding » ? Pas vraiment ! Ce serait plutôt le dernier roman de Yann Moix qui serait un hommage à Sterne. Bien d’ailleurs. Yann Moix est remonté dans mon estime. En plus, il pense lui aussi que la dernière traduction de Alexanderplatz de Döblin, dont on a beaucoup parlé ici (beaucoup trop) est une vraie merde de traduc. C’est une vraie merde de traduc. Et impossible d’en proposer une autre ailleurs étant donné que c’est Gallimard qui a les droits et qu’il n’est pas du domaine public. Donc, la réalité est celle-ci : le grand roman expressionniste allemand des années 20, équivalent à Joyce et Voyage de Céline, eh bien, on n’en a toujours pas de traduction satisfaisante en France. Voilà la réalité de l’Europe de la culture aujourd’hui. La mienne est pourtant cent fois meilleure, impossible à éditer, de toute façon en chantier, donc j’ai laissé tombé. Décadence de l’Europe, omnipotence du fric ! Yann Moix parle aussi très bien de Gide, pour lequel il a une réelle passion, mais toute critique, sans empathie, et ce qu’il dit de Gide est vraiment passionnant. Sur le site de BHL, on peut voir une vidéo d’entretien de Yann Moix avec Frank Lestringant qui a sorti l’année dernière une excellente biographie sur Gide, où ils parlent de Gide.
Après la petite rentrée, comme on nomme désormais la rentrée de janvier, mars est le rendez-vous des poids lourds. Ils convient de les admirer. Ils ont la carte. Le club est sélect : Kundera, Modiano, Le Clézio y côtoient Carrère, Echenoz, Ernaux, Ndiaye, Toussaint…. Autant d’écrivains que l’on a aimés, et que l’on est tout prêt à aimer encore, mais sans complaisance ni indulgence coupables. Sur la durée, certains (Modiano) sont remarquablement constants dans la qualité ; d’autres, moins. Leurs nouveaux livres sont pourtant loués systématiquement par un effet d’emballement médiatique qui demeure l’un des plus étonnants mystères de la vie littéraire. Comme si l’esprit critique renonçait par principe à s’exercer à de telles hauteurs. Il y a là un curieux phénomène de paralysie par l’admiration. De toutes façons, dès qu’un livre est annoncé comme un événement pour des raisons diverses et variées (l’âge de l’auteur, son métier etc), c’est mauvais signe.
L’écrivain semble le seul artiste à échapper à l’examen critique qui lui signalerait gentiment, mais fermement et publiquement, une perte de valeur, une baisse de qualité, une petite traversée du désert. Les plus grands ont connu ça : Welles, Fellini et même Chaplin, pour ne pas parler des dramaturges et des peintres. Les classiques modernes de la littérature, pour peu qu’ils soient encore de ce monde, semblent immunisés contre ce genre de désagrément. Si l’on en croit la critique, ils ne connaissent pas de hauts et de bas contrairement au reste de l’humanité créatrice. On ne peut même pas dire, comme on le fait parfois avec Philip Roth, que lorsque c’est moins bon, c’est tout de même meilleur que la plupart de ceux d’en face.echenoz par daniel mordzinski
Ils racontent des histoires et manifestement, cela leur fait plaisir. Dommage qu’ils n’aient songé à l’art et la manière de le partager. C’est flagrant avec Caprice de la reine (128 pages, 13 euros, éditions de Minuit) de Jean Echenoz. Sept récits, sept lieux, le tout bien emballé, même si la musique de l’auteur y semble assourdie. Rien de ce qui nous avait récemment enchanté du côté de Ravel et de Courir, ou fasciné avec 14, pour s’en tenir aux souvenirs les plus récents. Une impression de déjà lu, et pour cause, certains de ses textes ayant déjà été publiés ailleurs. Or, comme le savent d’expérience éditeurs et fleuristes, un lien jamais ne suffira à faire un bouquet. Mais surtout quel ennui ! C’est peu dire que l’intérêt y est faible ; on ne voit même pas, à la fin de chaque histoire, pourquoi l’auteur nous a amené jusque là. Pas indigne mais vain. (ici un extrait). A croire que la publication de ce livre obéit à un caprice autorisé par l’auteur à l’éditeur, à moins que ce ne soit l’inverse. Vite, le prochain, le vrai ! Le rapport avec le dernier Kundera, outre le statut d’intouchable et l’ampleur de la déception ? Le jardin du Luxembourg. Ils l’ont en partage.
On le sait que depuis quelques temps, de crainte qu’une ou deux voix discordantes ne se manifestent chez ces incorrigibles français, Milan Kundera préfère publier ses livres d’abord à l’étranger ; c’est ainsi que La fête de l’insignifiance est paru en Italie en « Prima edizione mondiale » comme l’indique fièrement le bandeau d’Adelphi ! Précaution inutile car là-bas comme ici, l’accueil fut et sera kunderolâtre. Des amis se rencontrent et se racontent. Voilà. Il nous ôte le goût de raconter l’histoire, car ce serait aplatir ce qui l’est déjà. Il en faudrait plus pour élever le non-sens au rang d’un des beaux-arts. Par moments, une échappée dans le ton donne l’illusion que l’on est dans une BD filmée par Alain Resnais. De trop courte durée, hélas. Au début, on craint le retour en force de la prostate ; en fait, c’est du nombril en majesté qu’il s’agit, directement, métaphoriquement ou subliminalement. Il y a des histoires de perdrix dont on croit comprendre qu’elles ont faire rire, s’étrangler ou inquiéter Staline, Kalinine, Khroutchev, Brejnev (mais moi, rien, si je puis me permettre). Titres et intertitres déconcertent.
On sent qu’il s’est bien amusé à brocarder ainsi l’esprit de sérieux ; facile de deviner son petit sourire penché sur la page ; pas contagieux, hélas. Peut-être s’est-il joué de nous, comme on peut se le permettre à 85 ans, mais non : La fête de l’insignifiance (144 pages, 15,90 euros, Gallimard) n’a rien d’une Plaisanterie. Les personnages, vite guignolisés en pantins pathétiques, parlent d’une même voix. On ne retient rien. Pas un son, pas un trait. Même citer s’avère impossible car rien ne le mérite. A peine des néologismes : « excusard », « conduisible »… Et puis il faut savoir gré à Milan Kundera de déterrer de temps en temps des auteurs français d’autrefois que plus personne ne lit, hélas : la dernière fois Anatole France ; cette fois, Françis Jammes.. C’est tout ? Ah, si, la définition de l’humour comme l’infinie bonne humeur ; sauf qu’à l’examen, l’auteur nous donne lui-même à vérifier, c’est aussi écrit en allemand (unendliche Wohlgemutheit) et c’est de Hegel. Pour le reste, si poussif… Il ne suffit pas de dénoncer la lourdeur de ses contemporains pour apparaître léger. Pesante en est la lecture, heureusement rapide (gros caractères, triple interlignage, peu de pages). Où est passé le rire rabelaisien de Kundera ? (ici dans un Apostrophes de 1984 à lui spécialement consacré)
kunderasollers photo vincent bitaudOn guette la chute, en vain. A la dernière page, rien ne vient. Et l’excipit nous laisse en l’air, pétrifié par le doute tant sur l’auteur que sur le pauvre lecteur : sommes-nous donc si bêtes, comme contaminés par la bêtise dénoncée avec condescendance dans ces pages, que nous n’avions rien vu, rien aperçu, rien compru à la profondeur de cette sotie qui fait le bonheur des critiques (si l’on en croit leurs articles ici ou là) et du public (si l’on en croit l’entrée du roman au plus haut de la liste des meilleures ventes) ? Car immanquablement, à la fin de chaque histoire, on se demande : et alors ? et après ? Rien pourquoi ? « Il est facile à lire mais difficile à comprendre » nous rassure son éditrice espagnole Beatriz de Moura, tout en nous révélant des détails de son prochain livre. Certes… On entend aussi de telles choses à propos de Michel Serres et sa Petite Poucette.
Pauvreté des dialogues, faiblesse du style, sécheresse de l’exposition. La technique narrative chère à Kundera pourtant éprouvée, inspirée de la partition musicale, cette fois rate son effet. Son goût du fragment ici tombe à plat et ne donne qu’une impression de décousu. L’esprit de sérieux a subi en littérature des assauts autrement plus convaincants. C’est à se demander si, après ce quatrième roman écrit directement en français, il ne gagnerait pas, du moins pour sa fiction, à se remettre à sa langue natale, celle qui lui conférait un authentique génie du conte philosophique le distinguant de la masse des écrivains.
Si l’on osait, et pourquoi n’oserait-on pas, on dirait que Milan Kundera a eu assez d’ironie, de cette ironie mordante, lumineuse, puissante et si réjouissante qui porta ses livres autrefois, pour nous tendre la perche en suggérant par le titre de cette fantaisie que tout cela est effectivement insignifiant. Cette fable qui se veut le livre du rire mérite l’oubli. Finalement, le plus réussi, c’est le bandeau de couverture : un dessin de Milan Kundera.
Clopine, aussi si vous ne répondiez pas à toutes les âneries qu’on vous jette à la figure ! Il y aurait peut-être un peu plus de débat au sujet de la littérature ici.
Quant à la Shoah, c’est un sujet qui fâche. C’est normal, il ne peut en être autrement. Quand je parle de la Shoah, il ne s’agit en réalité pas du tout de moi contrairement à ce qu’on pense ici. Ma famille ne sert que d’illustration de problèmes généraux qui se posent à la France et à l’Europe.
Ce que vous prenez le plus souvent pour une marque de mépris n’est pas vraiment du mépris. C’est simplement que le décalage entre votre perception des choses et la chose est souvent tellement abyssale qu’il est impossible d’entrer dans le labyrinthe de quelque explication que ce soit. Et le type de communication via un blog ne se prête guère à la didactique. Si nous avions été vis-à-vis, nous aurions pu prendre le temps de l’explication, de l’étude des textes et nous aurions pu avoir un tout autre rapport. C’est le « genre » littéraire « blog » qui n’est pas adapté à ce que nous y cherchions. C’est un genre un peu limité, étroit du bulbe. Les vrais échanges intellectuels ne peuvent pas en fait y avoir leur place, ni quelque débat profond que ce soit. C’est simplement un truc pour gens moyens qui y trouvent leur compte parce qu’ils ne comprennent pas en quoi c’est moyen. Tout commentaire qui n’est pas moyen sera forcément vilipendé. C’est en somme la loi du genre qui le veut. C’est indépendant de la personnalité des commentateurs. Il ne faut pas en attendre trop.
Ah, la concision !
Un Européen, c’est celui qui a la nostalgie de l’Europe. Milan Kundera nous a appris cela que seul un créateur venu de la fiction pouvait nous apporter. On lui doit d’avoir ressuscité l’idée d’Europe centrale. Contexte et fil rouge de l’essentiel de ses écrits, elle court tout au long de son œuvre comme en témoigne la publication en deux volumes de son Œuvre dans la collection de la Pléiade sous son contrôle vigilant. On peut aujourd’hui (re)lire La Vie est ailleurs, La Plaisanterie ou Le Livre du rire et de l’oubli sans surinterpréter les intentions cachées de l’auteur (critique voilée du régime etc). A condition de ne jamais oublier ce qu’il a voulu faire du roman : un art, et non plus un genre, porteur d’une vision du monde, et dont l’avenir se joue dans la cale de l’Histoire.
Kundera nous a appris à regarder les régimes communistes en action non à travers leur prisme strictement socio-politique mais par les attitudes qu’ils suscitaient chez les citoyens/personnages. Du communisme en particulier, il tira la meilleure des introductions au monde moderne en général. L’impact de son œuvre est indissociable de l’émancipation des peuples de ces pays-là. Elle est des rares à avoir permis, à ses lecteurs emprisonnés derrière le rideau de fer, d’inscrire leur « moi » au sein d’un « nous » jusqu’alors dilué au sein d’une histoire collective. Traitant la politique en artiste radical, il a redonné des noms à des phénomènes, des sentiments et des sensations que le totalitarisme avait réussi à débaptiser. Kundera a regardé la société en adepte du pas de côté et du décalage. Il a revisité les anciennes catégories qui définissaient les grands romanciers d’Europe centrale, celle de la philosophie et du sérieux, pour les remplacer par un rire tout de désinvolture et d’impertinence, par l’humour et l’ironie contre les grotesques du système, et par l’élévation du kitsch au rang d’une catégorie quasi métaphysique. Sa méditation sur l’exil, et l’impossibilité pour l’émigré de rentrer au pays sous peine d’annuler de sa biographie intime ses longues années passées hors de chez lui, est inoubliable.
Il a ressuscité un Occident oublié au sein de notre Occident. La résurgence de cette Atlantide a cassé la vision bipolaire Est/Ouest ; celle-ci n’avait pas seulement écrasé l’identité de la Mitteleuropa : elle avait installé le choc des civilisations dans les esprits. On doit au romancier d’avoir hâté le retour de l’Europe centrale en restituant ses habitants à l’Europe, une véritable révolution culturelle, ce qui n’est pas peu (son article de 1983 sur « Un Occident kidnappé » fait date). Sa vision de l’Histoire n’en est pas moins « idéalisée parfois à la limitkoudelka_watch.1304402853.jpge du kitsch » ainsi que le lui reproche Vaclav Belohradsky dans un article vigoureux de Literarni Noviny repris en français par la revue Books. Selon lui, Kundera n’a pas voulu voir que l’Europe centrale avait été aussi une allégorie de la face sombre du XXème siècle ; il n’en a retenu que l’éblouissante modernité à l’œuvre dans la Vienne de la grande époque pour mieux oublier la haine de la démocratie, le nationalisme anti-Lumières, l’antisémitisme et autres démons. Vaclav Belohradsky pointe la racine de ce tropisme dans une naïveté propre à une conception avant-gardiste de la modernité, en vertu de laquelle le passage du passé au présent permettrait de se libérer des ténèbres. Comme quoi, pour avoir été un fin analyste de la mécanique totalitaire, le romancier n’en serait pas moins victime d’une illusion sur le brouillard qui enveloppe le passé et se dissipe dès que celui-ci devient présent. Il identifie la bêtisekundera.1304402976.jpg à la religion de l’archive, l’illusion biographique, le formalisme littéraire, la recherche génétique. Tout ce qui concourt selon lui à dépouiller un auteur de ce qui n’appartient qu’à lui. Nous sommes donc privés notamment de textes de jeunesse. Le fait est que cette édition épurée est la négation même du travail des historiens de la littérature. . On ne saura pas quand il est passé du rire à l’oubli, et de la tendresse au désenchantement. Ni comment le Kundera tchèque fut aussi engagé que le Kundera français ne l’est pas. Ni les étapes parfois douloureuses qui l’ont fait glisser de sa langue natale à sa langue d’adoption avec tout ce que cela suppose de renoncements. Ni l’évolution du lyrisme insolent, drôle, sarcastique, agressif, mordant, romantique des années de plaisanteries et de risibles amours à l’antilyrisme l’ayant mis à distance des sentiments pour verser dans une ironie qui n’aura conservé que le sarcasme des années d’avant, comme un adieu à l’innocence, prix à payer pour accéder à la sagesse, si Diderot à ses débuts, si Anatole France vers la fin. Ni pourquoi il lui fallu dissocier son art romanesque de tout contexte politique pour lui accorder le statut extraterritorial d’une autonomie radicale. Regrets éternels. On aurait ainsi mieux compris comment un grand écrivain se déhistoricise dès qu’il se veut universel.
oui la traduction de « Berlin Alexander Platz » est mauvaise, mais Gallimard doit bien pouvoir accepter une nouvelle version de ce roman des années 30. Gide a fait sauter de cette manière le premier traducteur (Belge) des romans de Conrad. Certes, à cette époque le fils de marchand d’art Gallimard obéissait aux ordres. En trois générations les boutiquiers ont repris le pouvoir.
Onze ans après “L’Ignorance”, Milan Kundera, 85 ans, revient au roman : mettant en scène une bande d’amis, “La Fête de l’insignifiance” fait l’éloge de la bonne humeur dans un texte sautillant.
Depuis les années 70 et La Valse aux adieux, Milan Kundera déclare après chaque nouveau roman qu’il n’en écrira plus. Récemment, on avait presque failli y croire : son dernier roman, L’Ignorance (2003), commençait à dater, et depuis il n’avait publié que deux essais littéraires (Le Rideau en 2005, Une rencontre en 2009). Et voilà que, incorrigible, il nous refait le coup du “retour au roman”, avec refus de toute interview pour maintenir la légende.
On remarquera que plus les écrivains vieillissent, plus ils signent des livres minces (voir Philip Roth), et La Fête de l’insignifiance ne déroge pas à la règle : un roman bref, à la typographie pour malvoyants, qui contient dès son titre, comme tous les précédents romans de Kundera, le concept qui en constitue la colonne vertébrale et tout l’enjeu.
L’insignifiance libère
C’est ainsi la nécessité de venir nous parler de l’insignifiance qui a poussé Milan Kundera, 85 ans, à sortir de sa retraite. L’insignifiance, donc : “Quand un type brillant essaie de séduire une femme, celle-ci a l’impression d’entrer en compétition”, déclare l’un des personnages. “Elle se sent obligée de briller elle aussi. De ne pas se donner sans résistance. Alors que l’insignifiance la libère. L’affranchit des précautions. N’exige aucune présence d’esprit. La rend insouciante et partant, plus facilement accessible.”
Le roman se découpe en courts chapitres puis en fragments, tous titrés d’une phrase très simple en italique, et met en scène une poignée d’amis – Alain, Caliban, Ramon, Charles et un certain D’Ardelo, qui revient sans que les autres l’apprécient vraiment –, qui se rencontrent, se racontent leurs problèmes ou des anecdotes, des blagues en forme de paraboles. Qu’est-ce qui les agit, quel est le fil qui les mène ? Nulle analyse psychologique chez Kundera, juste des mots, des faits, des souvenirs et des rêves – au lecteur de s’en débrouiller. Ce roman irrésumable, dépourvu de centre, sans véritable fin et au début très vague, est parcouru de leurs grandes et petites interrogations, de leurs grandes et petites déceptions, et de l’indéfectible bonne humeur de Kundera, qui semble prendre plaisir, comme l’un de ses personnages, à participer “à ce non-sens qui le captivait justement parce qu’il n’avait aucun sens”.
N’est-ce pas là la vision de l’existence qu’a toujours livrée Kundera de roman en roman ? De tous, ce dernier, conçu comme une fantaisie, semble être la synthèse rapide et légère. Kundera y revisite même ce qui a sans doute généré chez lui cette vision absurde du monde – le soviétisme –, à travers les petites histoires que se racontent ses protagonistes à propos de Staline. Si la réalité n’est que représentation, déclare un Staline citant Kant et Hegel, alors il aura su imposer sa vision unique aux Russes, pour leur éviter le chaos de visions multiples. Car tout serait dans le regard que l’on porte sur les choses – même l’insignifiance ?
Théâtre de marionnettes
A la fin, lors d’une scène quasi surréaliste dans le jardin du Luxembourg (un chasseur-acteur tire à la carabine sur un autre acteur qui essaie de pisser contre les statues des reines de France), les personnages s’en amusent comme s’il s’agissait d’un épisode insignifiant, plutôt que de s’en alarmer : “L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence. Elle est avec nous, partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir : dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs.”
Kundera serait-il sorti de son silence pour dénoncer notre époque rompue à “l’insignifiance” ? Ou pour en faire l’apologie ? Car elle serait la clé de la sagesse, de la bonne humeur et du rire : “Nous avons compris depuis longtemps qu’il n’était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d’arrêter sa malheureuse course en avant. Il n’y avait qu’une résistance possible : ne pas le prendre au sérieux.” Et tout le texte de Kundera est ainsi, gai et presque sautillant, traversé de part en part d’une excellente humeur, au risque de le rendre lui-même insignifiant. Et de nous laisser sur notre faim, nous ayant placés trop souvent au-dessus de la mêlée de l’humanité, c’est-à-dire du côté de l’écrivain et de son rire.
Or l’écrivain est-il ce démiurge en surplomb des humains, qui tire les ficelles de ses personnages comme dans un théâtre de marionnettes, pour les amener à illustrer ou à expliquer ses propres théories ? Ou un être parmi les autres, qui partagerait avec le reste de l’humanité défauts, faiblesses et petitesses, et qui ferait de ce savoir la puissance de son œuvre ? Vaste débat.
Clopine dit: 13 avril 2014 à 15 h 05 min
brandi comme un bouclier,
Les boucliers en bois, il en volait une partie à chaque coup d’épée, de hache ou de francisque. Mais c’était léger ! Les boucliers en métal, évidemment ça protège mieux, mais alors dis donc faut le coltiner…
On savait déjà que Milan Kundera n’avait autorisé la publication d’une Pléiade de son Œuvre qu’à la condition exprès de la contrôler de bout en bout en évacuant toute possibilité d’appareil critique, en l’épurant de certains textes et de quelques informations par lui jugés inutiles ou dépassés. On savait qu’il refusait de passer à la télévision. On savait moins que, de tous les auteurs Gallimard qui ont eu à présenter rituellement leur nouveau livre devant les représentants assemblés, il est le seul qui ait refusé la présence d’une caméra, bien que celle-ci ne soit destinée à filmer l’auteur qu’à seule fin de conserver son intervention dans les archives de la Maison. On sait maintenant qu’il est aussi des rares à interdire catégoriquement, et à jamais, que ses textes paraissent sur tout autre support que le livre. C’est son ami Alain Finkielkraut qui l’a révélé l’autre jour en lisant, au micro de « Répliques » sur France-Culture, un extrait du discours en remerciement, prononcé en petit comité devant les mécènes de la Bibliothèque nationale en juin par Kundera, lors de la remise du prix de la BnF 2012 pour l’ensemble de son oeuvre :
« Je n’ai aucune envie de parler de la littérature, de son importance, de ses valeurs. Ce que j’ai à l’esprit en ce moment, c’est une chose plus concrète : la bibliothèque. Ce mot donne, au prix que vous avez la bonté de m’accorder une étrange note nostalgique ; car il me semble que le temps qui, impitoyablement, poursuit sa marche, commence à mettre les livres en danger. C’est à cause de cette angoisse que, depuis plusieurs années déjà, j’ajoute à tous mes contrats, partout, une clause stipulant que mes romans ne peuvent être publiés que sous la forme traditionnelle du livre. Pour qu’on les lise uniquement sur papier, non sur un écran. Cela me fait penser à Heidegger, au fait apparemment paradoxal que, lors des pires années du XXème siècle, il se concentrait dans ses cours universitaires sur la question de la technique, pour constater que la technique, son évolution accélérée, est capable de changer l’essence même de la vie humaine.
Voici une image qui, de nos jours, est tout à fait banale : des gens marchent dans la rue, ils ne voient plus leur vis à vis, ils ne voient même plus les maisons autour d’eux, des fils leur pendent de l’oreille, ils gesticulent, ils crient, ils ne regardent personne et personne ne les regarde. Et je me demande : liront-ils encore des livres ? c’est possible, mais pour combien de temps encore ? Je n’en sais rien. Nous n’avons pas la capacité de connaître l’avenir. Sur l’avenir, on se trompe toujours, je le sais. Mais cela ne me débarrasse pas de l’angoisse, l’angoisse pour le livre tel que je le connais depuis mon enfance. Je veux que mes romans lui restent fidèles. Fidèles à la bibliothèque. »
Milan Kundera paraît en la circonstance fidèle à son éthique et à ses crispations. Lorsqu’il parle de son « angoisse » face au monde immatériel qui vient, il exprime bien le fond de sa pensée. Il est l’archétype de ces personnes terrorisées par ce qu’elles sont impuissantes à maîtriser, voire même à simplement utiliser. Il s’est convaincu que ceci allait tuer cela et que le livre allait mourir. Il est la dernière personne à qui l’on pourrait faire comprendre que le livre et le texte ne font plus un mais deux. Ce n’est pas grave mais son discours vaut par son côté pathétique, dans l’acception la plus noble du terme, et crépusculaire.
Eh oui, Phil ! Ce sont les boutiquiers aujourd’hui qui dirigent la littérature, les traductions en particulier. Il n’est pas rentable pour Gallimard de sortir une nouvelle traduction, d’autant moins quand il a un blog comme celui de Passou qui ne dit pas la vérité au sujet de cette traduction de merde. Et c’est ainsi que l’Europe s’enfonce dans la connerie savante…
kunderadanslesinrocks dit: 13 avril 2014 à 15 h 39 min
beau papier.
Roman
Il est de retour. Avec un roman d’une apparente légèreté, le grand écrivain mène une réflexion sur l’insoutenable absurdité de l’existence.
On aime beaucoup
Les quelque dix années écoulées depuis la parution de son dernier roman, L’Ignorance, et l’édition en Pléiade, en 2011, de deux volumes intitulés Œuvre – un singulier qui semblait bien plus définitif, exhaustif et clos que ne l’eût été la forme plurielle du même mot, « Œuvres » – laissaient penser et craindre que Milan Kundera (né en 1929) avait mis la clé sous la porte. Sans préavis et sans effet d’annonce, continuant par ailleurs à nous enchanter de temps à autre d’un de ces essais sur l’art romanesque qu’il a toujours considérés non comme des écrits secondaires, mais bien comme partie intégrante et essentielle de son corpus – « Un romancier qui parle de l’art du roman, ce n’est pas un professeur discourant depuis sa chaire. Imaginez-le plutôt comme un peintre qui vous accueille dans son atelier… » écrivait-il dans Le Rideau (2005).
Eh bien, nous nous sommes inquiétés pour rien. Voici Kundera de retour, avec La Fête de l’insignifiance, une fantaisie brève, alerte, faussement légère dans laquelle, fidèle à sa manière, à cet « art du roman » qu’il pratique et sur lequel il réfléchit depuis si longtemps, il poursuit son auscultation de l’expérience humaine, armé plus que jamais de cette « part du jeu », ce refus de « l’esprit de sérieux » qui l’attachent à nombre de ses écrivains de chevet, ses aïeux revendiqués, de Rabelais ou Cervantès à Kafka. Attention, qui dit refus de l’esprit de sérieux ne dit pas désinvolture ou superficialité. Comme l’indique le titre du roman, l’affaire dont il va être ici question est d’importance, puisqu’il s’agit de s’intéresser à l’insignifiance comme « essence de l’existence ». Car, voyez-vous, « elle est avec nous partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir : dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. Cela exige souvent du courage pour la reconnaître dans des conditions aussi dramatiques et pour l’appeler par son nom. »
Dans cette Fête de l’insignifiance, on s’attache donc non pas aux aventures – ce serait trop dire… –, mais aux conversations et aux réflexions de quatre amis, Alain, Ramon, Charles et Caliban, affublés d’un cinquième larron nommé D’Argelo. Echanges/apartés/digressions, au fil desquels on se promène notamment dans les allées du jardin du Luxembourg – « là où le genre humain paraissait moins nombreux et plus libre » –, entre les statues des reines de France, quitte à y tomber nez à nez avec un brave chasseur dûment armé, qui traque le quidam osant uriner sur lesdites dignes figures de marbre blanc. On croise aussi, parfois, la mère malade ou absente de l’un ou l’autre des membres du quatuor. On voit Caliban se faire passer à l’occasion pour un maître d’hôtel pakistanais. On apprend – en tout cas on entend… – de quelle façon Staline exerçait son sens de l’humour devant les membres du Soviet suprême…
Et l’intrigue, dans tout cela ? Il n’y en a pas vraiment. En tout cas, rien qui se résume ou se raconte. En fait, voici bien longtemps qu’ouvrant un roman de Kundera on ne cherche pas à se saisir d’un fil romanesque au sens traditionnel, académique du terme. Tel n’est pas le roman que pratique l’auteur de La Plaisanterie, de L’Immortalité, que l’on a parfois lu, à tort, comme un témoin capital de son temps, de l’Histoire – le totalitarisme communiste dans les années 1970-1980, le nihilisme des années 1990-2000 –, alors qu’à ses yeux l’enjeu du geste romanesque n’est pas là. Pour Milan Kundera, la visée du roman n’est pas la représentation, encore moins la démonstration ou la distraction, mais la méditation. Une interrogation scrupuleuse sur la condition humaine, une observation lucide et minutieuse de la mécanique complexe et universelle des émotions et des vertus : le désir, le deuil, le mensonge, l’exil, l’ennui, la honte…
Il y a déjà trois décennies, dans L’Art du roman, Milan Kundera expliquait : « En entrant dans le corps du roman, la méditation change d’essence. En dehors du roman, on se trouve dans le domaine des affirmations, tout le monde est sûr de sa parole : un politicien, un philosophe, un concierge. Dans le territoire du roman, on n’affirme pas : c’est le territoire du jeu et des hypothèses. » (1) Ainsi sont donc Alain, Ramon, Charles et Caliban, D’Argelo, dans La Fête de l’insignifiance : les éléments d’une hypothèse, les valeurs d’une équation dont l’inconnue est encore et toujours l’homme, ses comportements, ses élans, ses passions, sa mélancolie. Mais pourquoi chacun s’obstine-t-il à porter tout ce fatras de sentiments, d’aspirations, de culpabilité… qui le leste et le rive au sol, alors même qu’au cœur de l’énigme humaine on aura beau creuser, on ne trouvera jamais qu’elle : l’insignifiance, « avec toute son évidence, avec toute son innocence, avec toute sa beauté » ?
Tournant autour de son sujet, tout en vivacité, en cocasserie, Kundera évoque ici un Cioran qui, pour une fois, se serait levé de bonne humeur – un Cioran juvénile, gaillard et farceur. En plus de l’art du roman, il maîtrise à merveille celui de toujours nous surprendre.
Extrait
« C’était le mois de juin, le soleil du matin sortait des nuages et Alain passait lentement par une rue parisienne. Il observait les jeunes filles qui, toutes, montraient leur nombril dénudé entre le pantalon ceinturé très bas et le tee-shirt coupé très court. Il était captivé ; captivé et même troublé : comme si leur pouvoir de séduction ne se concentrait plus dans leurs cuisses, ni dans leurs fesses, ni dans leurs seins, mais dans ce petit trou rond situé au milieu du corps… »
ML, c’est le « no future », le punk de la joie tragique.
Le caprice de la Reine, cela a voir avec les friches urbaines ?
http://www.ensnp.fr/ecole/publications.html
Je trouve quant à moi tout à fait inadmissible que Kundera vienne mettre son grain de sel dans lédition critique d’une Pléiade de son œuvre. C’est la dénaturation même d’une édition en Pléiade qui se particularise précisément par rapport aux autres par son appareil critique sans égale qui est d’une grande utilité pour qui s’intéresse de près à un œuvre. Il nous fait chier Kundera !
Widergänger, Tintin également est dirigé par des boutiquiers. Il s’agit d’ailleurs d’un seul boutiquier qui s’est arrangé pour marier l’héritière. Chez Gallimard, bien qu’il fût difficile de marier Gide !, le résultat n’est pas plus brillant. Lestringant et passouline devraient écrire la décadence de la famille, manière Buddenbrook, Verfall einer Familie (titre mal traduit. Verfall est une chute décadente, « ver » donnant l’idée du processus irréversible, involontaire, celui d’une usure à l’usage, verschleiss.
Après ça évidemment, les deux sont bons pour Cayenne (pas en Porsche).
La formidable légèreté de Kundera. Critique de « La Fête de l’insignifiance »
Abonnez-vous
à partir de 1 € Réagir Classer
Partager facebook twitter google + linkedin pinterest
Milan Kundera à Prague, le 14 octobre 1973.
C’est un livre léger comme les plumes qui y volettent. Plumes de perdrix ou d’ange, on en trouve de différents types dans La Fête de l’insignifiance; l’une d’elles surgit tout à coup d’un plafond, au cours d’une soirée, et capte l’attention des convives. Au nouveau roman de Milan Kundera, très attendu –il n’en avait pas publié depuis L’Ignorance (Gallimard, 2003)–, elles donnent quelque chose de leur matière, de leur grâce. De leur capacité à défier la pesanteur. On jurerait même que son mouvement épouse la dansante dérive d’une plume flottant dans les airs.
Mais qu’on ne s’y trompe pas. Fils d’un musicologue, Milan Kundera a toujours accordé la plus grande importance à la structure de ses livres –dont de nombreux, comme L’Insoutenable légèreté de l’être (Gallimard, 1984), empruntèrent leur trame à la sonate. Comme La Lenteur, comme L’Identité (Gallimard, 1995 et 1997), La Fête de l’insignifiance, le quatrième roman en français de l’écrivain né en Tchécoslovaquie, est une fugue, un court et exquis morceau composé de variations autour du même thème, annoncé par le titre.
Insignifiante, l’insignifiance? Certainement pas. «L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence, affirme l’un des personnages. Elle est avec nous partout, toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir: dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. Mais il ne s’agit pas de la reconnaître, il faut aimer l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer.»
LES «BOUSCULANTS» ET LES «EXCUSARDS»
Ils sont quatre, qui occupent le devant de la scène. Alain, abandonné par sa mère à 10 ans, observe les nombrils des jeunes filles, mis en avant par la mode, échafaude des théories sur ce que dit d’une société l’érotisation des ombilics et en élabore d’autres sur la division du monde entre les «bousculants» et les «excusards»; Ramon, l’ancien professeur, aimerait voir une exposition Chagall au Musée du Luxembourg mais renonce chaque fois devant la queue; Charles rapporte une longue anecdote sur Staline et sur les blagues qu’il racontait sans que personne rie jamais, tant il semblait incongru que le petit père des peuples s’essaie à la plaisanterie; Caliban, l’acteur sans rôle, joue les serveurs dans les soirées et, pour s’y distraire, a inventé un faux idiome censé être du pakistanais –une supercherie qui le fait hurler de rire, jusqu’au jour où elle va lui sembler triste à mourir…
Ils se promènent dans les allées du Luxembourg, se retrouvent dans une fête sinistre, disent des choses graves avec légèreté, constatent que les jeune générations ont oublié qui étaient Staline et Khrouchtchev, ou encore qui sont les reines dont les statues se dressent dans le jardin parisien. Ils observent les stratégies de séduction opposées des dénommés D’Ardelo et de Quaquelique, l’un misant (à tort) sur le brio, l’autre s’acharnant à être «insignifiant» – ce qui «libère» la femme convoitée, «la rend insouciante et, partant, plus facilement accessible», note Ramon.
DU PARIS D’AUJOURD’HUI À L’URSS D’HIER
Et puis? C’est à peu près tout. Dans son précédent livre théorique, Le Rideau (2005), le grand écrivain s’élevait contre le «despotisme de la story», cette obligation d’élaborer une intrigue léchée, dont il juge qu’elle asphyxie le roman, et plaidait pour la liberté de l’auteur. La sienne, il l’exerce tout au long de La Fête de l’insignifiance, dans le cadre très construit de la fugue.
Il passe du Paris d’aujourd’hui à l’URSS d’hier sans s’en justifier, met dans la bouche de ses personnages merveilleusement bavards des conversations où il est question de «la bonne humeur hégélienne» ou imagine Staline parlant de «la chose en soi» chère à Kant. Il orchestre le ballet de ses créatures, qui évoquent à l’occasion «notre maître qui nous a inventés», ou se permet d’amusantes interventions (ainsi lit-on: «Alain revit ses camarades dans un bistrot (ou chez Charles, je ne sais plus)»). Il introduit des motifs (plumes, nombrils, marionnettes, coups de poing…) qui reviennent à diverses reprises dans le livre et tissent des échos subtils, puis de plus en plus puissants, entre les parties.
D’un bout à l’autre de son roman, il déploie, avec sa belle clarté et sa concision, toutes les ressources possibles de l’ironie, ce mode d’expression à propos duquel il disait, dans L’Art du roman (1986): «Par définition, le roman est l’art ironique: sa vérité est cachée, non prononcée, non prononçable.» Déplore-t-il le triomphe de l’insignifiance dans notre monde ou s’en réjouit-il vraiment? Impossible de le déterminer. Si ses personnages «sont tous à la recherche de la bonne humeur», Kundera prodigue la sienne comme par politesse, et tant pis si l’époque a perdu le sens de l’humour. L’auteur de La Plaisanterie s’en amuse et offre à son lecteur une fête de l’intelligence. Un roman qui feint la légèreté pour voler plus haut.
Philip Roth, Still Writing (Letters, at Least)
To the Editor:
In his review of Adam Begley’s biography of John Updike (Arts pages, April 9), your reviewer allows that “Mr. Roth has denied” a claim made about him that would have seemed to me unlikely enough on its surface not to bear gratuitous repeating in The Times.
Your reviewer writes, “Claire Bloom, after her divorce from Philip Roth, said Updike’s negative review of Mr. Roth’s ‘Operation Shylock’ (1993) so distressed Mr. Roth that he checked himself into a psychiatric hospital.”
For the record, in the weeks and months immediately after Updike’s March 15, 1993, review of “Operation Shylock” in The New Yorker, I was teaching two classes in literature at Hunter College, giving readings from my book “Patrimony” in Lansing, Minneapolis, Pittsburgh, Cambridge, South Orange and at the New York “Y,” and completing work on the first chapters of “Sabbath’s Theater.”
On March 19 I enjoyed my 60th-birthday celebration at the home of friends in Connecticut and in early June drove to Massachusetts to receive an honorary degree from Amherst College.
PHILIP ROTH
New York, April 9, 2014
The New York Times, April 10, 2014
« le pantalon ceinturé très bas et le tee-shirt coupé très court » : cépabon. Le style de la Redoute à Roubaix…
au moins ça change des petites remarques à la con d’un bouguereau, c’est parfois un peu longuet mais on voit la différence entre l’intelligence d’une part et la connerie de l’autre, manques seulement les bavardages de la mater dolorosa de service pour rigoler un peu
Bé-NI-cassine
Le redire. L’écrire à nouveau. Non, chers cyniques, le roman n’est pas mort ! A force de se pencher sur ce beau cadavre qu’ils croient à la renverse, les tenants de cet éternel cliché ne révèlent que l’étendue de leur ignorance. Le redire. L’écrire à nouveau. Oui, nous avons en France un des plus grands écrivains contemporains. Il s’appelle Milan Kundera et il faut lire de toute urgence son nouveau roman, peut-être le dernier, magnifique, solaire, profond, drôle.
La Fête de l’insignifiance est, d’abord, un éloge de la bonne humeur. Plane sur ce texte, impeccablement construit, le sourire de l’écrivain. On imagine Milan Kundera écrivant – vertige. L’élégance de sa prose, la force de ses personnages, l’absence de tout message et la présence d’un sens. Une légende, déjà, plane au-dessus de ce livre. Dans La Lenteur, Vera, la femme de l’auteur, dit à son mari : « Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux… je te préviens : fais attention : tes ennemis t’attendent. »
La quête de la bonne humeur et de l’insignifiance
Aujourd’hui, Milan Kundera nous offre, en guise d’épilogue, une sottie qui brocarde le mal du siècle : l’esprit de sérieux. Car c’est bien cela dont nous souffrons. Les tyrans et les peuples ont ceci en commun : ils ne savent plus ce qu’est une blague, ont perdu la bonne humeur, ignorent que l’insignifiance est plus créative que tout ce qui brille.
Ainsi les personnages de Kundera se promènent-ils dans l’Histoire et la géographie. L’Histoire, d’abord, avec cette étrange partie de chasse racontée par Staline, au cours de laquelle il tua 24 perdrix, puis les pissotières du Kremlin et la prostate du fidèle Kalinine. La géographie, ensuite, avec ces déambulations dans les allées du jardin du Luxembourg, au carrefour des mille décisions qui forgent une vie. Milan Kundera invente une nouvelle tribu, celle des « excusards », ces hommes et ces femmes qui s’excusent pour tout et pour rien, même d’être nés sans avoir été désirés.
Que dire d’une époque qui fait du nombril – plus que des fesses ou des seins – le symbole de la séduction féminine? Retrouvons cette fameuse bonne humeur à la recherche de laquelle Milan Kundera nous propose de partir. L’insignifiance, telle que la décrit cet admirable roman, est peut-être la sagesse dont a tant besoin une époque qui a désappris le rire et cultive l’oubli. Viva Kundera!
Se gros ratelier qu’il s’est mangé dans les rentrons
Merci!
alepoquesurkundera de 15 h 33
fine analyse entre le kundera tchèque parlant dans sa langue maternelle de son pays natal dvenu communiste en fracture avec l’exilé parisien sous mitterand faisant l’effort d’écrire dans une autre langue et essayant de comprendre le Milieu Littéraire parisien.
Widergänger, en tout cas, je me réjouis de votre retour ici : instantanément, les débats littéraires reprennent. de Kundera, je n’ai guère lu que « la plaisanterie », et je n’aurais pas pensé à l’associer à la « résurrection de la middeleuropa »…
Revuedepressekundera dit: 13 avril 2014 à 16 h 29 min
une époque qui a désappris le rire
C’est horrible, hein ! Quand on est dans des conditions difficiles il y a trois trucs pour survivre : le sport, la gnôle, et la rigolade…
CHRONIQUE
A 85 ans (il est né le 1er avril 1929), Milan Kundera publie un nouveau roman, la Fête de l’insignifiance (déjà paru en version italienne). Cette insignifiance, s’agit-il de la célébrer ou de lui faire sa fête ? Le roman se lit vite : il est bref, divisé en sept parties qui portent des titres comme «Alain et Charles pensent souvent à leurs mères» ou «Ils sont tous à la recherche de la bonne humeur», elles-mêmes divisées en de nombreux chapitres intitulés «Alain découvre la tendresse méconnue de Staline», «Comment on enfante un excusard» ou «La première fois qu’il a été saisi par le mystère du nombril, c’est quand il a vu sa mère pour la dernière fois».
Ce strict découpage pourrait entraîner une écriture resserrée au maximum mais pas du tout. «Je me répète ? Je commence ce chapitre par les mêmes mots que j’ai employés au tout début de ce roman ? Je le sais. Mais même si j’ai déjà parlé de la passion d’Alain pour l’énigme du nombril, je ne veux pas cacher que cette énigme le préoccupe toujours, comme vous êtes vous aussi préoccupés pendant des mois, sinon des années, par les mêmes problèmes (certainement beaucoup plus nuls que celui qui obsède Alain).» C’est comme si l’auteur de la Plaisanterie, Risibles Amours et l’Insoutenable Légèreté de l’être, né tchécoslovaque avant d’être déchu de sa nationalité puis naturalisé français par François Mitterrand (le français devenant sa langue d’écriture avec la Lenteur en 1995), voulait adopter des codes de la littérature pour enfants, passionné qu’il est par le «non-sérieux» et un abord facile de son travail. Mais il a écrit dans l’Art du roman : «Inutile de vouloir rendre un roman « difficile » par affectation de style ; chaque roman digne de ce mot, si limpide soit-il, est suffisamment difficile par sa consubstantielle ironie.»
Le nombrilisme, synonyme d’individualisme excessif, a une mauvaise réputation morale et littéraire. Les premières lignes de la Fête de l’insignifiance évoquent le trouble d’un personnage confronté aux «jeunes filles qui, toutes, montraient leur nombril dénudé entre le pantalon ceinturé très bas et le tee-shirt coupé très court […] comme si leur pouvoir de séduction ne se concentrait plus dans leurs cuisses, ni dans leurs fesses, ni dans leurs seins, mais dans ce petit trou rond situé au milieu du corps». Et comme il est posé que tous les nombrils se ressemblent, ce nombrilisme devient curieusement la chose la moins personnelle qui soit. Et que faire de cet orifice qui en est à peine un ? «Mais comment définir l’érotisme d’un homme (ou d’une époque) qui voit la séduction féminine concentrée au milieu du corps, dans le nombril ?»
Même indétermination autour de «l’inutilité d’être brillant», sa «nocivité», quand l’insignifiance libère en interdisant la compétition et permettant l’insouciance. Et «la valeur de l’insignifiance» renvoie à celle du nombrilisme car «un Narcisse, ce n’est pas un orgueilleux. L’orgueilleux méprise les autres. Les sous-estime. Le Narcisse les surestime, parce qu’il observe dans les yeux de chacun sa propre image et veut l’embellir. Il s’occupe donc gentiment de tous ses miroirs». L’insignifiance est partout, et que penser de «ces chevaliers des droits de l’homme» qui interdisent le suicide (il y a dans le roman une scène très réussie de suicide assassin) et ne sont pas fichus d’empêcher la moitié des hommes d’être «laids» ni de leur permettre de vivre à une autre époque ?
La Fête de l’insignifiance est fidèle aux éléments du roman kunderien tels que François Ricard les définit en préface des Œuvres en Pléiade : «Entremêler les registres (le réel et le rêvé ; l’univers des personnages et celui du romancier), faire se chevaucher des temporalités différentes (l’époque présente et le passé historique), accueillir les fantaisies les plus extravagantes.» Il faut lire la réaction de Khrouchtchev à l’histoire des «vingt-quatre perdrix» de Staline, constater comment les hommes vivent «sans se rendre compte qu’ils s’adressent les uns aux autres de loin, chacun depuis un observatoire dressé en un lieu différent du temps». Divers personnages blaguent, par exemple en inventant une langue fictive (et rien n’est plus difficile que parler une langue qui n’existe pas), sans toujours comprendre que la vraie plaisanterie est ailleurs. Qui sait que le nom de la ville de Kaliningrad symbolise le combat contre l’urine et une prostate peu complaisante ? «L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence. Elle est avec nous partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir : dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs.» La reconnaître exige souvent du courage. «Mais il ne s’agit pas seulement de la reconnaître, il faut l’aimer, l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer.» C’est elle qui est «la clé de la bonne humeur» et que peut-on espérer d’autre que la bonne humeur ? L’insignifiance, c’est aussi ce qui est sans signifiance, du moins préconçue, obligée, elle est comme le symbole léger, insignifiant, d’une liberté à qui le pesant ne convient guère.
parmi ts ces amateurs officiels de transgression
là je trouve que vous exagérez un peu..
Non mais transgresser ça peut pas exister sinon ça sous-entendrait que des limites il y en a… Piège absolu ! Fétide… Ontologique ! A force de déparler comme dirait Exbrayat on finit par dépenser…
la chronique de Lindon donne envie de lire ce livre plus que celle de Passou et des autres
Le « revenu » en impose à bouguereau : aucune déclaration d’icelui.
Il est des écrivains que la traduction bonifie. Poe réécrit par Baudelaire est génial, alors que l’original est d’un platitude ampoulée, truffée de latinismes pesants.
Gabo a déclaré que la traduction anglaise que Gregory Rabassa avait faite de son « Cien años de soledad » était très supérieure à la version espagnole originale.
Quand on lit « Orages d’acier » en français, on oublie qu’on lit une traduction.En l’occurrence, Le bon traducteur/la bonne traductrice, c’est un peu l’homme/la femme invisible…
Kundera est une fête !
Kundera nous a habitués aux fêtes : aux dîners mondains comme aux réunions potaches, aux bêlements avinés de la jeunesse communiste aussi bien qu’aux tintements des coupes que l’on frappe d’une cuillère à dessert avant de porter un toast. Maître en l’art de raconter les rapports humains, de faire valser les points de vue à mesure qu’il se penche sur l’un ou l’autre, passant de la femme à l’homme, du chef au subalterne, de l’envieux à l’envié, Kundera a toujours saisi dans les manifestations de groupe le symptôme le plus exacerbé et le plus savoureux de la nature humaine. Et il nous a également habitués à l’ « insignifiance » – ou, plus exactement, à la si signifiante façon qu’il a de traiter l’insignifiance, cette forme de nihilisme lumineux qui dévoile en souriant l’absurdité de l’existence et les abysses de lâcheté qui conduisent les hommes à gâcher leur vie. Son dernier roman, un court texte qui se lit en un après-midi, de préférence là où il se passe – au soleil, sur un banc du jardin du Luxembourg – peut être considéré comme un condensé de son œuvre et un manifeste de sa poétique.
Aussi Alain, Charles, Caliban et Ramon sont-ils quatre héros kunderiens par excellence : entretenant des rapports problématiques avec leur mère, leur femme, leur fidélité, et tout ce qui a trait au désir de manière générale, ils posent sur le monde – en l’occurrence, le sixième arrondissement, qu’ils habitent presque en parasites, logeant dans des studios ou vivotant en faisant le service dans des cocktails de riches – un regard toujours neuf malgré leur âge. Amis depuis une paye, ils se connaissent et se complètent les uns les autres comme quatre facettes d’un même personnage. Ou plutôt comme les quatre wagons d’un même convoi, lancé à rebours du temps. Staline et son vieux sous-fifre Kalinine, prostate hypertrophiée et déférence placide, font leur apparition au fil des pages, jusqu’à un final quasi fellinien qui symbolise à lui seul l’écriture de Kundera : d’une modernité intemporelle, soucieuse du réel plus que du réalisme, elle envisage le monde comme un théâtre, elle fouille dans l’Histoire ce qui fait fable, dans les souvenirs intimes ce qui fait universel. Voyez Alain, abandonné par une mère qui ne le voulait pas, et obsédé depuis quelque temps par un nouveau « lieu d’or » du corps féminin : le nombril. Le nombril qui devient le motif d’une réflexion sur la filiation et la répétition, sur l’effacement du particulier au troisième millénaire, et sur la « chute des anges », comme le présage le titre de l’avant-dernier chapitre.
Car ce roman désabusé – qui a tout, hélas, d’un épilogue, eu égard aux 85 ans de l’auteur – ne pouvait pas achever une si magistrale carrière en apothéose. Les anges tombent, les héros vieillissent, les belles femmes ne sont plus déshabillées. Résonnant d’une petite musique qu’il suffit d’une seule phrase pour reconnaître comme celle de Kundera, « La Fête de l’insignifiance » place la répétition au cœur de son propos, à l’image du duo Charles-Caliban, inventeurs, pour se mettre à distance du monde bourgeois dans lequel ils évoluent en livrée, d’une langue imaginaire dont ils ont fini par se lasser, sans toutefois réussir à cesser de l’employer. Kundera est trop immense pour se faire prendre au piège du temps. Humblement lucide, le prochain prix Nobel de littérature (on a le droit de rêver…) fait de ses personnages les porte-voix de son monde romanesque : des hommes qui se savent mortels, et qui ne renoncent pas pour autant aux plaisirs de la vie – à une bonne bouteille d’armagnac, fût-elle renversée sur le sol ; aux expressives fesses d’une jeune femme, fussent-elle destinées à un autre ; aux allées d’un parc le dimanche, fussent-elles un deuxième choix pour éviter la cohue devant les toiles de Chagall. La vie n’a pas de sens mais le dernier roman de Milan Kundera est une fête, alors profitons-en !
Milan Kundera : le crépuscule des plaisanteries
Milan Kundera, l’auteur de La Valse aux adieux, qui s’est effacé de la scène publique, revient avec un roman joyeux et cocasse sur l’esprit de sérieux.
Les gestes nous trahissent. Ils sont notre échappée belle. Car nous vivons, de temps en temps, au-delà de nous-mêmes. Ramon se promène dans le jardin du Luxembourg avec un sourire aux lèvres, pendant que D’Ardelo se rend au cabinet de son médecin, avenue de l’Observatoire. Les deux anciens collègues se croisent par hasard, peu de temps après, à proximité des reines de France du parc parisien. D’Ardelo est un Narcisse. Il se mire dans le visage des autres.La conversation s’installe entre les deux hommes. Un parfum de légèreté flotte dans l’air. D’Ardelo s’invente alors une maladie mortelle, comme pour auréoler sa vie d’une gravité dont elle est dépourvue. Il est d’emblée antipathique au lecteur. Mais D’Ardelo lève sa main en un geste timide, en guise de salut, avant de poursuivre son chemin.
L’esquisse discrète d’un au revoir contient sa vérité tout entière. Sa fragilité de Narcisse saisie entre vie et mort. Ramon est ému par le charme du geste. Il perçoit d’un seul coup, à travers une discrète main levée, une part d’inconnu dans le connu. Les hommes et femmes de l’œuvre de Milan Kundera sont traversés par des moments de grâce. Il suffit de penser à l’ouverture de L’Immortalité. Une femme d’une soixantaine d’années, sortant d’une piscine, adresse un ravissant signe de la main à un maître nageur. Elle a soudainement 20 ans. Car nous vivons, en certains moments et par certains aspects, au-delà de nous-mêmes.
À chacun sa partition
Les personnages principaux surgissent, sur la pointe des pieds, accompagnés de leur propre partition. D’Ardelo donne une fête pour son anniversaire ; Alain dialogue avec sa mère absente, dont une photo est accrochée au mur de son studio ; Caliban fait office de serveur à la soirée d’anniversaire donnée par D’Ardelo et s’exprime dans une langue pakistanaise de son cru ; Charles imagine une pièce pour un théâtre de marionnettes et part au chevet de sa mère à l’agonie ; Ramon observe le monde depuis sa retraite et se sent hors de son temps.
La Fête de l’insignifiance est une œuvre inclassable. Un roman, une sotie, une fable, un conte, une pièce, une farce. On y trouve l’histoire des 24 perdrix de Staline, rapportée par Khrouchtchev. Le dictateur raconte une histoire proprement invraisemblable et aucun des sinistres sbires autour de lui ne comprend alors qu’il plaisante. Ils prennent l’anecdote au pied de la lettre alors qu’il s’agit d’une blague. Scène prophétique. Nous sommes entrés dans l’ère du sérieux, du premier degré, du manichéisme, du tout politique. L’œuvre de Milan Kundera se tient à équidistance de la « bêtise idéologique » (l’absence de rire) et de la « bêtise commerciale » (les rires enregistrés).
L’auteur de La vie est ailleurs est né en Tchécoslovaquie en 1929. Il est exclu du Parti communiste en 1950. Il arrive en France en 1975 et publie, en 1976, La Valse aux adieux. Il a choisi de s’effacer de la scène publique. Les personnages de La Fête de l’insignifiance sont des solitudes reliées entre elles par l’éclat coupant de la cocasserie. Alain, Ramon, Charles et Caliban entretiennent un compagnonnage pudique et précieux en dehors des carcans sociétaux. Le style de Milan Kundera est d’une insolence et d’une liberté sans filet. Il évoque une part enfouie de Staline dans son attachement à un pauvre hère souffrant de sa prostate. On y croise des « excusards », des anges et des plumettes, des langues inventées, des bouteilles d’armagnac, des nombrils. La Fête de l’insignifiance, écrit directement en français comme La Lenteur,L’Identité et L’Ignorance, a paru en Italie avant sa publication en France. Son œuvre inclassable de romancier et d’essayiste se pose ici et là : son œuvre est véritablement ailleurs.
Infinie bonne humeur
Milan Kundera le dit : être vivant revient, de nos jours, à être accusé et jugé sans relâche. Nous sommes entrés dans le « crépuscule des plaisanteries » où rien ne doit être pris à la légère. Sinon, gare. L’auteur de La Plaisanterie continue à observer les uns et les autres du haut de « l’infinie bonne humeur » dont il faut être pourvu pour ne pas se détourner de la comédie humaine. Il n’attend pas au coin du bois ; il invite à un tour de manège. Que faire dans ce monde aux ailes d’acier? Il faut jouer et déjouer face aux nombreux « valets de la vérité », prêts à passer les menottes au moindre écart.
La Fête de l’insignifiance est un roman non sérieux sur l’esprit de sérieux ou, plutôt, un roman insoumis sur une société tétanisée. La peur des petites guillotines invisibles, tranchant net tout ce qui dépasse du cadre, s’est infiltrée dans les moindres recoins de l’intimité. « Respirez cette insignifiance », dit Ramon à D’Ardelo. L’insignifiance éclate dans les pires drames ; l’insouciance éclaire les rires des enfants. Car de qui et de quoi sommes-nous les marionnettes, pour marcher avec de telles semelles de plomb? Le romancier nous enjoint à nous départir du sentiment de notre importance pour respirer à pleins poumons notre insignifiance. Nous pouvons nous évader, d’un geste aérien de la main, pour esquisser un au revoir.
malheurs.» La reconnaître exige souvent du courage. «Mais il ne s’agit pas seulement de la reconnaître, il faut l’aimer, l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer.» C’est elle qui est «la clé de la bonne humeur» et que peut-on espérer d’autre que la bonne humeur ? L’insignifiance, c’est aussi ce qui est sans signifiance, du moins préconçue, obligée, elle est comme le symbole léger, insignifiant, d’une liberté à qui le pesant ne convient guère.
Entre l’injonction « il faut aimer.. » et la liberté qui serait l’essence même de l’insignifiance (symbole d’une liberté), n’y a-t-il pas un paradoxe, L’insignifiance n’enferme-t-elle pas dans un registre léger, certes, chargé à la bonne humeur puisqu’il ne se charge de rien ni personne, mais n’Est-ce pas le registre de l’absence du sens, comme un vide sans contenu, sans dessus ni dessous, sans haut sans bas, sans définitions, sans quantité sans propriétés, n’appelant aucun mot et traçant le périmètre d’un babillage qui équivaudrait s’il était silencieux au silence, cher silence? Je lis de l’ironie dans la citation.
renato dit: 13 avril 2014 à 11 h 32 min
Singapore
On s’en doutait un peu, il est aussi nul que l’helvète.
Ne me dites pas que c’est une question d’air.
ça sous-entendrait que des limites il y en a…
faut discuter politique autour d’une barre oblique maintenant ?
l’esprit de sérieux, ah oui je me marre..
Pfft ! « … the Republic of Singapore… is a sovereign city-state and island country in Southeast Asia. »
Mondieu, tant de bêtises, de malhonnêteté intellectuelles, de mensonges et de réécriture de l’histoire concentrés en une seule personne.
Cela paraît impossible et pourtant, Clopine Trouillefou le peut, et s’en vante.
renato dit: 13 avril 2014 à 17 h 50 min
Pfft ! « … the Republic of Singapore… is a sovereign city-state and island country in Southeast Asia. »
Vous n’avez rien trouvé en français ?
réécriture de l’histoire
Est-ce pour « middeleuropa » que vous dites cela ?
« Vous n’avez rien trouvé en français ? »
Mais c’est justement parce que je sais que cela vous irrite que je l’appelle « Singapore »…
kicking dit: 13 avril 2014 à 17 h 44 min
autour d’une barre oblique maintenant ?
Avec de la magnésie c’est bon tout passe et tout lasse et tout casse… Mais y avait un autre truc une espèce de résine avec ça discretos les dix mètres bras seuls the fingers in the nose !
Passou c’est un rusé pire que Napoillone en fait il voulait le promouvoir, le der Kundera, et voilà le travail c’est réussi… Sans Mont-Blanc délier !
La Mitteleuropa c’est topologique tout le monde est d’accord pour le milieu du milieu… Y a que sur les bords que ça s’évapore…
N’y a pas d’lion bien à part, Sergio…
insister dans la pose c’est risquer le musée Sergio
et alors que pense Popaul de toutes ces bonnes critiques, hein ?
Lire la brayonne en délire, un grand moment d’effarement dit: 13 avril 2014 à 17 h 51 min
J’en ai été effaré aussi. Je croyais pourtant avoir tout vu.
Elle est inépuisable…
kicking dit: 13 avril 2014 à 18 h 24 min
insister dans la pose c’est risquer le musée
Ha oui y a des mecs dangereux… Charlotte de Corday !
t’aimes imposer..
mais pas bien à part, c’est vrai..
possible que cela soit mieux quand on a l’idée qui permet de le faire..
« l’insignifiance est la clè de la bonne humeur », c’est pour cela qu’on lit la mauvaise humeur de certains « critiques »… je vais lire ce livre, na
@ oui oui
Popaul il pense que le poids et l’importance littéraire de Kundera, son apport, l’originalité évidente de ses débuts,lrévokution étonnante, des précédents romans, leur complexité, leur intelligence politique et littéraire, leur drôlerie ,leur gai désespoir,crissante, la construction fuguée des thémes, si habile, si inspirée par les leitmotiv musicaux -son père fut un grand pianiste- , et aussi n’oubliez pas le poids énorme des articles écrits sur lui et ses œuvres, tout ça forme un impressionnant « sur- moi littéraire » qui pèse, marque, et nourrit la critique..et entrave le libre examen du dernier opus.. ça bouche un peu la vue, influence la critique forcement..et ça a pesé de toute ses forces sur la lecture des critiques qui n’ont pas lu attentivement ce récent texte ; car il est si mal cousu,si hésitant, il laisse en plan personnages mêle pas dessinés,, touille les thèmes dans un curieux enfermement.., et forme une sorte de brouillard amer.. il n’en ressort rien qu’un dégout de l’époque actuelle .
un peu court..
Enfin, relisons avec passion « la plaisanterie » « la vie est ailleurs», « la valse aux adieux et » l insoutenable légèreté de l’être. « Le Kundera tchèque je le trouve percutant, drole, neuf, étincelant, âpre, insolent, goguenard, diabolique, sur le monde des années de plomb en Tchécoslovaquie.. de plus, j’aime énormément le critique littéraire Kundera qui traite bien d’ Hermannn Broch ou de Kafka…
Pas d’accord avec Pierre Assouline, sur ce coup-là. Autant j’ai pris du plaisir à lire La fête de l’insignifiance, autant j’ai trouvé le Echenoz vraiment mauvais, pour ne pas dire catastrophique, extrêmement mal écrit… Un vrai fond de tiroir. Comme quoi, chacun sa lecture.
Avec celles de Philip Roth et de J. M. Coetzee, l’œuvre de Milan Kundera est la plus libre et la plus iconoclaste de ce temps, parce qu’elle pousse à l’extrême les interrogations sur la vie et sur les abîmes qu’elle dissimule, tout en fustigeant les saccages de l’Histoire, les mensonges des idéologies – communistes ou libérales –, l’oppression sociale orchestrée par les marchands de vertu et par tous ces «charognards» qui, au nom des avenirs radieux, rêvent de faire main basse sur ce que les individus ont de plus sacré – leur intimité.
Et si les romans de Kundera ont tant de force, tant de poids, c’est parce qu’ils ne se contentent pas de nous divertir en racontant des histoires: la littérature, pour lui, est un exercice de haute vigilance face à une humanité qu’il met en scène avec tous ses travers mais, aussi, avec ses rêves les plus secrets. Aussi a-t-il construit ses livres comme autant de «sondes existentielles» lancées vers les horizons brouillés d’une époque dont il aura décrit toutes les impasses, toutes les illusions.
Et si cette époque-là se transforme en un gigantesque champ de ruines, sous sa plume incendiaire, il a su lui offrir une thérapie libératrice, la plus précieuse des rédemptions: ce rire à la fois nietzschéen et rabelaisien qui fracasse son écriture en dégoupillant nos préjugés, nos dogmes, nos certitudes.
L’ironie de Kundera? Du napalm. C’est pourquoi ses personnages sont si désemparés face à ce démiurge cruel qui se joue d’eux comme s’ils étaient des pantins dérisoires, des ombres fragiles confrontées à des spectres monstrueux: la perte de l’identité, la tragédie de l’oubli, le cynisme des régimes totalitaires, les aveuglements de la sentimentalité kitsch, le grotesque de la gesticulation érotique, la dictature du paraître, la tyrannie de l’image, le moralisme épurateur, les laminages du conformisme planétaire, la sotte euphorie de l’homo festivus, autant de cibles contre lesquelles Kundera n’aura cessé de s’acharner, dans ses dix romans.
Publié l’an dernier en Italie en première mondiale – chez Adelphi, dans une traduction de Massimo Rizzante –, composé presque secrètement à l’insu de tous, La Fête de l’insignifiance est le quatrième roman de Kundera écrit directement en français: un récit en sept chapitres – vieille technique kundérienne – qui se refuse à la narration linéaire traditionnelle pour s’orchestrer comme une partition musicale éclatée où, sur une trame minimale sans cesse interrompue, sans cesse ravaudée par une main virtuose, se font écho motifs et variations. Un art de la fugue, donc, au service d’un conte philosophique à la fois terriblement amer et merveilleusement enjoué, au fil duquel se télescopent présent et passé, rêveries intimistes et tableaux réalistes, paraboles cinglantes et sketches burlesques. Avec cet avertissement: «Jeter une lumière sur les problèmes les plus sérieux et, en même temps, ne pas prononcer une seule phrase sérieuse, voilà La Fête de l’insignifiance.» Comme si le fameux rire kundérien avait pour ultime mission de torpiller une époque qui est devenue tristement comique parce qu’elle a perdu le sens de l’humour: vivre dans cette époque-là, c’est être «accusé et jugé en permanence», dira un des personnages de Kundera.
C’est tout de même un phénomène étonnant que celui de la RdL.
Que chaque billet puisse générer jusqu’à un millier de commentaires.
Nos amis d’outre-Rhin en restent bouche bée.
La France est une nation littéraire. Le Français respecte l’homme politique qui prétend avoir lu.
(Les deux derniers présidents sont un démenti, mais il faut un petit délai pour que les clichés soient vraiment affectés)
Naturellement, seuls une douzaine de commentaires sont pertinents.
Ça fait un pour cent, ou un peu plus.
On pourrait réclamer le tout-littéraire, et ce serait possible, et même légitime.
On couperait 98%, pourquoi pas?
Quand même, c’est triste un blog avec 12 commentaires.
Nous, Prince de Denebwiew, interdisons de reconnaitre à Singapour, sa place géographique en Asie-Pacifique. Nous avons décidé que la Ville-État dorénavant se trouve au large de l’Écosse. Grace au pétrole de la mer du nord, la famille D’JC va pouvoir réaliser ses rêves.
C’était flagrant que Job ne pourrait pas supporter cette légèreté de K.
Rien à voir avec Sterne ?
C’est ce qu’affirme celui qui l’a découvert tardivement et en mode « lecture rapide ».
Et dont on ne sait pas trop par ailleurs s’il a lu La Fête de l’insignifiance.
Bien, bien.
Prenons le cas du personnage affecté du mal de mère, Alain.
« Ce n’est pas la première fois qu’Alain imaginait leur coït; ce coït l’hypnotisait et lui faisait supposer que chaque être humain était le décalque de la seconde pendant laquelle il avait été conçu. Il se mit debout devant le miroir et observa son visage pour y trouver les traces de la double haine simultanée qui l’avait fait naître »
« la barbarie du Moyen-Âge qui est notre avenir »
chouette enfin un peu de distraction
@u. (vous qui parlez l’espagnol comme Cervantes)
daaphnée lui a bien évidemment inspiré ses meilleurs textes (elle est trop bonne et modeste pour s’en vanter)
La fête de la critique parisienne.
Dans le genre, la critique de J. Garcin est aussi géographiquement extrêmement limitée.
Heureusement qu’il reconnait le patron; même en Province, on sait que la rue Rodier existe.
http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=3006
http://www.thisiscolossal.com/2014/04/monument-valley-game/?src=footer
En revanche, Ph. Lançon, impeccable.
Et si Kundera ré-écrivait son livre en tchèque, sa langue maternelle, et confiait à un traducteur doué le soin de le retraduire en français ? On se retrouverait peut-être dans la situation de Poe traduit par Baudelaire, de Jünger traduit par Henri Plard, de Dostoïevski traduit par Markowicz; le texte de Kundera y gagnerait un charme qu’il n’a pas, et ses thuriféraires inconditionnels trouveraient enfin peut-être des raisons valables de s’extasier. La grande erreur de Kundera aura peut-être été d’écrire une partie de son oeuvre dans une autre langue que sa langue maternelle, un peu tardivement dans sa vie, en plus. Le style, cette originalité si éloignée de son origine, comme dit à peu près Chevillard, mais qui a pourtant besoin de s’y originer, ne se conquiert pas aisément. Ce n’est pas que Kundera écrive mal le français. Il l’écrit platement: pour un écrivain, c’est sans doute encore pire que l’écrire mal.
zollers il écrase son gros pif et te bave sur l’oreille de l’autre on dirait 2 coquères..que je te castrarais tout ça moi..ça trainerait pas
..sac a puces
qet des laveries comme ça ça exiss pas..qui sait ici ce que coute une batée de 5 kils ?..hos sechage..c’est la question suivante..bande de bolos comme dirait jicé
je teste un clavier qu’on peu mettre en machine à laver..à part des baveux comme cheuloux je vois pas le point comme ils disent..
Superbe chronique de Mathieu Lindon (l’un des seuls à avoir compris l’importance des écrits de guerre de Gracq).
..c’est vraimnt dla merde..mes pensées litteraires sont toutes fermentées..haaa c’est dégueu..dégage cheuloux t’indisposes
Je peste encore de ce prischt sur mon radio
Bouguereau, tu devrais plutôt essayer le clavier jetable…
Bouguereau, j’ai plutôt l’impression que c’est toi qui indisposes. Et si tu es « indisposé », tu trouveras certainement dans le commerce des dispositifs adaptés à ta corpulence et à ton âge…
Une traduction médiocre d’une des plus grandes œuvres littéraires des années 20 en Europe mais dont on s’empresse de faire la promotion. L’Europe de la culture dirigés par les marchands de lessives.
Un parlement européen au fonctionnement on ne peut plus obscur, des partis financés par des gangster, un président du parlement qui les protège (Schulz, qu’il s’appelle) et qui vous envoie chier si vous n’êtes pas content et s’apprête à monter le plafond de l’argent sale pour le financement des gangster qui vont nous diriger.
Bref, le début du Moyen-Âge planétaire.
Dimitri Prince JCouillornsky dit: 13 avril 2014 à 19 h 28 min
Tiens TKT-Clopine-Rose-renato ont trouvé leur Maître.
Il faut toujours honorer la naissance d’un vrai con.
daaphnée lui a bien évidemment inspiré ses meilleurs textes (elle est trop bonne et modeste pour s’en vanter)
Comment cela ?
A U. ou à Cervantes ?
La remarque me paraît un rien confuse ..
Bon, soyons aimable .. cherchons la lueur ( think positive, U., think positive , si !), ce doit être une allusion à La Galatea.
Hé bien, la réponse est non.
Non.
Non.
Non .
J’ai beau chercher sur mon petit calepin où je note tout – et tout – je n’y étais pas.
D’ailleurs, U. n’aime pas les moutons, moi non plus.
C’est trop con, un mouton !
Baptème serait un vrai con autodidacte ?
Et des écrivains stars qui publient de grosses merdes avec la promotion de presque toute la presse.
Un monde totalement corrompu.
Et on n’a pas fini de nous prendre pour des couillons…!
A force d’écrire des conneries sur la littérature française (pauvre Proust), Michel Alba s’est fait éjecter de la littérature qu’il ne connait pas. Voila pourquoi il ne nous cause plus qu’en allemand. Si sa seconde pièpièce en chantier (chantier, ce doit être le mot) est « moins drôle, elle sera peut-être plus conique!
Michel Alba s’est fait éjecter de la littérature (française).
(Quel week-end, je suis épuisé… Si vous saviez…)
Bonne soirée,
« Et on n’a pas fini de nous prendre pour des couillons…! »
Faut voir, il y a, peut-être, des études de marché bien ficelés…
Chaloux dit: 13 avril 2014 à 20 h 26 min
Bouguereau, j’ai plutôt l’impression que c’est toi qui indisposes
Ben non !
Il est chouette Bouguereau, nous on rigole avec lui, alors qu’avec le vieux schnoque qui joue du crapaud on s’emmerde, mais on s’emmerde.
Titi et Lolo dit: 13 avril 2014 à 20 h 49 min
Titi et Lolo, les bourses molles, plates, vides et sèches de Bouguereau se font ses avocats… Pas une soirée pour moi…
Et des écrivains stars qui publient de grosses merdes avec la promotion de presque toute la presse.
Un monde totalement corrompu.
Et on n’a pas fini de nous prendre pour des couillons…!
Tous des pourris, sauf Mimi.
Non, je plaisante!
Avec la « pensée littéraire » – concept brayonnant – on va en sortir.
Mais si !
Bon, pas tout de suite non plus.
…Heureusement que le clavier « passe en machine »…
Widergänger dit: 13 avril 2014 à 20 h 42 min
« Et on n’a pas fini de nous prendre pour des couillons…! »
Michel Alba, ne prends quand même pas trop d’avance…
Yacine
bouguereau dit: 13 avril 2014 à 20 h 10 min
« je teste un clavier qu’on peu mettre en machine à laver.. »
Profite de l’occaze pour laver ton slip, Bouguereau.
le clavier « passe en machine »…
Ah, Chaloux, là vous avez tort.
Le Boug’ a trouvé !
C’est bien la grande lessive des esprits toutes ces critiques dithyrambiques!
Un éloge de la LEGERETE, oui !
Mais l’INSIGNIFIANCE haussée au rang de symbole de la liberté ( cf. l’une des critique copiée collée ici) !
Non mais, franchement !
Pourquoi pas un éloge de la bêtise ?!
Avec Vera, sa femme, le romancier forme le couple le plus silencieux de Paris.
Mon voisin possède l’un des plus beaux visages d’homme que je connaisse. Un nez de boxeur, un menton de rebelle, des yeux bleus, des rides qui racontent, mieux que tout discours, les épreuves de l’exil, la réflexion constante et lucide. Mon voisin vient d’écrire un livre de 142 pages qui va, comme souvent, intriguer, fasciner, ou peut-être irriter, tous ceux qui se rueront, en ce début avril, pour l’acquérir. A chaque fois, l’écrivain le plus discret, le plus incognito de toute la littérature mondiale, véritable légende vivante, est l’objet d’une immense curiosité suivie d’analyses et exégèses. Qu’a-t-il voulu dire avec ces personnages clownesques et pathétiques ? Comment et pourquoi décide-t-il d’introduire, au milieu de scènes dignes d’un Fellini en folie, d’un Kafka débridé, Staline et l’histoire de ses vingt-quatre perdrix ? Et faut-il s’en tenir à cette belle phrase : « C’est seulement depuis les hauteurs de l’infinie bonne humeur que tu peux observer au-dessous de toi l’éternelle bêtise des hommes et en rire » ? Lorsque je lui dis que le rire, la plaisanterie, la dérision ont déjà parcouru toute son œuvre mais que, cette fois, il va beaucoup plus loin, il me répond par un sourire muet et indulgent. Nous ne sommes pas en « interview » – il n’en donnera aucune.
“J’aime bavarder avec ce couple passé à travers tant de difficultés, tant de réussites, aussi”
Vera, son épouse, une femme étonnante, dont les yeux envoient comme un perpétuel brasillement, qui est habitée par le dynamisme et l’énergie d’une combattante et qui sait organiser, protéger, conseiller, accompagner ce géant aux mots ciselés et choisis, aux phrases si limpides, prépare leur départ au bord de la mer – le temps que le livre sorte. Lorsqu’il publie, en effet, mes voisins quittent la ville. Je suis arrivé de l’autre côté de la rue, le jeu d’épreuves du livre à la main, ayant souligné quelques passages, métaphores, dialogues surprenants de poésie, d’humour, d’absurde. Nous avons bavardé autour d’un verre de prune (41 °). L’appartement est immaculé. Vera en est la grande ordonnatrice. Il y a des livres et des disques vinyles partout, témoins de leur amour pour la musique. Le père de mon voisin s’appelait Ludvik, et fut un grand pianiste, élève de Janacek. Aux murs, quelques tableaux, dont on saisit qu’ils ont été acquis par des êtres qui privilégient la couleur, la force, l’exception, un goût particulier, sans patrie, sans nostalgie. J’aime bavarder avec ce couple qui est passé à travers tant de difficultés, tant de réussites, aussi. L’exil en France a signifié un travail patient et courageux de maîtrise totale de la langue – au point que cet écrivain, né le 1er avril 1929 en Tchécoslovaquie, est parvenu à reprendre toutes les traductions de ses livres précédents. Il a ensuite, à partir de 1993, écrit en français dans le texte, sans appoint. Il en est résulté une langue éclatante de lumière, et cependant énigmatique, subtil mariage de fiction, réflexions, observations, descriptions, avec pour règle suprême : l’essence d’un roman repose sur un art, celui de l’ironie. Et l’ironie se fiche bien d’envoyer des messages.
Mon voisin s’appelle Milan Kundera. C’est un des rares écrivains vivants dont l’œuvre a été publiée dans la Pléiade. Les académiciens Nobel auraient dû, depuis longtemps, lui décerner leur prix. Mais sans doute ne savent-ils plus bien lire.
Avec celles de Philip Roth et de J. M. Coetzee, l’œuvre de l’écrivain tchèque est la plus libre et la plus iconoclaste de ce temps.
«La Fête de l’insignifiance» est son quatrième roman écrit directement en français
Par André Clavel
roman
Milan Kundera
La Fête de l’insignifiance
Gallimard, 144 p.
VVVVV
Avec celles de Philip Roth et de J. M. Coetzee, l’œuvre de Milan Kundera est la plus libre et la plus iconoclaste de ce temps, parce qu’elle pousse à l’extrême les interrogations sur la vie et sur les abîmes qu’elle dissimule, tout en fustigeant les saccages de l’Histoire, les mensonges des idéologies – communistes ou libérales –, l’oppression sociale orchestrée par les marchands de vertu et par tous ces «charognards» qui, au nom des avenirs radieux, rêvent de faire main basse sur ce que les individus ont de plus sacré – leur intimité.
Et si les romans de Kundera ont tant de force, tant de poids, c’est parce qu’ils ne se contentent pas de nous divertir en racontant des histoires: la littérature, pour lui, est un exercice de haute vigilance face à une humanité qu’il met en scène avec tous ses travers mais, aussi, avec ses rêves les plus secrets. Aussi a-t-il construit ses livres comme autant de «sondes existentielles» lancées vers les horizons brouillés d’une époque dont il aura décrit toutes les impasses, toutes les illusions.
Et si cette époque-là se transforme en un gigantesque champ de ruines, sous sa plume incendiaire, il a su lui offrir une thérapie libératrice, la plus précieuse des rédemptions: ce rire à la fois nietzschéen et rabelaisien qui fracasse son écriture en dégoupillant nos préjugés, nos dogmes, nos certitudes.
L’ironie de Kundera? Du napalm. C’est pourquoi ses personnages sont si désemparés face à ce démiurge cruel qui se joue d’eux comme s’ils étaient des pantins dérisoires, des ombres fragiles confrontées à des spectres monstrueux: la perte de l’identité, la tragédie de l’oubli, le cynisme des régimes totalitaires, les aveuglements de la sentimentalité kitsch, le grotesque de la gesticulation érotique, la dictature du paraître, la tyrannie de l’image, le moralisme épurateur, les laminages du conformisme planétaire, la sotte euphorie de l’homo festivus, autant de cibles contre lesquelles Kundera n’aura cessé de s’acharner, dans ses dix romans.
Publié l’an dernier en Italie en première mondiale – chez Adelphi, dans une traduction de Massimo Rizzante –, composé presque secrètement à l’insu de tous, La Fête de l’insignifiance est le quatrième roman de Kundera écrit directement en français: un récit en sept chapitres – vieille technique kundérienne – qui se refuse à la narration linéaire traditionnelle pour s’orchestrer comme une partition musicale éclatée où, sur une trame minimale sans cesse interrompue, sans cesse ravaudée par une main virtuose, se font écho motifs et variations. Un art de la fugue, donc, au service d’un conte philosophique à la fois terriblement amer et merveilleusement enjoué, au fil duquel se télescopent présent et passé, rêveries intimistes et tableaux réalistes, paraboles cinglantes et sketches burlesques. Avec cet avertissement: «Jeter une lumière sur les problèmes les plus sérieux et, en même temps, ne pas prononcer une seule phrase sérieuse, voilà La Fête de l’insignifiance.» Comme si le fameux rire kundérien avait pour ultime mission de torpiller une époque qui est devenue tristement comique parce qu’elle a perdu le sens de l’humour: vivre dans cette époque-là, c’est être «accusé et jugé en permanence», dira un des personnages de Kundera.
Son récit se situe à Paris, pendant quelques jours du mois de juin, entre les jardins du Luxembourg désormais livrés au vandalisme, un studio où trône une bouteille de vieil armagnac, quelques rues du VIe arrondissement et un appartement de snobs où se tiendra un cocktail fellinien, autant de séquences décrites par un narrateur qui se définit comme un «mécréant». Et qui tire les ficelles de son récit avec une ironie gourmande: un théâtre de guignol échafaudé par un marionnettiste qui, dans sa livrée d’Alceste moderne, ne cesse de montrer que l’insignifiance est devenue «l’essence de l’existence», sa forme la plus cocasse et la plus risible.
C’est à ce pitoyable spectacle que seront confrontés les personnages de Kundera, cinq copains accrochés à leur amitié comme à une bouée de survie, cinq réfractaires rescapés de la sottise ambiante. Quaquelique, le séducteur libertin dont le nom semble sortir d’une comédie de Laurence Sterne. Alain, l’éternel «excusard» rongé par la culpabilité depuis que sa mère l’a abandonné, et désormais condamné à observer, dans les jardins du Luxembourg, toutes ces jeunes femmes interchangeables qui exhibent les mêmes nombrils – tristes symboles d’un monde régi par le narcissisme et par «l’uniformité généralisée». Son ami Charles, lui, a hérité de sa mère «l’amour des drôleries» et il gagne sa vie en organisant des cocktails mondains, autant d’observatoires privilégiés de l’inconsistance humaine, autant de théâtres grotesques où l’on verra des cuistres avinés parler de la mort de leurs proches en s’empiffrant de canapés et de tranches de salami. Caliban, le quatrième larron, est un acteur au chômage qui vient souvent donner un coup de main à Charles et qui, dans sa veste blanche immaculée, ressemble à un ange surgi de l’au-delà, les bras chargés de ce qui nous manque le plus aujourd’hui: le sens de l’humour. Sa blague préférée? Improviser un sabir incompréhensible en se faisant passer pour un serveur pakistanais, au risque d’être pris pour un dangereux islamiste…
Reste Ramon, le vieux retraité misanthrope, le non-conformiste mal pensant, le perturbateur qui incarne sans doute la voix de Kundera. Son évangile? Avoir la force et le courage de se moquer de tout, dans une société soumise à la tyrannie de ces «agélastes» dénoncés jadis par Rabelais – ceux qui ne savent pas rire. «Nous avons compris depuis longtemps, lance Ramon, qu’il n’était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d’arrêter sa malheureuse course en avant. Il n’y avait qu’une seule résistance possible: ne pas le prendre au sérieux.» Et d’ajouter, en s’adressant à son copain Caliban: «Dans sa réflexion sur le comique, Hegel dit que le vrai humour est impensable sans l’infinie bonne humeur, écoute bien, c’est ce qu’il dit en toutes lettres: infinie bonne humeur; unendliche Wohlgemutheit. Pas la raillerie, pas la satire, pas le sarcasme. C’est seulement depuis les hauteurs de l’infinie bonne humeur que tu peux observer au-dessous de toi l’éternelle bêtise des hommes et en rire.» C’est ce rire-là, poursuivra le sulfureux Ramon, qui révèle l’insignifiance de notre temps, laquelle «est partout, présente même là où personne ne veut la voir: dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs.»
C’est dire combien les propos de Kundera dérangent et interrogent, avant qu’il ne fasse intervenir un invité surprise, par-delà les décennies: Staline, le satrape mégalo qui se joue cyniquement de ses acolytes, qui se moque à gorge déployée de leur soumission puérile et qui jouit du spectacle de sa propre imposture en tournant en dérision l’absurdité de son gigantesque empire – «une rêverie que le monde entier s’est mis à prendre au sérieux», dira le dictateur, après avoir persécuté jusqu’au fond des pissotières du Kremlin le chef du Soviet suprême, le malheureux Kalinine dont l’incontinence urinaire nous vaut des scènes hilarantes.
La fête de l’insignifiance est sans doute l’ultime message adressé par Kundera à une époque qu’il déteste. Dans cet inventaire des aliénations contemporaines, dans cette fable explosive qui est aussi un bel éloge de l’amitié, il a résumé ses principales hantises. Tout est là, au cœur d’un récit réduit à l’essentiel où le tragique de notre condition se double d’une autre tragédie: celle de la mort du rire. S’il disparaît définitivement, plus rien ne sera permis, prophétise l’auteur de La Plaisanterie, dont l’ombre plane sur ces pages avec une légèreté de funambule. Comme cette plume tombée du ciel que des convives hébétés s’évertuent à attraper, au cours du cocktail. Sans y parvenir, parce qu’elle est le signe des anges, le signe de la grâce, dans un monde décidément trop lourd.
Et un autre beau texte de Labro
Dites, ça ne vous gênerait pas trop de citer la source: Paris Match, 7 avril 2014 ?
Non, parce que Paris Match … , dans le genre à faire pleurer les foules ..
Les ‘tits loups, la suite vous attend, la beauté des garçons. C’est pas pour nous les filles. On tente de piger, mais que pouic, efforts vains.
Comment c’est hole?
Et quand c’est en bas?
Daaphnée, si vous le dites…
Bonne soirée,
C’est pas pour nous les filles. On tente de piger, mais que pouic, efforts vains.
Parle pour toi rose! béré elle a déjà mis l’ordi dans l’lavado et clopine elle s’demande si qu’elle a pas 1 pensée littéraire qui va lui sortir par le trou d’nez épicétou
Comment ne pas aimer les moutons ?
A peine croyable !
http://images.gadmin.st.s3.amazonaws.com/87970/images/buehne/Schwarznasenschafe-1.jpg
c’est pas plus rapide de couper le fil ?
1090: on aura beau dire on aura beau faire je préférerez toujours un mauvais Kundera à deux bons Assouline, c’est comme un bon restaurant à 150 € et edux mauvais à 75
1091 préférerai
c’est combien par tête de pipe?
Tu préférerais ?
Ton voeu est exaucé : Tu es le plus con du billet.
Encore bravo.
Dommage TKT, de peu.
85 ans, Milan Kundera continue de séduire les lecteurs et son dernier roman, « La fête de l’insignifiance », caracole en tête des ventes une semaine après sa sortie, selon le palmarès Ipsos/Livres Hebdo publié vendredi.
Paru chez Gallimard le 3 avril avec un tirage de 30.000 exemplaires, ce court roman jubilatoire a déjà été réimprimé trois fois et atteint à ce jour 60.000 exemplaires. Le récit de Kundera arrive d’emblée à la cinquième place du palmarès des meilleures ventes de romans, derrière Guillaume Musso (« Central Park »), en tête, Anna Gavalda (« La vie en mieux »), Jean-Christophe Rufin (« Le collier rouge ») et Katherine Pancol (« Muchachas »), en quatrième position.
Le célèbre auteur de « L’insoutenable légèreté de l’être » ou de « La plaisanterie » est l’un des rares écrivains à être publié de son vivant, depuis 2011, dans la prestigieuse collection de La Pléiade.
Dans « La fête de l’insignifiance », le lecteur croise dans un Paris mélancolique, Alain, en quête d’une mère qui l’a abandonné, Charles, obsédé par Staline, Caliban, un comédien au chômage qui se travestit en serveur pakistanais, un autre personnage qui feint d’avoir un cancer, des filles troublantes au nombril à l’air et… une femme fatale. Comme dans les précédents livres de Kundera, seuls la fantaisie et l’humour permettent d’oublier la vanité des hommes et l’insignifiance de la vie. Et ce roman peut être vu comme un résumé surprenant de toute son oeuvre. Drôle de résumé. Drôle de rire inspiré par notre époque qui est comique parce qu’elle a perdu le sens de l’humour !
1093:Giscard et Bokassa pissaient côte à côte dans un marigot.
Giscard : » Le fond de l’air est frais… »
Boas sa : » Le fond de l’eau aussi ! «
Le nom de Rabelais est largement usurpé par Kundera.
Il confond, en plus, à propos du rire, la tradition chrétienne qui le prohibe (Lire Pascal, ou Au nom de la rose) et la tradition juive à travers ce proverbe yiddish qu’il exhibe dans L’Art du roman : « L’homme pense, D.ieu rit. » Kundera a rejoint les agélastes.
Et tout le monde quitte le navire qui prend l’eau.
Emigration massive des jeunes diplômés français.
Emigration massive des Juifs qui font leur Alya. Au cours des trois derniers mois, il y a eu plus d’Alya qu’au cours de l’année passée.
Hollande Chute, Valls plane.
Tout va de mieux en mieux, comme dirait JC… Le Moyen-Âge planétaire commence par la France, toujours à l’avant-garde de l’exception culturelle.
On le dit de l’esprit français: parler des choses sérieuses avec légèreté et des choses légères avec sérieux. Serait-ce parce que Milan Kundera est français d’exil, qu’il a si bien intégré cette bonne vieille tradition de l’inaltérable élégance de la légèreté? Ou plutôt, victime lui-même des absurdités de l’histoire, dont il a connu depuis sa naissance en 1929 tous les soubresauts depuis sa Tchécoslovaquie natale, aurait-il appris à jouer avec la fantaisie des histoires individuelles, comme autant de miroirs réfléchissants?
Fête galante et loufoque
Toujours est-il que Milan Kundera sait comme personne osciller entre le grave et l’aigu, le dense et le léger. Qu’il aime construire des récits à plusieurs entrées, et évoquer des personnages en quête d’eux-mêmes. Qu’il est infiniment « pensant », tout en faisant semblant de n’être que « disant ». Dans son dernier livre, La Fête de l’insignifiance, qui était attendu comme une magnifique surprise qu’on n’ose plus espérer -n’oublions pas que Milan Kundera a été starisé de son vivant par une édition de son oeuvre dans La Pléiade en 2011- il nous convie à une fête presque galante, toute remplie de bavardages et de loufoqueries. Alors que L’Insoutenable légèreté de l’être mettait en scène l’ombre d’une ville subissant la peur, la légèreté de son Insignifiance se joue, elle, du rien. Derrière l’inconsistance de ses héros revenus de tout pour n’être allés nulle part, Milan Kundera nous parle de l’absurdité du sens dans une société qui regarde la vie droit dans le nombril (au sens propre et au sens figuré).
Conversations à 4 pas
Court texte, dont le récit est à l’inverse du story-telling, La Fête de l’insignifiance, est composée comme une pièce de comedia dell’Arte, jouée principalement autour d’une scène de verdure, le jardin du Luxembourg, qui accueille les pas et les conversations de quatre amis: Alain, Ramon, Charles et Caliban. Ces quatre se promènent, regardent, s’amusent, devisent et nous font passer de la prostate des amis de Staline aux jeunes filles en fleurs. Alain est fasciné par les nombrils féminins, nouveau lieu de l’érotisme moderne. Ramon aime l’art, mais pas les foules. Il rêve de voir une exposition, celle sur Chagall, mais n’y arrive jamais, car il y a trop de monde. Charles est le spécialiste de l’histoire de Staline. On apprend grâce à lui que le petit père des peuples avait un sens de l’humour, aussi grotesque que sa folie meurtrière. Quant à Caliban, il se fait passer à ses heures pour un serveur pakistanais, inventant un langage qui dupe les ignorants. Cela lui permet d’observer « son petit monde » avec l’impunité d’un travestissement ubuseque. Entre eux, il est beaucoup question de séduction, de non-sens et de mélancolie. La culture était ce qui restait quand on avait tout oublié? Ici c’est l’humour qui reste, après que tout ait été aboli: souvenirs, rêves et illusions… Plus rien ne semble exister dans une époque qui a perdu la mémoire. Même le Carré de la Reine, ce groupe de statues qui rappelle que le Luco a des airs de petit Versailles est aujourd’hui un lieu d’aisance pour promeneurs étourdis.
La séduction n’est plus ce qu’elle était
Fête galante en déroute donc, avec cette pointe de Grand Siècle, où Kundera se mêle à La Fontaine ou La Bruyère. Car ces petites conversations entre amis sont autant de fables sur la société contemporaine. Dans ce dédale où le sens est voilé comme un soleil derrière le nuage, que reste-t-il sinon se fondre soi-même dans le grand océan de l’insignifiance? Le sage fait le singe et sa grimace prend tour à tour des airs de penseur moqueur ou de philosophe promeneur qui constate : « L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence, affirme l’un des personnages. Elle est avec nous partout, toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir: dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. Mais il ne s’agit pas de la reconnaître, il faut aimer l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer. »
On pourrait appliquer à Kundera lui-même les lignes lumineuses qu’Alain Finkielkraut avait consacrées jadis à La Plaisanterie dans son Cœur intelligent :
« Revenu de l’illusion révolutionnaire, mais férocement égalitaire, le rire contemporain proclame haut et fort l’idéal de la désidéalisation. Que l’homme passe infiniment l’homme, qu’il puisse avoir une vocation spirituelle, qu’il ne se réduise pas à ses fonctions organiques, voilà une possibilité que ce rire entend faire disparaître du monde.Il s’acharne contre la transcendance, il ne tolère aucune espèce d’éminence, il traque la grandeur sous quelque forme que celle-ci se manifeste, il venge la médiocrité de l’affront que la supériorité lui inflige, il fait de l’âme une vieillerie, une inconvenance, un objet de chahut et il travaille inlassablement à ce que chacun soit tout d’une pièce : surtout pas de distinction, surtout pas de dissonance, surtout pas de conflit intérieur, surtout pas de remords ! (…) Les bouffons qui jadis tenaient officiellement la dragée haute aux rois sont aujourd’hui les rois adulés et redoutés de la démocratie radicale. Et ils propagent, sur les décombres de la promesse communiste, la chaleur revancharde de la bassesse commune. »
Désormais Kundera a rejoint la foule des « corps qui baisent, qui boivent, qui mangent, qui rotent, qui pètent et qui pouffent. »
Il est difficile de dire mieux !
Il faut dire que question sottise, vulgarité et ‘bassesse commune’, le dénommé Widergänger, crétinisé semble-t-il par l’aigreur, se pose là…
« les lignes lumineuses qu’Alain Finkielkraut »
Sujet pour classe de seconde :
A partir de cet expression pouvez-vous exposer et développer la notion de « figure de style » et plus particulièrement celle d’oxymore.
« de cet »
De cette.
Avant que Michel me taille un short.
Mais non, mais non, Widergänger, l’accord de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis avance… à petits pas mais il avance, tout le reste suivra… certes, cela ne plaira pas aux réincarnations de Cassandre, mais qu’importe : travail égale production de richesses, et avec le surplus d’argent même la production de « biens culturels » (pardonnez-moi l’expression) y gagnera…
Daaphnée vous n’avez pas pris note dans vos carnets de votre période mouton attachée pourvue d’un loup ou période Suzanne. Le gouts évoluent comme les hommes passent et lassent, nous les usons n’est-ce pas plus encore que les années le font, c’est tellement bete.
enfin au dynamisme manifeste et au ton employé, on voit immédiatement que nombre d’entre vous ont du prendre un bon coup de pompe à vélo là où il faut durant le week-end, il nous faudrait une éloge de la pompe à s’en faire éclater le pneu!
« la débâcle de la civilisation qui se produit aujourd’hui sous nos yeux. »
(Alain Finkielkraut)
« On peut refuser la globalisation. On peut vouloir s’enfermer dans son petit univers. Heureusement, ou malheureusement, c’est impossible : le nouveau Moyen-Age est là. Il nous fascine. Il est plein de belles histoires et de promesses ; plein de barbaries aussi. Il nous attend ; à nous d’en faire le meilleur usage. »
(J. Attali)
« Autrement dit, si l’on ne craint pas de recourir à une formule démodée, mais parfaitement judicieuse : c’était une belle journée d’août 1913. »
(R. Musil, L’homme sans qualités)
C’est bien, le mythomane qui se fantasme agrégé, allez, au lit maintenant
L’art du portrait che Giono :
« Il buvait, il était coureur. c’était un grand, gros homme, toujours vêtu d’un rase-pet mastic et de culottes de cheval. Il portait bottes en tout temps. Il avait une tête en bpule à peau violette. »
« Madame, haute et corpulente au pied large, était corsetée tous les jours à six heures du matin ; et corsetée serrée. Elle ne reposait que debout; Son énorme poitrine surplombait le vide et, à force de compression et de retenue sans défaut, elle avait fait passer son ventre dans ses fesses. »
Après avoir pollué pendant des mois le blog d’Attali, vous comptez souiller de nouveau celui-ci, Widergänger?
Widergänger dit: 13 avril 2014 à 23 h 18 min
A ce que je comprends donc, finkie ne rigole pas trop dans la vie…il sera comme chez lui a l’academie…difficile de se marrer quand on est sape comme un zouave avec une piece d’un franc entre les fesses et une épée en bandouliere …
@ “Emigration massive des Juifs qui font leur Alya. Au cours des trois derniers mois, il y a eu plus d’Alya qu’au cours de l’année passée. » nous écrit Michel1954: Emigration massive ? C’est combien en pourcentage ?
Vous parlez de la France ?
Et vous, vous comptez finir vos jours, sur une plage gay espagnole ?
Oui, il y finira bedaine à l’air, avec Phil, l’autre boulet de la RDL. L’illustration parfaite de ce que deux abrutis peuvent faire d’une bibliothèque quand ils n’y foutent pas le feu
le programme lavage rapide, pour mémoire:
« Ces récits, plus ou moins modifiés, ont été publiés dans les ouvrages ou périodiques suivants :
Nelson vient d’une idée de Marie-Paule Baussan : Le Garage, no 1, 2010
Caprice de la reine a été écrit pour Jean-Christophe Bailly : Les Cahiers de l’École de Blois, no 4, janvier 2006
À Babylone répond à une demande de William
Christie et Les Arts Florissants, à l’occasion de la sortie discographique de l’oratorio Belshazzar de Haendel en
octobre 2013
Vingt femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d’une montre fait partie de l’ouvrage de Sophie Ristelhueber, Le Luxembourg, Paris-Musées, 2002
Un extrait de Génie civil est un envoi à Patrick Deville : meeting, no 4, 2006
Nitrox est paru dans Tango, no 1, mai 2010
Trois sandwiches au Bourget s’inscrit dans le cadre d’un projet théâtral en 2014, sur une proposition de Gilberte Tsaï »
C’est curieux tout de même : sur ce blog, où par définition on parle vite, fort, et mal, où les fautes d’orthographe, de frappe et de syntaxe ne sont même plus corrigées, où très peu font l’effort d’être explicite, voilà que j’utilise une formule à la va-vite, dont je reconnais le flou et l’impropriété, mais qu’on va me « resservir » encore et encore, comme si j’avais eu l’arrogance de pondre un concept, et l’avait étalé complaisamment… Ah là là.
« pensée littéraire » : si vous tapez cette expression sur Google, vous tombez bientôt sur un travail universitaire d’un certain M. Martin de Lyon, qui, ignorant que la simple juxtaposition de ces deux termes fait hoqueter d’un rire méchant les petits esprits de ce blog, a consacré un passionnant (et très barthèsien) article à la chose. Je vous en livre la conclusion :,
« Les affleurements de texte de Péguy, Les cahiers de Valéry, les essais de Gide, Les humeurs argumentées de Barthes, les essais et récits de Sarraute, les fragments de Gracq, les passages de Michaux, les récitsessais de Kundera, les leçons de Calvino, la parole inspirée de Duras dans La Vie matérielle ou Le Monde extérieur, l’intuition de Gary dans Chien blanc, les essais inachevés de Queneau, les petits traités de Quignard, le journal de Gombrowicz, les papiers collés de Perros, les livres de lectures de Marthe Robert, les notes de Dominique Aury, les « séductions brèves » de Florence Delay, les réflexions sur l’individualité de Pierre Pachet : autant de formes qui induisent une pensée indocile, irrévérente, hétérodoxe. Ensemble, elles ne feraient pas forcément bon ménage. Un point cependant les rapproche : une liberté de penser, un pas de côté, une manière de se déprendre de l’hypnose collective, une façon de faire face à la moutonnerie ambiante, d’affirmer les pouvoirs de l’individuation, bref, une impuissance à se conformer. De l’histoire hétéroclite et baroque de la littérature du xxe et du xxie siècles comme pensée à l’œuvre, la leçon à retenir n’est pas sacrale. Elle n’est pas non plus théorique. Elle est hérétique. »
Et je me dis que « l’impuissance à se conformer », c’est peut-être bien ça qui affleure chez moi, et qui chagrine tant que l’on doive absolument s’en moquer.
Lisez le reste de l’article, il est fort intéressant et mériterait, à mon sens, d’être commenté !!!
Conclusion
Aujourd’hui, un cycle de lavage dure en moyenne 35 minutes. Le consommateur recherche un lieu convivial où il pourra utiliser le temps de lavage à des fins utiles comme rencontrer d’autres personnes et partager.
Elles sont fréquentées par une population diversifiée variant entre les personnes âgées et les jeunes pas encore équipés. Petit raccourci de la société, la laverie est aussi un lieu de convivialité où l’intimité obligée des maniements du linge favorise une certaine mixité sociale, des échanges et parfois des confidences. On y trouve des parents démunis pour qui l’investissement est trop lourd, des jeunes femmes sans difficultés apparentes, des cadres ou des commerciaux en déplacement et des étudiants.
http://sociop7.canalblog.com/archives/2012/03/06/23693963.html
La France ne comptera bientôt plus que des trolls…
Ou des profs de collège usurpant le titre d’agrégé sur le net…
La France ne comptera bientôt plus que des trolls…
Courage bientôt enfin l’apocalypse, cool c’est pas trop tôt
des poids lourds.
et pas vaches sac…rues
Je lis à l’occasion les billets de Pierre Assouline pour y glaner quelques références, suggestions ou conseils de lecture, mais c’est la première fois que je faisais un saut dans la section ‘commentaires’ de ce blog (ce billet, et celui consacré aujourd’hui même à Pierre Herbart). Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça fait pitié : écrivains, traducteurs, éditeurs, universitaires, critiques et journalistes s’y font allègrement insulter, humilier, traîner dans la boue. Rendus fous de haine et de frustration par une vie remplie d’échecs et de ratages divers, de sinistres vieux messieurs se lâchent dans l’espace commentaires d’un blog, sans même se rendre compte qu’ils se ridiculisent en public. Quand on est un jeune étudiant féru de littérature, voir la génération des anciens se comporter de la sorte a vraiment quelque chose de déprimant.
Quand on est un jeune étudiant gérontophile en littérature, on aime les vieux de la RdL !
Sinon, on court les filles … et on fait des études utiles.
le f
que P.Assouline
ait été déçu n’est pas le moins édifiant de la fable pour lui comme pour ses lecteurs et alii
« … écrivains, traducteurs, éditeurs, universitaires, critiques et journalistes s’y font allègrement insulter, humilier, traîner dans la boue. »
Fallait écrire : écrivains, traducteurs, éditeurs, universitaires, critiques et journalistes s’insultent s’humilient, se traînent, allègrement, dans la boue.
Guillaume « fous de haine et de frustration »
ils se distraient comme ils peuvent (cf le taré qui essaie de fourguer sa propagande de néoco ns-co ns., du matin au soir, sous les applaudissements des ivrognes et racistes)
Objectivement, j’interroge autour de moi bien des gens … et bien les plus intelligents* sont toujours d’accord avec moi !
Bien sûr, il y a ici quelques clodos de la pensée… comme dans les gares, le soir tard, hélas.
* repassez un test de QI : vous allez être surpris des effets de la mal bouffe et de l’eau de vie frelatée sur vos neurones
Merci Mr. Assouline pour cette critique. Et merci à tous les commentateurs pour le plaisir que j’éprouve à les lire.
C’est vrai que c’est toujours plaisant, quoi, de lire des commentaires rédigés par de vieux fachos frustrés et ratés
Tant sont nombreux, et actifs, sur ce blog les vieux-fachos-frustrés-ratés qu’il est réjouissant de lire la pose agréable et enrichissante d’un Grandfou, jeune-humaniste-épanoui-ayant réussi* …
*nous procédons tout de même à une vérification, car on ne sait jamais. Parfois des menteurs se cachent parmi cette jeunesse studieuse qui fait la fierté de notre cher pays…
colin s’en allit au lendit
Où n’achetit ni ne vendit,
Mais seulement à ce qu’on dict
dérobit une jument noire.
La r
La r
La raison qu’on ne le penda
……..
Clément Marot mort à 48 ans sept 1544
Non fais, non,voycy que je dy
Je dy qu’il n’est poinct question
de dire j’allion, ne j’estion
ny se renda ; ny je frappy
je pensais qu’alba était juste impuissant et que c’est ça qui le rendait teigneux en fait il serait gay et espagnol
Voir le mot « roman » sur la couverture d’un livre d’Echenoz de 120 pages me donne l’impression d’une escroquerie littéraire. Est-ce une commande d’éditeur pour une diffusion numérique?
Lire 400 pages sur un écran est une épreuve. Une centaine de pages avec une typographie aérée et la douleur est moindre. Mais est-ce un roman d’un point de vue technique?
Echenoz aurait-il désormais le souffle court?
En 100 pages, ses choix de style pour écrire un « roman » sur les dix dernières années de Ravel sont-ils les bons? Je propose l’appellation « roman numérique » pour avertir le lecteur de cette nouvelle forme de « roman ».
Romel
étudiants, le tableau émergant des conersations est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_et_les_vieillards
émergeant
conversations
pouisqu’ on me sucra un envoisur le « nombrilisme », j’ai préféré relire la référence de votre patron : je veux dire ce livre maître-peut-être culte? -de de Quincey : en français .
ubi est ille reporter ? « invenntus est -sur l’air de incarnatus est?-: nomen Assouline
je signale quand même que le paragraphe philosophes assassinés commence sur ce qui serait une exception française -depuis remise en doute: Descartes!-
et que l’exemple le plus merveilleux qui précède immédiatement est cette « constellation mereilleuse , »glorieuse pléiade de meurtres « qui s’est produite dans l’intervalle compris entre 1588 et l’an 1635 »
soit 47 ans +1
preuve qu’il faut douter de comprendre en long, en large, au -grand -large- et en travers, et de travers!
http://rue89.nouvelobs.com/2010/02/12/il-y-a-des-preuves-que-rene-descartes-a-ete-assassine-138138
une biographie considérée comme un événement
» consacrèrent de longs articles à ce qui était considéré comme un événement éditorial outre-Rhin. »
http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article358
notons que GGMarquez est mort comme Raphael pendant la période Pascale: ce n’est pas insignifiant
assouline vous convie à vous questionner sur la langue « natale » : il convient de ne pas l’oublier , même si ses commentateurs qui ont la carte vous convient à les admirer!
Ils convient de les admirer
il serait inconvenant d’admirer votre patron passou parce que ses lecteurs ne vous convient pas à leur répondre
traducteur de Lobo Antunes
» la « clarification » que requiert le français peut alors être vécue par le traducteur comme un appauvrissement.
clarific
les clarifications de l’incorrigible P.Assouline:
syndrome ****, tocs, hystérique, paranoiaque !!
C.Q.F.D bilitant
serenus epstein-roth
-la créarion est négation!
rené thom
Ce n’est pas le faux qui limite le vrai,c’est l’insignifiant
dans Palimpseste imre toth
la création
une lettre à ne pas raterhttp://www.slate.fr/france/86193/germaine-tillion-gestapo-lettre-resistance:
Je partage l’impression sur l’insignifiance
Monsieur Assouline est malhonnête quand il dit que Milan Kundera dans ses fictions gagnerait à écrire dans sa langue natale. Il oublie que L’Immortalité, L’ignorance, La lenteur, trois romans écrit en français, sont des oeuvres puissantes. Mais peut-être ne les aime-t-il pas non plus. Eh bien tant pis pour lui et bien contents les innombrables lecteurs qui les admirent.
Je suis d’accord concernant La fête de l’insignifiance, je le dirais aussi de L’identité. Mais le reste est parfaitement maitrisé et peu d’écrivains Français arrivent à écrire aussi bien que Kundera, en français.
C’est peut-être monsieur Assouline qui gagnerait à écrire dans une langue autre que le français. Que valent ses romans ? Jamais personne ne me les a conseillés, je doute qu’ils soient aussi bon que, par exemple, L’immortalité. j’en fais le pari et si je me trompe que j’aille au diable.
Pingback: Milan Kundera Święto błahości - recenzja | Kultura Liberalna
Pingback: Remboursez ! | Mahbod's blog


1175
commentaires