
Un repentir sur « Crime et châtiment »
 J’ai traduit Crime et Châtiment en 1995, dans une espèce de hâte, avec le souci constant de rendre sensible ce que Dostoïevski considérait comme essentiel, ce à quoi il passait, de son propre aveu, la majeure partie de son temps en écrivant un livre, la mise en place de l’image, du noyau poétique. Cette image, elle est invisible à la première lecture, et bouleversante d’évidence une fois qu’on l’a vue. Dans Crime et châtiment, c’est la résurrection de Lazare, présente non seulement à chaque page du livre, mais, littéralement, à chaque phrase, par la déclinaison des trois moments du récit l’Evangile selon St Jean, le poids, l’odeur, le pas. J’en ai parlé dans la « note du traducteur » qui terminait le volume, je ne redirai ici que l’essentiel.
J’ai traduit Crime et Châtiment en 1995, dans une espèce de hâte, avec le souci constant de rendre sensible ce que Dostoïevski considérait comme essentiel, ce à quoi il passait, de son propre aveu, la majeure partie de son temps en écrivant un livre, la mise en place de l’image, du noyau poétique. Cette image, elle est invisible à la première lecture, et bouleversante d’évidence une fois qu’on l’a vue. Dans Crime et châtiment, c’est la résurrection de Lazare, présente non seulement à chaque page du livre, mais, littéralement, à chaque phrase, par la déclinaison des trois moments du récit l’Evangile selon St Jean, le poids, l’odeur, le pas. J’en ai parlé dans la « note du traducteur » qui terminait le volume, je ne redirai ici que l’essentiel.
1) La pierre qui bouche l’entrée de la grotte est lourde, et Jésus dit : « ôtez la pierre » — et les notations de poids, de lourdeur, d’écrasement sont constantes à travers tout le roman : la hache est lourde, le temps est lourd, le manteau de Raskolnikov est lourd, la pierre sous laquelle il cache les objets volés est lourde… on n’en finirait pas. Mais, en russe, « lourd » peut aussi vouloir dire « difficile » — et le mot « difficile », troudno, n’est jamais employé dans Crime et châtiment, même quand, logiquement, il devrait l’être. Dostoïevski n’emploie que le mot « lourd », tiajelo. Tout est donc lourd, écrasant, oppressant.
2) Marthe dit « il pue déjà » — et les sensations de puanteur surviennent, elles aussi, déterminantes, à chaque page — la puanteur des rues de Pétersbourg, en été, la puanteur des bistrots, la puanteur de la peinture refaite au commissariat (qui fait que Raskolnikov s’évanouit)… là encore, le thème est obsédant. Mais si le mot « von’ » , puanteur, est très fréquent, le mot zapac’h, odeur, n’est jamais employé. Il est remplacé par un mot rare, et d’usage populaire : douc’h. Ce mot, qui signifie odeur dans la langue paysanne, il signifie, dans la langue de tout les jours, l’esprit, le souffle. Il s’agit donc, vraiment, de l’esprit puant.
3) Jésus dit : « Lazare, sors et viens », — et Lazare sort. — Le motif de la marche est, lui aussi, obsédant. — Raskolnikov n’arrête de pas marcher, compte les pas d’un endroit à un autre. Mais le « pas », en russe, c’est aussi la décision, l’action. Et l’unité de mesure, le « pied », stopa, ou la marche, c’est stoupen’. Un crime, en russe, c’est un pres-touplénié, c’est à dire, littéralement, un pas au-delà, ou par-dessus.
Le livre, dans son ensemble, devient allégorie d’une résurrection non-vue, ni par le personnage principal, ni par le lecteur qui lirait un roman, et non pas un poème. J’ai essayé, à chaque page, de traduire assez large pour permettre cette lecture — bien vainement, je le dis en passant, puisque tout ce que j’ai entendu dire de ma traduction, c’est qu’elle était « moderne », sinon « vulgaire » ou « célinienne » parce que j’avais tenté de respecter le « mal dit », le chaos stylistique apparent qui caractérise l’écriture de Dostoïevski.
Mais le fait est que je vis avec un remords. En travaillant avec des acteurs sur une mise en scène de ma traduction, je me suis rendu compte que je n’avais pas vu la grandeur d’un passage. C’est de cela dont je voudrais parler.
Nous sommes au tout début de la grande scène entre Sonia et Raskolnikov (chapitre IV de la quatrième partie, p. 70 du volume II de l’édition Babel). — Raskolnikov se présente chez Sonia pour la première fois. Il veut lui dire quelque chose, mais, d’une façon ou d’une autre, il ne le fait pas, il n’y arrive pas, et, voyant chez elle une édition de la Bible, il lui demande de lui lire le passage de la résurrection de Lazare.
Au moment où nous sommes, au tout début, donc, il vient d’entrer, et Dostoïevski nous a décrit la chambre de Sonia. Le passage qui nous concerne arrive juste après.
Je le cite tel qu’il est publié.
« Sonia, sans dire un mot, regardait son hôte qui observait sa chambre d’un œil si attentif, si peu gêné, et elle commença même à trembler de peur, comme si elle se tenait devant son juge et celui qui devait décider de son sort.
— Je viens tard… Onze heures, déjà, il est ? demanda-t-il, toujours sans lever les yeux vers elle.
— Oh oui, il est, oui, marmonna Sonia. Oh oui, oui ! reprit-elle, se hâtant soudain, comme si c’était là pour elle toute l’issue pour son âme*, ça vient de sonner chez les voisins… et j’ai entendu, moi aussi… Oui ! »
L’astérique correspond à une note en bas de page, que je cite aussi :
« Dostoïevski emploie ici le mot « isc’hod » — solution — qui signifie également, au sens biblique, exode. »
Ici, quand je relis, tout est accablant. Pourquoi cette tournure bizarre : « onze heures, déjà, il est ? » — est-ce que ça se dit ? Et pourquoi Sonia reprend-elle « Oh oui, il est… » ? et pourquoi « toute l’issue pour son âme » ? — et en quoi le fait qu’il soit onze heures est-il ou non une « issue » ?
Et pourquoi cette note ? Et quel rapport avec l’Exode ?
Que puis-je dire pour me justifier ? J’avais senti quelque chose, j’avais tenté de faire émerger le sens sous le sens, mais je n’avais pas su comment le restituer. Et puis, j’ai été pris par le flot du roman, ou pris par le temps, ou les deux, et j’ai laissé tel quel.
Que dit Raskolnikov en russe, quand il entre ?
Il dit (je translittère) : — Ia pozdno… Odinnatsat’ tchassov iest’ ? — Le russe n’emploie pas le verbe être au présent. Les deux premiers mots signifient, littéralement : « je — tard ». La tournure est très familière, brutale, mais correcte. « Je suis là tard », « je viens tard » — c’est tout cela à la fois. La phrase dit-elle : « je suis en retard » ? — Elle peut le laisser sous-entendre. La phrase suivante dit, littéralement « onze heures il est ? ». C’est une façon très brutale de demander l’heure — un emploi caractéristique pour Dostoïevski d’une langue parlée, directe, qui, réellement, n’avait jamais été prise en compte par les traducteurs français.
Le premier niveau est limpide. C’est la première visite de Raskolnikov chez Sonia. Il se présente à une heure que même un Russe peut trouver indue, et, au lieu de s’excuser, il semble presque agressif. —
Que répond Sonia ?
Translittéré, ça donne ça :
— Iest’, probormotala Sonia. Ah da, iest’ ! zatoropilas’ ona vdroug, kak boudto v etom byl dljia neïo ves’ isc’hod, seïtchas u c’hozijaev tchassy probili… i ja sama slychala… Iest.
Traduisons mot à mot :
— Il est, murmura Sonia. Ah oui, il est ! se hâta-t-elle soudain, comme si en cela était pour elle toute son issue, tout de suite chez les voisins la pendule [littéralement : les heures] a sonné… et j’ai moi-même entendu… Il est.
En russe, quand on répond par l’affirmative à une question, on ne répond pas « oui », mais on reprend le verbe de la question. Ainsi, la réponse de Sonia, en russe, est-elle absolument normale. Mais le verbe « être », du coup, est repris par trois fois.
Et que vient faire ce mot que je traduis par « issue », isc’hod ? C’est un mot très noble, rare — et, oui, biblique. Isc’hod, dans la Bible russe, c’est, de fait, le livre de L’Exode. C’est aussi une façon noble de dire « solution », ou, dans une expression plus courante, mais encore plus connotée, en parlant d’une maladie, le cours, le développement. — En français aussi, on dit « l’issue fatale ».
Ce mot, remarquons-le, reviendra plus tard, toujours non prononcé, dans la conscience de Raskolnikov, quand il réfléchira au destin de Sonia.
Il commence par dire : « Trois chemins pour elle […] — Dostoïevski écrit bien : Tri dorogi : trois chemins — se jeter dans le canal, se retrouver chez les fous, ou bien… ou bien, à la fin, se jeter dans la débauche qui vous embrume l’esprit et qui vous pétrifie le cœur. » Il continue : Cette dernière idée le dégoûtait le plus ; mais il était déjà un sceptique, il était jeune, abstrait et, donc, cruel, voilà pourquoi il ne pouvait pas ne pas croire que la dernière solution, c’est-à-dire la débauche, fût la plus vraisemblable. » — Ici, le mot russe pour « solution» est « vyc’hod » (littéralement, sortie) — et, dans l’édition Babel, j’ai, bien à tort, employé le mot « issue ». Ensuite, Raskolnikov se demande comment il se fait que, dans ces circonstances, Sonia ne se soit pas encore suicidée, et il l’interroge :
— Alors, tu le pries beaucoup, Dieu, Sonia ? demanda-t-il.
Sonia se taisait, il se tenait auprès d’elle et attendait une réponse.
— Qu’est-ce que je ferais, sans Dieu ? chuchota-t-elle d’une voix précipitée et énergique, après avoir soudain jeté sur lui un regard étincelant, et elle lui serra la main très fort.
« C’est ça, elle en est là » se dit-il.
— Et Dieu, pour ça, qu’est-ce qu’Il te fait ? demanda-t-il, interrogeant plus loin.
Sonia se tut très longuement, comme incapable de répondre. Sa petite poitrine était toute bouleversée par l’émotion.
—Taisez-vous ! Ne posez pas de questions ! Vous n’êtes pas digne !… s’exclama-t-elle soudain, lançant sur lui un regard de colère inflexible.
« Oui, oui, elle en est là ! » , se répétait-il en enfonçant le clou.
— Il fait tout ! chuchota-t-elle très vite, rebaissant les yeux.
« La voilà, l’issue ! La voilà, l’explication de l’issue ! » trancha-t-il pour lui-même… »
Et là, « issue » c’est bien ce mot, isc’hod. On ne sait pas très bien ce que veut dire Raskolnikov au moment où il le dit, et il ne le sait pas lui-même, mais c’est après cette réplique intérieure qu’il lève les yeux, regarde autour de lui, et voit la Bible posée sur la commode. La scène est donc, littéralement, issue de ce mot-là.
Revenons donc à notre première phrase et lisons autrement. Qu’en serait-il si Raskolnikov ne demandait pas seulement l’heure qu’il est, mais : « Est-ce qu’il est trop tard pour que je ressuscite, moi ? (Il est encore onze heures, mais pas minuit). Ou bien : Dieu, est-ce qu’il existe encore ? Et si Sonia répondait : Il existe.. (Au nom du Père) Ah oui, Il existe (Au nom du Fils)… Il existe (Au nom du Saint-Esprit). — Ici, ce ne sont plus les personnages qui parlent, — Raskolnikov ne croit pas en Dieu, évidemment — c’est le texte.
Et là, oui, là — serait l’issue.
C’est à ce moment-là que peut se mettre en place la scène fondatrice, celle de la lecture par Sonia de la résurrection de Lazare, — une scène qui commence par cette phrase de Raskolnikov (traduction mot à mot) : C’est où, ici, sur Lazare ? — Et, là encore, c’est cette tournure parlée, à la limite du vulgaire, qui donne le sens du texte (et non le sens du personnage) : la question n’est pas seulement de trouver le passage dans le volume, mais de demander : Tu peux me dire où elle est, la résurrection, dans la vie telle qu’elle, après que j’ai tué ? — Sonia répond : Né tam smotrité — pas là [que] vous regardez. Littéralement, vous regardez au mauvais endroit. Le sens de l’intrigue est limpide, Raskolnikov est comme chacun de nous — qui d’entre nous peut dire, comme ça, dans quel Evangile se trouve le récit de la résurrection de Lazare ? — mais sur ce sens se greffe un autre sens, tout aussi clair une fois qu’on l’a vu : vous ne regardez pas au bon endroit, vous regardez de la mauvaise façon. Vous ne voyez pas comme il faut.
Quand Sonia termine sa lecture, elle dit : Vsio ob veskressenié Lazarja — littéralement : [c’est] tout sur la résurrection de Lazare, et j’avais déjà signalé en note dans l’édition Babel ce qui me paraissait le double-sens fondamental de l’expression : c’est tout, — c’est fini — et, en même temps, c’est tout, c’est le monde entier qui est sur la résurrection de Lazare.
Comment reprendre ma traduction ? Puisque Actes Sud prépare une réédition de Dostoïevski dans sa collection Thésaurus, comment refaire le début de la scène ? Comment traduire de manière à faire sentir le double sens, mais à ne pas l’imposer, à le traduire pour qu’il soit possible et invisible, comme toute lecture allégorique ?
Invité, en 2010, à une table ronde sur la traduction au domaine de Tolstoï, Iasnaïa-Poliana, j’avais basé toute ma conférence sur ce passage, et demandé aux autres traducteurs présents (venus d’une dizaine de pays) comment ils auraient fait, dans leur langue — et j’avais bien précisé que, moi, en français, je n’y étais pas arrivé.
Une chose me paraît impossible, en français, c’est de calquer le russe — ce que j’ai fait, sans justification aucune, dans l’édition Babel. Mon impression est que je ne peux pas reprendre le verbe « être » — quand bien même je le reprendrais trois fois, comme en russe, et non pas quatre. L’essentiel me semble donc de garder la trinité dans la réponse. Cette trinité, elle peut être présente — peut-elle être présente ? — dans une reprise toute simple de la réponse la plus simple que nous ferions, nous, à une question comme celle de Raskolnikov : « oui ».
La phrase deviendrait donc, pour l’instant, quelque chose comme :
— Oui, marmonna Sonia. Oh oui ! reprit-elle, se hâtant soudain, comme si c’était là pour elle toute l’issue pour son âme, ça vient de sonner chez les voisins… et j’ai entendu, moi aussi… Oui .»
Là, je m’arrête, et je me dis que, peut-être, le deuxième « oui », pour refléter davantage l’insistance de Sonia (Ah, da, iest — ah oui, il est), ça pourrait être quelque chose comme « Ah bien, oui ! » Et je pourrais peut-être changer la phrase bancale sur l’issue par quelque chose du genre : comme si elle y voyait là toute son issue. Ou bien : toute l’issue.
Nous aurions donc : Oui, marmonna Sonia. Ah bien oui [peut-être : oh oui alors !) reprit-elle, se hâtant soudain, comme si elle voyait là toute l’issue, ça vient de sonner chez les voisins… et j’ai entendu, moi aussi… Oui.
Je me suis débarrassé de tous les signes de ponctuation intempestifs — qui n’étaient là que comme des traces de ma lecture hâtive.
Mais comment faire pour la première phrase ? Comment enlever cette absurdité : onze heures, déjà, il est ?
Si je disais, par exemple :
— Je viens tard…. Dans les onze heures, oui ?
Dans la situation, que dirait-on ?… Et est-ce que ça se dit, dans les onze heures ? on dirait, tant qu’à faire : il doit être dans les onze heures, oui ? — sauf que ce « il doit être », il me donne trois syllabes supplémentaires, deux secondes de plus à dire, et toute l’énergie de la scène peut être perdue avec ces deux secondes vides.
Cela donnerait donc :
— Je viens tard…. Dans les onze heures, oui ?
— Oui, marmonna Sonia. Ah bien, oui, reprit-elle, se hâtant soudain, comme si elle voyait là toute l’issue, ça vient de sonner chez les voisins… et j’ai entendu, moi aussi… Oui.
Je ne peux pas dire que je sois particulièrement fier du résultat.
Françoise Morvan, qui a relu toutes mes traductions de Dostoïevski avec la même acuité infatigable et la même patience, et à qui je soumets ce texte, me propose, au contraire, de garder le « il est » du mot à mot. Il faut, au contraire, me dit-elle, changer la ponctuation, et changer le rythme, pour mieux garder l’idée. Pour elle, cela donnerait :
— Je viens tard… Il est — déjà onze heures ?
— Il est — oui, murmura Sonia. Ah oui, reprit-elle, se hâtant soudain, comme si elle voyait là l’issue de tout, ça vient de sonner chez les voisins… et j’ai entendu, moi aussi… Oui.
Une solution totalement inverse : d’abord, garder « il est » pour laisser sa présence à l’image fantôme (et à la présence de l’être invisible) et légitimer l’émergence de cet « il est » par la ponctuation ; ensuite, garder le mot « issue », mais en lui donnant un rôle plus clair (c’est parce que Sonia voit dans cet « il est » l’ultima ratio, le mot de la fin, l’issue fatale, mais aussi la solution qu’elle hésite, et répète trois fois « il est »).
À l’heure où je termine cette note, je ne sais toujours comment je dois corriger les épreuves que j’attends d’ici une semaine.
Peut-être, tout simplement, faire une autre note en bas de page, pour remplacer la note malencontreuse de la première édition et expliquer pourquoi je ne peux pas traduire ?
ANDRE MARKOWICZ
(« André Markowicz » photo Françoise Morvan ; « Fédor Dostoïevski » photo Novosti)
Dostoïevski
Crime et châtiment (Преступление и наказание), 1866
Traduction d’André Markowicz, nouvelle édition 2013
10,90 euros
480 pages
Babel/ Actes sud
12 Réponses pour Un repentir sur « Crime et châtiment »
réflexion passionnante pour un livre dont cette traduction :
m’avait emballé, dix ans au moins après l’avoir lu dans une poussiéreuse version (à l’adolescence il est vrai)
et m’a donné la passion de dosto.
il ne me reste plus qu’à insérer ce billet, imprimé, dans mon livre !
Bravo!
D’accord ou pas, voilà la réflexion critique, sur textes, qu’on attend d’un grand traducteur…
J’espère bien avoir le temps de repasser.
Всего хорошего, и спасибо за рыбу!
Très belle réflexion.
Petite précision: la façon de demander l’heure de Raskolnikov en russe précise qu’il important pour lui qu’il soit déjà onze heures. Sinon, au lieu de « Odinnatsat tchasov est? » il aurait demandé « Odinnatsati tchasov esho net? » (« Il n’est pas encore 11 heures? » – dans cette deuxième variante ce qui est important, c’est qu’il ne soit pas encore 11 heures).
J’ai donc un peu de mal à adhérer à l’interprétation de ce passage dans sa totalité car la traduction de la première phrase ne me semble pas la refléter totalement en russe…
Bonjour, merci à Daria pour son commentaire. — il y a là, de fait, une nuance d’intonation très fine. Mais, justement, mon interprétation tient sur cette importance étrange pour Raskolnikov de savoir s’il est vraiment onze heures. — Et puis, Raskolnikov parle avec une grande violence, vraiment — la variante proposée par Daria me le démontre une fois encore. Bref, tout est fait dans le texte, me semble-t-il, pour montrer que cette phrase n’est pas anodine. Allégoriquement, il n’est donc pas encore minuit : le temps presse, mais « l’issue » est encore possible…
Monsuer, bonjour.
une remarque que je sens difficile et maldroite de ma part; mais lorsque ‘on arrive à
» une note en bas de page, que je cite aussi :
« Dostoïevski emploie ici le mot « isc’hod » — solution — qui signifie également, au sens biblique, exode. »
il est difficile de comprendre, sans se précipiter vers la suite , à cause de « au sens biblique » expression que beaucop emploient avec le verbe « connaître » !!
on sent bien que ce n’est pas solution au sens mathématique ou pharmaceutique ,le mot russe l’air d’avoir été créé -translittéré sur le même mot de traduction latin,alos que le récit biblique ainisi nommé Exode (shmot littéralement les noms) en français tient tout à la fois d’une question mathématique et « pharmaceutique », d’une certaine façon .
donc issue est une heureuse solution de traduction, mot qui porte aussi en français, la problématique de la parenté -ascendance et
descendants dans les traductions de la Bible notamment-
mais je reste perplexe sur l’usage de l’expression « au sens biblique ».
maldroite> maladroite (etc )
pou exode : en gec aussi d’ailleurs
septante :ΕΞΟΔΟΣ 1 EXODE 1
1
Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ
alos que la dénomination provient du mot du premier verset (rappel incipit) : les noms : en grec τὰ ὀνόματα
impossible de m’appliquer à taper le français
> en grec!
Merci à André M. de poser de vraies questions de traduction et d’en faire part publiquement. Une vraie leçon d’humilité en ce milieu aride, dans le désert de la traductologie—il faut concéder à ce blog et à celui qui le précédait la caractéristique de l’oasis tout à fait rafraichissante.
J’aurais bien sûr souhaité offrir une suggestion pour retravailler la traduction existante, mais ce que je voudrais souligner c’est la façon dont la « faiblesse » de celle-ci apparaît au traducteur même : le travail avec des acteurs pour une mise en scène du texte. Que s’est-il passé, M. Markowicz ? Est-ce une « simple » relecture qui vous a amené à ces réflexions ou y’a-t-il, comme je le suppose, quelque chose qui coinçait au moment où le texte prenait voix, où il s’incarnait ? Est-ce que le rythme devient si nécessaire à refaire qu’il semble même devoir congédier le sens ?
Difficile brutoralité, il semble…
Bonjour, question au traducteur : pourquoi traduisez-vous « u c’hozijaev » par « chez les voisins »?
merci
Bonjour —
trois questions, trois réponses.
— De fait, « le sens biblique » est une expression douteuse. Décidement… Mais ce que je veux dire est clair : en russe, le mot « isc’hod » appartient à la langue de la Bible, qui est, en tant que telle, très reconnaissable, comme elle l’est en anglais ou en allemand (contrairement, par exemple, au français).
— Il ne s’agissait pas, en l’occurrence, d’un problème d’oralité. Non, simplement, le travail avec les comédiens sert de révélateur : tout est concret, tout demande une attention précise. Et c’est là, alors que nous parlions du double sens d’une expression comme « C’est tout sur Lazare », que j’ai remarqué vraiment que, dans la réponse de Sonia, le verbe être, « iest' », était répété trois fois, — et que c’était sans doute pas pour rien. Un dernier point : jamais la question d’un comédien ne nous fait, j’espère, « congédier le sens » — au contraire. Le plus souvent, elle nous en rapproche.
— « U c’hoziajev » signifie, de fait, « chez les propriétaires ». Ici, en l’occurrence, Sonia sous-loue à la famille Kapernaoumov (quel nom, là encore !… il s’agit bien de Capharnaüm), et les Kapernaoumov sont eux-mêmes, si je me souviens bien, des locataires. Bref, c’était compliqué pour pas grand-chose : que devais-je dire — « et la pendule a sonné chez les propriétaires » ?… j’ai eu l’impression que, non seulement c’était faux, mais que c’était un peu ridicule, en français, et que ça détournait l’attention. J’aurais pu dire « chez mes logeurs » ? mais je n’aime pas le possessif.
Cette question est, là encore, très intéressante, parce qu’elle me montre que la traduction est une question d’équilibres aléatoires dans l’instant. Mon ami Mikhaïl Iasnov (un des meilleurs traducteurs de la poésie française en russe) parle de la traduction comme de « l’art de la perte ». Il s’agit pour le traducteur, dit-il, d’accepter de perdre un détail pour gagner sur l’ensemble. Et chaque détail peut être discuté, changé d’un jour à l’autre : ce qui ne change pas (j’en ai parlé dans ma « note du traducteur » pour l’édition Babel, quand j’ai recommencé ma traduction après l’avoir perdue), c’est la compréhension de la structure. Sur cela, il ne peut y avoir aucune concession.
« Mon ami Mikhaïl Iasnov (un des meilleurs traducteurs de la poésie française en russe) parle de la traduction comme de « l’art de la perte ». Il s’agit pour le traducteur, dit-il, d’accepter de perdre un détail pour gagner sur l’ensemble »
On pourrait dire aussi, me semble-t-il, « économie de la perte » . J’ai relu « Crime et châtiment », découvert dans mon adolescence, dans votre traduction. L’impression d’avoir affaire au décrassage d’un tableau de maître. Une fois les vieux vernis enlevés, les couleurs vives de l’original. Faut-il entendre votre mot de « repentir » au sens où les peintres l’emploient ? Et sur Mandelstam, avez-vous des repentirs ? Vos scrupules vous honorent car, franchement, sur le terrain des traductions en général, le lecteur, il faut bien le dire, n’y voit les trois quarts du temps que du feu. Il peut trouver la traduction mal écrite, mais mal écrite en français. Cela ne veut pas dire pour autant qu’une traduction « bien écrite » soit fidèle à l’original! C’est même souvent le contraire.
Ainsi, votre analyse lucide de votre « erreur » est-elle remarquablement éclairante pour tout lecteur qui s’intéresse à l’art si difficile — sorte de pari toujours perdu d’avance — de la traduction littéraire.
Merci encore, de la part d’un groupe de lycéens de province, pour la matinée passionnante (pour leurs professeurs aussi) passée, il y a quelques années, en votre compagnie.
« J’arrive tard. Il est onze heures, non ?
Oui, murmura Sonia. Oui, c’est ça ! ajouta-t-elle précipitemment, comme si pour elle tout en dépendait, la pendule vient de sonner chez les voisins, je l’ai entendue… c’est bien ça. »
Désolée pour ces suggestions plus que tardives et merci pour cet excellent article.



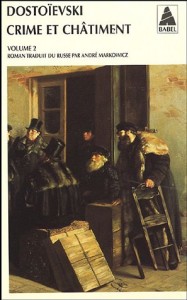
12
commentaires