
Claude Simon, un latin qui écrase sa montre
 En 2006, Claude Simon entrait en pléiade . Il était mort le 6 juillet 2005, mais dans ses dernières années, il avait lui-même choisi les textes (faut-il dire » romans » ou longs poèmes ?) qui figureraient dans ce volume. Il y avait bien sûr, son grand livre matriciel La route des Flandres, mais aussi Le vent, Le palace, La chevelure de Bérénice, La bataille de Pharsale, Triptyque, Le jardin des plantes. Et aussi le Discours de Stockholm de ce nobélisé. L’ensemble était somptueux. Ce choix personnel est aujourd’hui complété par un second volume. Il rassemble ses écrits des débuts L’herbe »(1958), Histoire (1967), Les corps conducteurs (1971), Leçon de choses (1975), texte d’une grande virtuosité dans l’entrelacement des thèmes et des images , texte qui semble emprunter à l’art cinétique, puis Les Géorgiques (1981), retour aux archives familiales, l’Invitation (1988), récit d’une visite de Claude Simon en Union Soviétique en 1986. Enfin L’Acacia (1989) plongée familiale, et Le tramway, ultime texte aux échos proustiens, achèvent l’entreprise.
En 2006, Claude Simon entrait en pléiade . Il était mort le 6 juillet 2005, mais dans ses dernières années, il avait lui-même choisi les textes (faut-il dire » romans » ou longs poèmes ?) qui figureraient dans ce volume. Il y avait bien sûr, son grand livre matriciel La route des Flandres, mais aussi Le vent, Le palace, La chevelure de Bérénice, La bataille de Pharsale, Triptyque, Le jardin des plantes. Et aussi le Discours de Stockholm de ce nobélisé. L’ensemble était somptueux. Ce choix personnel est aujourd’hui complété par un second volume. Il rassemble ses écrits des débuts L’herbe »(1958), Histoire (1967), Les corps conducteurs (1971), Leçon de choses (1975), texte d’une grande virtuosité dans l’entrelacement des thèmes et des images , texte qui semble emprunter à l’art cinétique, puis Les Géorgiques (1981), retour aux archives familiales, l’Invitation (1988), récit d’une visite de Claude Simon en Union Soviétique en 1986. Enfin L’Acacia (1989) plongée familiale, et Le tramway, ultime texte aux échos proustiens, achèvent l’entreprise.
Alastair B .Duncan dirige l’édition des deux volumes. C’est un travail exemplaire, minutieux, pédagogique et intelligent pour démêler, dans l’enchevêtrement des thèmes et le torrent d’images, ce qui est la part de l’autobiographie et la part des documents sélectionnés par l’auteur. Duncan livre des schémas, des plans, des dessins de l’auteur, tout un matériau de travail, ainsi que des extraits de lettres qui permettent de mieux comprendre l’élaboration des romans et le travail préparatoire qui ressemble autant à celui d’un peintre avec dessins ,esquisses, plans, qu’à un travail de montage cinématographique. On sait combien Simon, qui se vouait au départ aux arts plastiques, puisait aussi dans les cartes postales, tableaux, photographies, coupures de journaux, publicités, catalogues, timbre- postes, dessins et croquis divers, registres, objets personnels, archives familiales.
Le travail impressionne, avec ses collages, son architecture, ses échos, séries et motifs répétés, cette manière de hacher en instants, dialogues tronqués, et de kaléidoscoper le flux mental. Dans Leçon de choses, c’est exemplaire .On note aussi sa manière d’élaborer en mosaïque et brisures, sensations, souvenirs, obsessions, odeurs, bruits, paroles, panoramas ou gros plans, et d’organiser en puzzle des éléments biographiques, des réminiscences, comme si un génial carreleur se construisait une villa pompéienne avec des petits morceaux de son passé traumatique et de son flux mental. Donc tout nous est dit de cette esthétique du morcellement.
A l’époque de la publication des livres, la critique littéraire, en pleine bataille du « Nouveau Roman », s’était divisée en trois catégories. Le volume présente bien l’ordre de bataille : les enthousiastes, les opposants, et un carré d’indécis très intéressant. Du côté des admirateurs inconditionnels, il y a Michel Lebrun, Jacqueline Piatier, Antoine de Gaudemar, Marianne Alphant, Roland Barthes et Daniel Martin. Du côté des opposants, il y a Angelo Rinaldi, Pierre de Boisdeffre, Kléber Haedens. Le carré des perplexes- ceux qui oscillent d’un livre à l’autre entre admiration et agacement- est plaisant à relire : François Nourissier , Claude Roy et le subtil Matthieu Galey.
Ce second volume souligne l’importance des constantes autobiographique (qui s’accentue dans la dernière partie de l‘œuvre ) mais il met en évidence une rhétorique et une sensibilité. Elles s’imposent. Avec hauteur. Avec grandeur. Avec austérité malgré ses chatoiements de couleurs (quel grand coloriste, ce Simon avec ses verts plomb, ou ses jaunes terreux..). On se dit que la phrase de Claude Simon possède l’assise d’un auteur latin. C’est la révélation de ce volume II : Simon est un auteur de l’Antiquité, et plus particulièrement un historien romain. Il nous offre un panorama d’un XXème siècle en ruines : ruine de l’humanisme, ruine du roman sentimental et psychologique, ruine des beaux mensonges historiques, ruine du romanesque balzacien, réflexion sur les guerres non pas puniques mais mondiales. C’est un historien des effondrements de son siècle. Il nous offre des plaques de prose, des morceaux de tablettes. Son acharnement de stoïcien, sa fermeté de récitant et de chroniqueur en surplomb sont si évidents. Il ne décrit pas la Rome des César, mais le torrent et le cataclysme de la seconde guerre mondiale qui prend sa source en mai-juin 4O, par un cavalier qui s’effondre dans un fossé.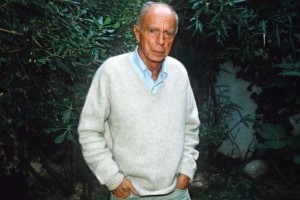
Sa latinité il l’a proclame : voir sa Bataille de Pharsale et ses Géorgiques. Sa phrase immense, enroulée, triturée, concrète, a la puissance, la hauteur marmoréenne d’un classique écriture pure, régulière, presque impersonnelle, nettoyée de l’Antiquité. Le ton est résolument épique. L’auteur s’éloigne superbement des cuisines romanesques de son époque pour devenir le Tacite de la défaite de 4O. Bien sûr c’est un Tacite des années « Nouveau Roman » qui n’ignore rien du monologue joycien , et du signifiant de Barthes. Il n’ignore rien non plus du fiévreux tohu- bohu faulknérien. Cet aède nous plonge dans le fleuve aux ombres écarlates de l’Histoire, de la guerre. Quel charroi : autant de corps d’hommes que de chevaux, de végétaux que de lumières foisonnantes et frissonnantes, comme s’il avait aussi gardé intact la fraicheur d’un vaste premier poème du monde. A le relire, il apparaît contemporain d’Ovide, de Lucain (qu’il appréciait ) et de Tacite.
Sa grande originalité, c’est qu’il écrase sa montre.
Pour Simon, le temps n’est qu’éclats coupants de verre qui reflètent soleil et feuillages, photos de famille, visages, paysages dans le flou de la vitesse, quelque chose d’indistinct comme vu par un myope ébloui en été. Les fusions impressionnistes sont mêlées avec un soin ornemental précieux. Les sons se répercutent d’une page à l’autre. De somptueux éclairage à claire- voie, ou des contre- jour laissent apercevoir des corsages baleinés, des soldats républicains dans Barcelone, des Conventionnels à plumet tricolore qui sortent d’un tableau de David. L’Histoire coule, déborde, ruisselle de la bataille de Pharsale à la défaite de Quarante avec charges de cavalerie face à des blindés. Mais dans cette simultanéité temporelle, le tracé d’un crayon sur une feuille de papier pour dessiner et ombrer un ventre de femme vaut tout autant que la vie entière du général d’Empire Lacombe Saint Michel, arrière- -grand-père de la grand-mère maternelle de Claude Simon, figure qui domine les Géorgiques. Ce nivèlement apporte une beauté assez surréaliste. La partie davantage proustienne de l’œuvre culmine dans son dernier court récit Le tramway. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un extrait de la lettre du 12 juillet 2000 de Jérôme Lindon, son éditeur, quand il découvrit ce texte :
«Dés la première lecture, Le tramway me laisse une impression d’émerveillement. Vous avez réussi là quelque chose d’unique, bouillonnant d’émotion et d’une parfaite cohérence. Si d’aucuns demandent par quel livre il convient d’aborder l’œuvre de Claude Simon, je n’hésiterai pas à répondre : par celui-ci. »
Aujourd’hui les polémiques autour du « Nouveau Roman » sont quasiment éteintes, en laissant d’ailleurs de belles traces et influences chez les nouvelles générations, de Pierre Michon à Olivier Rolin. Simon et ses fresques de héros fracassés, de cavaliers culbutés, de familles proustiennes chavirant dans l’abime du temps, restera notre grand épique. Tantôt statuaire, tantôt pur coloriste (il faut le voir décolorer et vieillir en rose le rouge d’ un mur) il creuse dans le marbre ou le travertin d’on ne sait quel Forum à l’usage des générations futures, pour préserver et inscrire le traumatisme de sa génération. Sa hantise de la mort sur une « route des Flandres » lui a fait voir la vie par en dessous dans un indéfinissable été qui s’éloigne de sa rétine.
Curieux Simon. Je le revois encore place Monge, là où il possédait un appartement prés de la caserne de la garde républicaine. Souvent le matin, il achetait des cigarillos au bar-tabac côté rue du Puits -de -l’Hermite. Veste à chevrons gris, allure militaire, dos très droit, yeux clairs admirables. Il ouvrait son paquet sur le trottoir et là, restait planté à contempler la bordure de granit du trottoir avec le filet d’eau du caniveau. Il avait l’air étonné de ces couleurs et de cette lumière, comme si un peu de la fraicheur du monde était préservée dans ce bout de trottoir auquel personne ne prêtait attention.
JACQUES-PIERRE AMETTE
(« Jacques-Pierre Amette », photo Passou ; « Claude Simon » photo Jean-Pierre Muller)
Claude Simon
Œuvres, tome II
1712 pages
59 euros
Collection de La Pléiade/ Gallimard



158
commentaires