
De Paula à Denise, du sourire à l’effroi
Le trio classique : le mari, la femme, l’amant. A partir de là, qu’en fait-on d’autre que tout ce qui a été fait, refait, défait depuis des lustres ? Une poignante histoire d’amour. C’est l’exploit de Patrick Lapeyre dans Paula ou personne (416 pages, 22 euros, Pol), dont on n’a pas oublié dix ans après La vie est brève et le désir sans fin (Prix Femina). Il y parvient avec une sensibilité, un tremblé, un humour et in fine une mélancolie qui emballent le lecteur grâce à l’indéfinissable charme qui s’en dégage, même quand c’est triste. Douceur de la narration quand tant d’autres ailleurs sont si crispées, un certain détachement des choses d’ici-bas, à l’image de ce personnage qui se rend régulièrement au Louvre pour y lire son journal assis sur une grande banquette de cuir face à des chefs d’œuvre. Tendresse qui déborde de tant de pages. Tant les hommes que les femmes donnent l’impression de vivre en mode avion. Cela se ressent dans la forme même qui est celle de Lapeyre, sa signature dans son maniement des généralités, drôles tant elles sont absurdes :
« Toutes les sœurs s’appellent Fabienne (…) Toutes les filles ont un exemplaire de Rimbaud, avec son portrait en couverture (…)
Ou encore dans sa manière de brosser un portrait décalé :
« Martino, un postier dont aimerait bien connaitre les compétences exactes, à part qu’il sait lire et écrire (…)
C’est à se demander s’il n’est pas dans l’autoportrait lorsque, décrivant Jean en individu parfois coupé du monde, il écrit :
« Si l’Allemagne reprenait par surprise l’Alsace et la Lorraine, il ne s’en serait même pas aperçu ».
Certains ne lui pardonneront pas de tourner en dérision Gilets jaunes et syndicalistes mais qu’importe. Cette histoire pourtant stéréotypée donne le sentiment d‘être traitée pour le première fois, ou plutôt la deuxième tant elle procure un plaisir similaire à celui de Betrayal (1978), la pièce de Harold Pinter, à ceci près que celle-ci était construite à l’envers et que l’action s’y déroulait à rebours, de la fin d’une liaison à son origine. Là, ça se passe à Paris VIIème entre l’avenue Bosquet et la rue Saint-Dominique mais aussi à Nice entre le cours Saleya et la place Masséna et enfin à Strasbourg. Jean Cosmo, plutôt fauché, travaille de nuit au tri postal. Paula, 28 ans, une bourgeoise bien charpentée de la cervelle notamment en histoire de l’art, catho pratiquante mais débarrassée de la culpabilité jusqu’à ce que le sens du pêché ne la rattrape. En attendant, elle s’accommode de l’adultère vécu selon les règles de la clandestinité avec une solide pensée pour boussole :
« Tout ce qui se fait en amour se fait en Dieu parce que Dieu est amour »
Et hop, au pieu ! Lui, c’est un féru de philo. Son dada ? l’Etre. Il en pince pour Heidegger. Elle, moins. Ca l’intéresse, ça la fait rire, ça l’étonne et à la fin, comme nous aussi un peu, ça la saoule, d’autant qu’il a toutes les indulgences pour l’ancien recteur nazi-sans-l’être (il est vrai qu’il s’est plus documenté auprès de l’excellent mais incomplet Dictionnaire Heideggerplutôt que dans les récents et accablants Carnets noirs). Leur passion n’est pas que physique même si la chair prend une très grande place dans leur complicité. Le fait est qu’ils n’arrêtent pas de baiser mais cela reste assez poétique, démentant au passage le principe de Cioran : « Le propre d’un amant est de commencer en poète et de finir en gynécologue ».
L’auteur évite les clichés mais parfois, tout à la fixation de Jean sur la magnifique poitrine de Paula, il s’autorise certaines images que l’on a du mal à visualiser telles « des seins de mésange » ( ?…). Quand leur liaison se délite, il s’enfonce dans un (trop) long parallèle avec la relation qu’Heidegger entretenait avec son élève devenue sa maitresse Hannah Arendt. Paula ou personne est une forte méditation sur le mensonge :
« Peut-on croire celui qui se présente comme un menteur ? ».
Ce qu’en dit l’(anti)héros dans les pages où est évoquée la recherche de l’authenticité dans Chronique de Anna Magdalena Bach des Straub/Huillet au-delà des instruments d’époque, et l’obligation pour les musiciens de porter du linge de corps d’époque sous leurs vêtements d’époque, donne envie de revoir le film. A la fin, on croirait entendre la douce voix de la narratrice Mme Jouve, elle aussi rescapée d’une grande histoire d’amour, dans La Femme d’à côté de Truffaut : ni avec toi, ni sans toi…
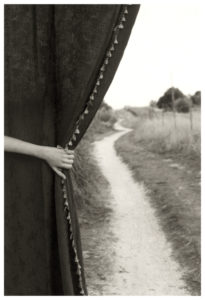 Tout autre est le récit d’Irène Frain Un crime sans importance (256 pages, 18 euros, Seuil), l’une des plus fortes surprises de la rentrée (on peut l’écouter lire ici). Le côté « fait divers vécu » donne envie d’y aller voir : le meurtre de sa sœur, 79 ans, toujours inexpliqué quatorze mois après. Etrange crime dont on ne sait pratiquement rien : circonstances, mobile, coupable… On sait juste qu’il a eu lieu. La victime vivait seule dans une impasse, bipolaire, secrète et jalouse de sa solitude. Elle confectionnait des sachets de lavande.
Tout autre est le récit d’Irène Frain Un crime sans importance (256 pages, 18 euros, Seuil), l’une des plus fortes surprises de la rentrée (on peut l’écouter lire ici). Le côté « fait divers vécu » donne envie d’y aller voir : le meurtre de sa sœur, 79 ans, toujours inexpliqué quatorze mois après. Etrange crime dont on ne sait pratiquement rien : circonstances, mobile, coupable… On sait juste qu’il a eu lieu. La victime vivait seule dans une impasse, bipolaire, secrète et jalouse de sa solitude. Elle confectionnait des sachets de lavande.
Elle s’appelait Denise. La sœur ainée vénérée par toute la famille car elle avait fait entrer la culture dans la misère noire de la Bretagne d’après-guerre. Personne n’a rien vu ni entendu dans les alentours du pavillon situé à 25 kms de Paris, près de la rocade, non-lieu entre l’autoroute, le Décathlon et le bois. Beaucoup de sang sur la scène de crime. Des traces de coups sur le cadavre plongé dans le coma après un traumatisme crânien. Tabassée et laissée pour morte. Un massacre. Elle mourra à l’hôpital. La maison a été mise à sac. Pourtant, pas de vol, pas de cambriolage. Alors, juste Orange mécanique ? On est plutôt chez Simenon. Juste un meurtre de retraitée, sans sexe ni argent. «
Il n’était pas glamour, le meurtre de ma sœur. Aucune prise pour l’imaginaire. Rien que de la réalité à l’état brut. Du pas beau à voir, comme avait dit un des flics le dimanche où on l’avait trouvée ».
Juste une « male mort », ainsi que l’on désignait au Moyen Age les mauvaises morts, atroces, moches. Passant de l’accablement à la colère, Irène Frain a voulu savoir ; elle a enquêté, restitué une biographie à la disparue, dévoilé l’énigme de leurs rapports : elles ne s’étaient pas vues ni parlées depuis de nombreuses années alors que cette soeur ainée adulée était celle qui lui avait ouvert la voie en l’aidant à s’extraire d’une famille et d’un milieu résignés à leur médiocrité ; mais sur l’affaire, elle n’a rencontré qu’une informelle conjuration de mutisme : famille, police, justice. Un bloc d’indifférence aussi violent que le crime. Son livre est la chronique de ce silence infracassable. Sans pathos, sans effets. Juste ce qu’il faut de dignité dans la colère. Impressionnant.
(Photos D.R.)
1 449 Réponses pour De Paula à Denise, du sourire à l’effroi
Autrement dit, à en croire ce qui précède, Céline a une place beaucoup plus grande dans la culture des pays d’Europe continentale et en Amérique Latine que dans le monde anglophone.
Quelqu’un a-t-il une explication?
Céline, bien lu en UK et brillamment traduit par un certain Marx.
@ RDL, Tombé sur une apologie d’un romancier adulé, ici(te). Je pense que toute la rdl va le lire pour se mettre en adéquation avec son actu.
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/09/09/reinhardt-roman-joueur/
@ Dexter, en multipliant toutes les précautions oratoires possibles, je dirai pour ma part que j’en ai toujours plutôt pincé pour « Au coin de la rue, l’aventure »… Après s’y être fait casser la gueule, Pascal et Alain décidèrent de renoncer à leur cheminement commun et de poursuivre chacun des aventures musicales divergentes.
@ Gibbé, des noms, si possible : « c’est un débat de fond que ceux qui draguent les basses fosses ici ne valent pas ». Espère que Passoulévous ne pensez pas aux mêmes.
@JMB, hello bouguereau, ça fait vraiment plaisir de vous revoir.
@BJ à tous.tes,
(9.9.20, _9.30 : Chatelaillon – > Poitiers, 159 km).
x dit: à
Le pauvre Zizix et ses raisonnements aussi mous qu’un chapelet de saucisses avariées. On ne manie pas avec autant de désinvolture les grecs et les romains quand on a aussi peu de matière grise à sa disposition. Epargne-toi, épargne-nous.
MS, mon avis est que souvent chez les hommes elle précède les sentiments et inversement chez les femmes . Apres il se rencontre tous cas de figure chez les uns les unes les autres. Le désir prend racine on ne sait trop où, personnellement c’est un souvenir ancien, une photo sépia comme passée
par les intempéries qui l’ont presque effacé du logiciel.
3J ne nous va pas donné de nouvelles de La femme intérieure.
J’ouvre L’aigle, Mademoiselle – au hasard. Le marquis se justifie pour des crimes qu’il n’aurait pas commis. Faux témoignages achetés.
@ clozère-céline…,
sans doute une moindre appétence ou enracinement de la culture antisémite en pays de common law (nord et anglo-saxons) que dans les pays de forte tradition catholique institutionnelle (latins). Ou quelque chose dans ce goût là, dans le sillon de M. Weber,… mais vous le savez très bien. Pourquoi faire le benêt ?…
Où avez-vous vu le retour de bouguereau, Janssen J-J ?
Céline, bien lu, mais bien vendu? Apparemment, les droits d’auteurs ne suffisaient pas à rémunérer le personnel nécessaire au grand âge de Lucette Destouches, d’où la querelle des pamphlets quelques mois avant sa mort.
@ B. « 3J ne nous va pas donné de nouvelles de La femme intérieure ».
Très juste… je dois faire un A/R à Meudon en mode avion jusqu’à demain et vous répondrai donc dans deux jours. Il y a matière. Merci pour votre vigilance, et bien bonne journée,
Il y a des » avis « , et puis ceux que je zappe.
Me too, en mode avion, jusqu’à plus tard.
Tiens, je n’avais jamais entendu causer de ce Jacques Lemarchand sur la RDL,
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/09/09/glauque-lemarchand/
MC et Passou, le connaissiez-vous ? Et si oui, quid ?…
Bon, je dois sortir maintenant… A bientôt.
3J, pas de quoi, vous aviez l’air dedans et conquis, promettant de nous livrer quelques impressions de lecture aussi comme j’avais remarqué ce titre et lu ce que Claro en a écrit, j’attendais. La journée sera pluvieuse ici, tant mieux pour la terre et les nappes, tant pis pour nous.
L’Humanité souffrante de nos jours, se trouve peut-être, à son insu même, divisée en deux groupes : les prudes chougnards d’aujourd’hui et un dernier filon d’hommes de l’Antiquité. Je suis un homme de l’Antiquité, Pablo aussi, j’en suis certain.
Chaloux dit:
En tout cas, je ne suis pas un prude pleurnichard, ça c’est sûr, comme il y a tant ici, cette bande de chougnards et faux-culs qui veulent faire de cet endroit un « Espace » de Cagoterie sous la férule de Madame Lèchecul-pètesec.
Et quelle raison a Maja Lundgren, en écrivant: « Les hommes de l’antiquité, toutes classes confondues, étaient beaucoup plus francs que nous. Notre pruderie n’est devenue en fait de bon ton qu’à partir du XIXe siècle. »
C’est tout à fait exact. Le faux-culisme mental est un phénomène qui a triomphé au XIXe siècle, avec la prise du pouvoir de la bourgeoisie. Le XIXe est le siècle le plus hypocrite de l’histoire de l’humanité, et en tout. C’est le siècle du romantisme et du bordel, de la répression sexuelle pour les femmes et de l’adultère institutionnalisé pour les hommes, de la tartufferie généralisée, en morale, en politique, en art, dans les moeurs… C’est le siècle qui ose condamner Baudelaire et Flaubert – et avec cela tout es dit.
Il faut relire « Le stupide XIXe siècle », de Léon Daudet:
« En fait, le romantisme, en littérature comme en politique, est l’école du mensonge et de l’hypocrisie. Il n’est pas de plus grand Tartuffe que Victor Hugo. On aurait pu le conjecturer d’après son œuvre, sans rien connaître de sa biographie.
Chateaubriand a donné le branle, il faut le reconnaître, avec sa somptueuse insincérité et une éloquence assise (disait Alphonse Daudet) […] Chateaubriand a donné le branle à cette affectation de la lassitude de vivre, jointe à une peur panique de la mort, dont l’agaçant et continuel refrain grince pendant tout le cours du siècle, où les hommes se sont le plus entretués. Il inaugure le grand cabotinage littéraire. Il est le grand père de tous le « moi, moi, moi », de tous les moitrinaires, qui se regardent pâlir et vieillir dans leurs miroirs ternis et écaillés. […] Que ce comédien magnifique ait été pris pour un héros véritable, et que cette erreur ait recommencé pour Hugo, voilà qui justifie (au chapitre de l’inclairvoyance) notre accusation de stupidité, portée contre le siècle « des lumières ». […] Nous aurons souvent l’occasion de voir que l’absence d’un Molière au XIXe siècle s’est fait cruellement sentir. Pour la plaie durable du romantisme, le meilleur antiseptique eût été le rire. Or le dur Sainte-Beuve est rarement joyeux et le grand Veuillot n’a jamais su rire. Quarante années de larmoiement, de vague à l’âme et de désolation égocentrique, n’ont pas amené la réaction attendue d’un bon vivant, suffisamment armé pour l’observation satirique, et qui eût remis les choses au point par le ridicule. Cette lacune, qui s’est rarement produite dans le pays des fabliaux et des farces rabelaisiennes, est, pour une époque aussi fertile en cabotins du sublime et en faux géants, très caractéristique et regrettable. Le silence de l’esprit de raillerie et de fronde prouve l’universalité de l’esprit de jobarderie. »
Il y a sur ce blog une bonne poignée de Jobards et de Jobardes qui devrait lire ce livre de L. Daudet.
Et aussi les grand pamphlétaires français, dont ce « sauvage » de Bloy (« L’ignorance, les niaises pudeurs, les crédulités jobardes » – on dirait qui parle de la dite poignée de pleurnichards et pleurnichardes du blog).
Pour finir, deux de mes devises:
“Il faut être intolérant pour être libre”.
(Georges Darien. La Belle France)
« Je suis trop honnête pour être poli. »
(Louis Scutenaire. Mes inscriptions)
Si je récapitule, la becheuse estime qu’elle vaut mieux et mentionne qu’elle me zappe. Pablo, Chaloux ne répondent pas. 3J mène l’enquête, occupe le siege de procureur, demande la peine de mort ou concocte je ne sais quelle bancale plaidoirie. Ah mais quel beau matin!
Je me disais Pablo que vous étiez incapable d’affirmer une pensée qui soit la vôtre. Pourquoi toujours des citations, comme si la signature et la publication étaient un gage de vérité. C’est un peu comme le droit la littérature, on peut lui faire dire ce que l’on veut en oubliant tout le reste.
En fait cette pauvre arriérée aliénée de Bérénice ne s’aperçoit même pas que Pablo et moi lui permettons d’assouvir sa principale passion : persécuter. Elle essaie (sans grand fruit) de nous persécuter, certes à l’ombre de ce qu’elle croit être sa vertu, mais elle persécute tout de même. On se donne les bonnes raisons qu’on peut.
Si comme tu l’affirmes, Pablo, certains se rangent derrière la Cricri, c’est que le niveau a dramatiquement baissé. La pauvre Cricri n’était qu’une comparse (plutôt mal) tolérée, qu’on faisait facilement taire, une quantité négligeable, bref elle se tenait (ou on la tenait) à sa vraie place. la voici devenue prophète. Prophète pour des Zizix, des Jibé, des Gigi, de pauvres roses complètement cuites, etc. Prophète pour ramassis.
Céline, bien lu, mais bien vendu? Apparemment, les droits d’auteurs ne suffisaient pas à rémunérer le personnel nécessaire au grand âge de Lucette Destouches, d’où la querelle des pamphlets quelques mois avant sa mort.
Chaloux dit:
Il faudrait savoir combien de personnes s’occupaient d’elle. Si elle avait en permanence quelqu’un avec elle, cela peut coûter très cher, entre salaires et S.Social. Trois personnes à son service peuvent coûter 8.000-10.000 € par mois. Il faut des gros droits d’auteur (surtout pour un auteur « classique ») pour payer cela pendant des années.
Jibé, je faisais allusion aux analyses (ni expéditives, ni simplistes) des positions de Nietzsche par d’Alasdair Macintyre , notamment dans son grand livre After Virtue (qui a fini par être traduit en français, aux PUF).
De Darien, j’ai lu le voleur, génial, mais pas La belle France. Vais me mettre en quête…
Il ne faut pas à mon avis condamner exclusivement le XIX ème. L’avènement de la bourgeoisie accompagnee son goût pour la façade n’explique pas tout dans les hypocrisies du mariage. C’est plus ancien et comme souvent lié à de vulgaires histoires d’argent.
Pratique de la dot en France
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1988_num_43_6_283565
Votre explication frise le ridicule JJJ. Dire implicitement que plus on est antisémite, plus on lit « Le Voyage » et « Mort à Crédit » ne tient pas la route. Car, bien tendu, quand je parle de Céline, je parle de ces deux romans et de rien d’autre (on peut ajouter Semmelweis), même pas des romans d’après-guerre que je trouve très inférieurs.
Non, je pense que l’explication est beaucoup plus prosaïque. Dans les pays de langue romane et même en Allemagne notre voisine et partenaire privilégiée, la culture française en général conserve un peu du prestige qu’elle a perdu depuis longtemps ailleurs. Céline en bénéficie, comme d’autres…
Si comme tu l’affirmes, Pablo, certains se rangent derrière la Cricri, c’est que le niveau a dramatiquement baissé.
Chaloux dit:
Et c’est le cas, c’est incontestable.
C’est très rare maintenant de lire des choses intéressantes ici. Et alzheimer ou simplement l’âge font des ravages chez pas mal d’erdeliens (le Pétomane, Court, Gigi la Visqueuse…).
Si toi et moi on partait, ça serait la mort du blog. Le consensus dans la nullité s’imposerait, le peu de gens qu’il y a ici avec un peu de sens critique partiraient, et ne resteraient que les Niais, les Folles et les Pitres à papoter comme dans une cour de récréation d’EHPAD, avant l’assoupissement final.
Il n’y a que les gifles bien données de temps en temps aux Crétins qui réveillent ce blog. Ils se plaignent, mais tous ils savent que c’est vrai. C’est pour cela que certains les recherchent… Le fait de se mettre à aboyer après les avoir reçues les sauve du naufrage neuronal. Moi quand j’entends ces aboiements je me dis que nous on fait oeuvre de salubrité publique en retardant la chute finale de ces cerveaux en compote.
(Tu vas voir le concert de hurlements de roquets après ce post).
« bien entendu… »
Chaloux, qui n’avez aucun problème de mémoire, Il me semble vous avoir déjà répondu sur le point des vertus en précisant que je me réclamais d’aucune. Et je ne saisis pas en quoi je persécute l’un ou l’autre du tandem. Parce que quand vous faites preuve de sadisme et d’inhumanité dans votre façon de communiquer il faudrait lire un souci de l’autre, de ce qu’il ressent? J’ai simplement ecrit hier soir que vous me sembliez etre de sacrés baiseurs. Des don Juan, des Casanova, des libertins, la formule passerait elle mieux? Votre utilisation du langage en tout cas ne prouve aucune volonté de plaire ou séduire, et même de convaincre. C’est une attaque très souvent et qui se fiche des moyens, l’essentiel étant de blesser, humilier, rabaisser, réduire, neantiser l’autre.
Je ne me,
Léon Daudet, belle engeance antisémite. Pas étonnant que l’homunculé franquiste en fasse ses choux gras – roulé entre le pouce et l’index et expédié d’une pichenette, le débris.
Pauvre Béré, je ne suis que le prétexte à votre discours de démente. Faites un tour à Sainte Anne, il y aura peut-être une place pour vous, vous auriez bien besoin d’une longue retraite capitonnée.
Hurkhurkhurk!
comme dans une cour de récréation
c’est ce que certains contributeurs réclament
C’est une attaque très souvent et qui se fiche des moyens, l’essentiel étant de blesser, humilier, rabaisser, réduire, neantiser l’autre.
et cela aussi a été un a priori de la RDL :les contributeurs et trices ont voulu exceller dans ces pratiques;ils n’ont qu’à se demander pourquoi ils y ont adhéré
bonne journée
je veux dire qu’il semble que les uns ont dit que leur pratique releavait de « la liberté d’expression », d’autres de leurs droits, et certains de leur soumission à des règles implicites, et dont il était injurieux ou insensé de demander l’explicitation
par ailleurs,ces pratiques ont dit relever d’une théorie psy
Pauvre Béré, je …
Sale type. Sale race . Enfoiré. Mauvais coucheur. Pervers. Taré.
Menteur. Et je tais tout ce qui ne ressort pas de l’intellectualité et malheureusement vous appartient.
Le libre-arbitre, les rapports entre science et religion, autant de réflexions suscitées par de futures technologies …
Et je tais tout ce qui ne ressort pas de l’intellectualité et malheureusement vous appartient.
Pauvre follasse, tu es encore en crise. Sainte Anne vraiment…oui…ce matin…en urgence!
Hurkhurkhurk!
Dans les pays de langue romane et même en Allemagne notre voisine et partenaire privilégiée, la culture française en général conserve un peu du prestige qu’elle a perdu depuis longtemps ailleurs. Céline en bénéficie, comme d’autres…
closer dit
Tu as raison. Mais il y a aussi l’inculture des anglo-saxons en général et des nord-américains en particulier. Tu connais la blague sur les livres. On demande à un français quel est son livre préféré, il répond que Les Misérables de V.Hugo. On demande à un anglais, et il dit: – Un de Shakespeare dont je ne me rappelle pas le titre. On demande à un américain et il répond: – Comment être heureux dans la vie, de Mr. Anonyme. On demande à un australien et il dit: – C’est quoi un livre?
Grande nouveauté : Jicé prend Dieu à témoin.
« Dieu sait que… »
Que signifie naître et être fille dans une famille française traditionnelle du début des années 1960 ? Comment se libérer du poids d’une éducation empreinte de domination masculine ? Dans Fille, Camille Laurens explore ces questions à travers la vie de Laurence Barraqué, de son enfance de fille à sa vie de femme et de mère aujourd’hui. Mais comment se défaire des stéréotypes de genre, s’en désaffilier, pour éduquer sa propre fille autrement ? Camille Laurens cherche des réponses par les mots qu’elle déploie avec virtuosité et dont elle explore la force de perturbation.
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/08/24/naitre-fille-laurens/
Dans vos rêves, Chaloux. Votre psychopathie est en accord avec le siècle. Ne vous plaignez pas d’une pauvre malade manioco dépressive relevant d’un traitement lourd et qui s’y refuse. L’onde de ma prose crétine ne devrait pas vous nuire plus qu’une chiure de moineau sur la main.
Quelle blague désopilante que celle de Pablo 75… à se rouler par terre, vraiment… Quant à l’inculture des anglo-saxons… c’est une fine analyse d’un cerveau priviégié… vite, d’autres!!!
Un Français se précipite pour sauter parmi les premiers dans un canot de sauvetage.
Un Anglais le retient et lui dit :
– Avez-vous remarqué qu’il y a encore des femmes à bord ?
Le Français lui répond :
– Et alors, vous croyez que j’ai envie de baiser dans un moment pareil
…12 h 32 min.
…
…chacun est personnel, et ses goûts et couleurs aussi,…
…alors, pour renforcer son pays, tout le monde ne peut pas être capable de s’éprendre de n’importe qui,!…ou quoi,!…
…pour s’agrandir son territoire, aux alliances.
…quand s’est trop bête, autant s’éviter,!…
…
C’est un peu fort de voir Pablo 75 annoncer comme ses devises des citations de Georges Darien (anarchiste pur jus) et de Louis Scutenaire (surréaliste estampillé ) après avoir brandi les bannières des deux Léon morveux, Daudet et Bloy .
Je ne vais va pas pleurer ou geindre, non, mais rigoler.
B.
Excellente, restez, très chère.
@Rose
vous demandez :
« À travers ce roman est-ce d’une étude sociologique qu’il s’agit sur la condition de la femme au XIXème siècle ? »
Chaque lecteur a sa grille de lecture. La mienne s’attache à la remarquable étude des trois personnages principaux de ce trio amoureux.
Dans ce domaine Edith Wharton est très fine, son regard saisit tout de ces personnages, (surtout des femmes dans la société américaine du XIXe siècle). Talent que l’on retrouve dans ses autres romans et ses nouvelles.
Cela m’importe plus que l’étude de cette société repliée sur elle-même qu’Edith Wharton décrit sans concession.
Ellen Olenska, par exemple, « femme libre et lucide, fatale aussi ». Celle qui dérègle l’ordre social et apporte le scandale. Une énigme… Le « fantasme » d’Archer qu’il ne veut, à la fin du roman, « confronter au réel ». Il préfère ne pas la rencontrer.
Archer, néanmoins, trouve son équilibre à la fin du roman. Il est un bon père (délicieux dialogues avec son fils), ne semble pas avoir tant souffert de ce mariage. Il a été fidèle. Il est serein malgré cette part de rêve : Ellen…
Donc, plus que d’en venir à la notion de devoir(citation suggérée par DHH), je dirais volontiers qu’il a aimé vivre de cette façon (famille, clan, société, normalité). La vie réelle avec Ellen lui aurait été impossible. Edith Wharton a eu raison de choisir cette version.
L’avènement d’une conscience… c’est déjà pas mal ! Mariage fade mais vie simple et quand même joies du foyer par les enfants et cette femme attentionnée bien… qu’ennuyeuse.
A propos de lecture, j’entame un nouveau livre d’un auteur que j’apprécie : Chantal Thomas.
Sous le titre Café Vivre (Seuil) sont regroupées les chroniques qu’elle a écrites pour le quotidien Sud Ouest pendant quatre ans. C’est un régal de fraîcheur, d’humour, de talent de conter.
Une plume élégante, raffinée,de qualité, non bavarde. Un regard attachant porté sur les êtres, ses rencontres. Un journal de voyages. Un regard sur ses lectures, aussi.
Une célébration de la vie…
D’elle, j’avais apprécié deux romans historiques : L’Échange des princesses et Les Adieux à la Reine. Et dans un domaine plus personnel Souvenirs de la marée basse où elle évoque la relation avec sa mère à travers le portrait d’une femme et d’un paysage : la mer et les plages à Arcachon, les villages de son enfance.
C’est une femme indépendante, grande voyageuse, lectrice passionnée de Descartes, Mme du Deffand, Mme de Staël… Yourcenar, Dostoïevski, Pavese, Fritz Zorn, Barthes…
Directrice de recherches au CNRS, spécialiste du XVIIIe siècle, enseignante universitaire, Chantal Thomas est aussi l’auteur d’essais sur Sade, Casanova, Thomas Bernhard, de nouvelles.
La Vie réelle des petites filles (Gallimard), Marie-Antoinette, La Reine scélérate, dans les pamphlets (Seuil).
Elle disait dans un entretien en 1998 :
« Une des premières difficultés, devant la situation d’abondance [de l’offre culturelle] où nous nous trouvons, c’est de ne pas se laisser submerger, de ne pas se laisser guider par des pressions extérieures subtiles et séduisantes, mais de se mettre à l’écoute de soi. Sans narcissisme, sans complaisance. Juste décider de ce qu’on va faire en fonction de notre curiosité, d’un élan qui nous est propre, de notre inquiétude, aussi. Il faut assumer notre goût, même s’il est fragile.»
Je crois que vous aimeriez ce livre, Rose.
Et floc, un pendule comtoise de chez cricri qui va boucher les canalisations. Rhaaah…
comme dans une cour de récréation d’EHPAD, avant l’assoupissement final.
—
le petit Mengele de la basse cour se sent une âme d’eugéniste revanchard. Laideur du coq châtré.
Je ne vais va pas pleurer ou geindre, non, mais rigoler.
Encore une réflexion de crétin. Mais jusqu’où descendront-ils? C’est l’escalier sans fin…
Hurkhurkhurk!
…13 h 7 min.
…
…rien à faire,…les livres qu’on à besoin, suivant notre nature, il faut les acheter,!…
…s’ils existent, tout fait,!…
…rien n’est gratuit, c’est le meilleur investissement, les connaissances au dessus des perfidies de tout poils abscons,!…
…la camelote pour y perdre son latin, au moins,!…
…
…c’est sur, il y a aussi des enseignements, pour lester les gens,…la concurrence par l’obscurantisme pervers ,!…
…pour les demeurés heureux,!…
…
Gary Peacock :
« On demande à un américain et il répond: – Comment être heureux dans la vie, de Mr. Anonyme »
Très juste, les visiteurs Hemingway ne connaissent rien à l’écrivain mais y vont pour ses chats mutants
Malgré son prix Nobel de littérature remporté en 1954, Ernest Hemingway n’est plus un écrivain « très enseigné » dans les écoles américaines, souligne le directeur de l’institution. « C’est la raison pour laquelle, ici aux États-Unis, les chats semblent être le point d’intérêt principal », ajoute-t-il.
Sigues sin enterarte de la fiesta, Rodriguez Sin Acento, cantamañanas profesional?
Ils sont mignons les petits aboiements du caniche qui signe « lmd », voulant attirer l’attention sur son insignifiance.
« En fait, le romantisme, en littérature comme en politique, est l’école du mensonge et de l’hypocrisie. » (Daudet)
alors là cent pour cent d’accord !
le romantisme c’est le moment où la pensée occidentale a atteint son summum de débilité.
sauf que c’est moi qui le dis je me fait remonter les bretelles à chaque fois.
et ça c’est hyper injuste !
Hamlet, maurrassien sans le savoir…
De mal en pis…
Hurkhurkhurk!
sujet du jour : l’Antiquité grecque c’est quoi ?
la sagesse socratique ! un seul ennemi l’ubris ! point d’excès, trouver la juste mesure en toutes choses, et notamment dans la politique de la Cité, c’est à dire dans la relation entre les citoyens, une relation construite autour d’un élément central : la modération.
Ainsi nous le voyons dans les dialogues de Platon, le Banquet ! et aussi Ménon, mais si Ménon ! quand Socrate lui dit « ça va pas le tête mon petit ? tu crois que le courage c’est se mettre sur la tronche avec tes semblables ? au contraire le courage c’est de trouver une relation détendue, la zénitude ! » qu’il dit Socrate…
donc pour nos deux clowns faut qu’ils nous trouvent autre chose que l’Antiquité.
Chaloux dit: Hamlet, maurrassien sans le savoir…
»
et voilà, encore des raccourcis.
Saul Bellow aussi il dit que le romantisme est une époque débile et il n’est pas maurassien.
allons ! encore un effort pour être antique !
Hamlet, la citation de Daudet vient tout droit de Maurras. IL faudrait être un crétin comme toi pour ne pas le voir. Elle ne vient certes pas de Saul Bellow…
Je ne sais pas si je suis antique, mais toi tu es vraiment conique…
Hurkhurkhurk!
sujet du jour : l’Antiquité grecque c’est quoi ?
hamlet dit:
Encore une preuve que le Pétomane ne sait plus lire. Il voit le mot « antiquité » et il comprend « Antiquité grecque ». Et il se met à écrire, comme toujours, à côté de la plaque…
« Les hommes de l’antiquité, toutes classes confondues, étaient beaucoup plus francs que nous. Notre pruderie n’est devenue en fait de bon ton qu’à partir du XIXe siècle. »
(Maja Lundgren)
C’est ça le « sujet du jour », Gros Nul.
Rodriguez, lmd, le Pétomane, trois clébards de clochard venant sur ce blog pour nous montrer qu’ils savent aboyer (ridiculement, mais aboyer quand même).
Tout le monde a le droit de pondre une connerie, même Daudet envers et contre la dédiasse qu’on sait.
Cela dit, les gens parlent beaucoup du Romantisme — comme du Baroque, d’ailleurs — sans réellement le connaître ; mais on ne va pas ouvrir le douloureux chapitre de la méconnaissance des faits dans cette Invention de Morel qui est la RdL.
dédiasse > dédiCasse
Christiane, renato
Ne vous prends pas pour des prophètes.
Au XIXÈME, le romantisme à Dresde a sacré Raphaël maître du romantisme après l’achat de la Madone Sixtine, les moines étant fauchés (sont pas les seuls).
Renato, ce n’est pas une « connerie de Daudet », cela fait partie d’une théorie de Maurras, très argumentée, très documentée, qui court sur plusieurs livres, et qui garde aujourd’hui un certain intérêt, au moins de questionnement. Quant au reste, vous participez pleinement, en qualité de Monsieur-je-sais-tout n’en sachant souvent pas plus que les autres, à « cette Invention de Morel qu’est la RDL ». Vous le prouvez une fois de plus.
christiane
Mort à 37 ans et un Vendredi Saint.
Quelle vie !
Comme disait Clémenceau « Une vie ne vaut d’être vécue qu’intensément ».
Appris bcp de choses passionnantes ds ce film sur arte que vous avez mis en lien.
Voyons, « En fait, le romantisme, en littérature comme en politique, est l’école du mensonge et de l’hypocrisie. », si ça ce n’est pas une connerie qu’est-ce que c’est ?
dédiasse > dédiCasse
C’est en bas de casse, dans la case… 😉
Rome antique = romantique? 😉
On ne peut pas définir univoquement le romantisme car il présente des aspects divers selon les nations où il se développe — par ailleurs, il n’y a pas dans le mouvement romantique de référence précise à un système formé-fermé d’idées qui puisse le définir pleinement. D’où la connerie de Daudet.
D’accord, dédicace !
Là n’est pas du tout la question, Renato, mais peu importe. Restez dans votre zone de confort.
Dans le cadre de ces travaux publiés dans la revue Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, une équipe de scientifiques du Rochester Institute of Technology (RIT) ont utilisé une nouvelle approche afin de faire la lumière sur le sort de l’une des plus anciennes sociétés humaines au monde : la civilisation de la vallée de l’Indus, contemporaine des Mésopotamiens et des anciens Égyptiens.
Elle est donc où la question, Chaloux ?
Florissante en 2600 avant J.-C., la civilisation de la vallée de l’Indus, localisée dans l’actuel Pakistan, avait soudainement décliné avant de disparaître vers 1300 avant J.-C. Si certains experts avaient émis l’hypothèse que cette société s’était effondrée à la suite d’une guerre ayant opposé ses membres à des envahisseurs venus du Nord, d’autres théories estimaient que des tremblements de terre ou le changement climatique constituaient la principale cause de sa disparition.
Afin de résoudre cette énigme historique, le professeur Nishant Malik et ses collègues ont conçu un nouveau modèle mathématique, leur permettant d’étudier les séries chronologiques paléoclimatiques : des ensembles de données fournissant des informations sur les climats passés sur la base d’observations indirectes. En mesurant un isotope spécifique dans des stalagmites prélevées dans une grotte d’Asie du Sud, les scientifiques ont pu constituer un véritable registre des précipitations de mousson dans la région pour les 5 700 dernières années.
Je le remets christiane votre lien.
Très apaisant.
https://www.arte.tv/fr/videos/089995-000-A/raphael-un-dieu-mortel/
Raphaël
Une seule chose m’a choquée, l’exhumation de son squelette avec les étudiants en art qui viennent un par un toucher son crâne.
Nanmého, et le respect dû aux morts ?
J’ai déjà répondu, Renato, mais je vous confirme que c’est sans importance. Restez dans votre zone de confort.
Pablo 75, astrologue des puces, misérable insulteur à distance. Je vous ai déjà dit mon adresse. Frappez à la porte et on se verra.
Pablo, tu l’as notée? Ça m’intéresse aussi.
Hurkhurkhurk!
L’argument étant une opinion relative au Romantisme, la réponse m’échappe, Chaloux ; mais, justement, peu importe.
Chaloux dit: Hamlet, la citation de Daudet vient tout droit de Maurras. IL faudrait être un crétin comme toi pour ne pas le voir. Elle ne vient certes pas de Saul Bellow…
»
sauf que entre Maurras et Daudet sais pas trop qui était le pire.
c’est ça votre gros problème à vous et pablito : non pas que vous colliez des étiquettes en veux tu en voilà, mais que ces étiquettes vous servent ensuite à véhiculer des idées telles qu’elles vous arrangent le mieux.
Daudet s’est inspiré de Maurras qd il dit que le romantisme est une époque débile.
donc Daudet et maurrassien
moi je m’inspire de Bellow
donc je suis bellowien.
et cette logique n’est pas transitive !
vous comprendre comment ça marche ? ou moi vous faire un dessin ?
vous êtes aussi nul en logique qu’en musique.
Pour Raffaello :
Mon pauvre Hamlet, chez vous à la troisième mouture de la même chose c’est toujours l’effondrement. Peu de suspens à vous lire. Vous citez Daudet qui est imprégné de Maurras, mais votre référence est Saul Bellow. Moi je vous dis que je n’ai pas le temps de discuter avec un zigomar comme vous.
chaloux, pablito et vous raisonnez exactement comme onfray ! comme il fait avec Freud ou avec l’athéisme, ou avec Kant.
Freud aimait l’argent donc la psychanalyse c’est nul ! vous voyez le genre ?
et ça non seulement c’est un signe de débilité profonde, mais c’est toalement incompatible avec une finesse d’esprit et la subtilité qui vous feraient comprendre une pièce quand vous l’écoutez !
et c’est là que je dis que tous les 2 vous êtes 2 grands fumistes !
un peu comme quand vous avez mis cette transcription de la Chaconne qui ne vaut pas un clou.
Chaloux : vous voulez dire que Saul Bellow était maurrassien ?
Le lien « Raffaello » renvoie au catalogue de l’exposition aux Scuderie del Quirinale pour le 500e anniversaire de la mort du peintre.
Deux célèbres duettistes prennent la pose, à l’antique.
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI43WRUW7&SMLS=1&RW=1099&RH=611
…les mêmes (très impressionnés par Léon Daudet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phlyax_scene_Dirce_Painter_MAN.jpg
… petits minables leur dit Léon.
https://www.flickr.com/photos/mharrsch/481810541/in/photostream/
lmd dit
Je vous ai déjà dit mon adresse.
C’était la SPA d’où, déjà?
…vous n’ arriverez jamais à mon niveau, vous fatiguez pas.
Pablo, tu l’as notée? Ça m’intéresse aussi.
Chaloux dit
Non, du tout. Comment croire un corniaud qu’au lieu d’écrire, aboie?
À mon avis, c’est encore un pseudo du Pétomane. Son « Je vous ai déjà dit mon adresse. Frappez à la porte et on se verra » rappelle furieusement le « si tu veux m’insulter tu me donnes un rv quand tu veux et après en face à face on voit si tu m’insultes encore » signé hamlet dit: le 4 octobre 2018 à 12 h 33 min.
Como Rodriguez aussi c’est lui, les deux ne connaissant pas un mot d’espagnol. C’est son avatar argentin, celui qui pleure en écoutant parler le danseur homo Jorge Down…
« Clébard de clochard »
Mon cher Pablito 75, vous n’auriez pu imaginer meilleur compliment…
Merci
lmd dit: à
… petits minables leur dit Léon.
…les mêmes (très impressionnés par Léon Daudet)
lmd dit: à
Deux célèbres duettistes prennent la pose, à l’antique.
lmd dit: à
…vous n’ arriverez jamais à mon niveau, vous fatiguez pas.
lmd dit: à
Voilà la preuve définitive que lmd c’est le Pétomane. Comme par hasard ils se défendent ENSEMBLE, les deux avec la même naïveté bête et puérile typique du Pétomane quand il est vraiment énervé…
Mon cher Pablito 75, vous n’auriez pu imaginer meilleur compliment…
jorge Rodriguez
Voilà, ça aussi c’est un bon exemple de l’esprit pétomanesque pur… Il est tellement énervé qu’il oublie même de déguiser un peu son style.
Quoi qu’il fasse ou disse, le Pétomane est transparent parce que sa connerie est unique.
Pour vous renato
Renato
Je cherchais des dahlias ; ceci sknt des pivoines, j’ai commis un impair. Plates excuses.
Pablito, Pablito, vous êtes émouvant… de toutes façons, comme je vous l’ai déjà dit, quelqu’un qui aime César Vallejo ne peut pas être méchant… même s’il s’efforce de le paraître… Comme a pu l’écrire Ionesco, « tu sas, Jacqueline, unie image n’est pas une image, une image est une image »…
Tendres bisous.
question rhétorique à Christiane à prendre plutôt comme un remerciement que comme un « reproche »:comment expliquez vous que Raphael « écrive » en hébreu (fresque d’Isaïe ) et que vous n’appreniez pas à lire l’hébreu biblique?
Comme je m’intéresse à l’écriture ,et l’écriture dans la « grande » peinture j’avais imaginé un jour faire un catalogue de l’écriture hébraïque dans la peinture;je persiste à penser que ce doit être intéressant, et à espérer que ce sera fait
Vous fatiguez pas plus Pablo 75, j’ai perçu vos dons de physionomiste ; vous croyez toujours avoir trouvé qui est quelqu’un d’autre et à la fin tout le monde se fiche de vous.
RAPHAEL FRESQUE D Isaïe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Proph%C3%A8te_Isa%C3%AFe_(Rapha%C3%ABl)#/media/Fichier:Raffael_-_The_Prophet_Isaiah_-_1511-1512.jpg
Le commettent de l’Isaie jugeait le prix exorbitant et il en parla avec Michelangelo qui, appréciaiant l’hommage de Raffaello, aurait répondu : « Le seul genou vaut son prix ».
Aller-retour. L’œuvre rappelle l’Ézéchie de la Sistina, toutefois si on analyse la position d’Isaïe on se souvient du Moïse, commencé par Michelangelo l’année suivante.
Commettent traduction barbare de l’it. committente, lire donc client. Pardon, etc.
Pablo75 dit: Voilà la preuve définitive que lmd c’est le Pétomane.
»
non alors là ça suffit ! à la longue c’est vraiment pénible ces histoires !
d’accord 3j m’a incité à la sagesse grecque et à ne pas réagir, mais c’est trop c’est trop !!!
bon ! pablito je vous explique une dernière fois et puis après basta moi je rends mon tablier :
si lmd est aussi un Pétomane cela ne veut pas forcément dire que c’est moi !!!!!!!
je veux dire nous pouvons être plusieurs Pétomanes sur ce blog !
je me souviens quand Giscard avait dit à Mitterrand lors d’un débat pré électoral resté dans toutes les mémoires « vous n’avez pas le monopole du coeur… »
et ben là le coeur et le Pet c’est pareil : je n’ai pas le monopole de la Pétomanie !
si ça se trouve d’autres ici aimeraient aussi être des Pétomanes, surtout avec un « P » majuscule…
Pablo, je me marre, parce que j’ai l’impression qu’à l’exception de 1 ou 2 personnes sur ce blog tous les autres ont compris ce que vous êtes, et plus ils comprennent et plus vous vous enfoncez.
je reconnais que ça me fait plaisir, parce que j’ai été le premier à voir qui vous étiez, et à l’époque je me sentais seul, ce qui m’agaçait, je me disais c’est pas possible, ils ne savent donc pas lire !
bon c’est vrai, étant un musilien de formation j’ai un don pour savoir lire mieux que les autres… disons que les autres lisent et moi je comprends de suite ce que je lis…
mais là maintenant c’est bon : tout le monde a compris ! et je trouve ça génial !
« Jibé, je faisais allusion aux analyses (ni expéditives, ni simplistes) des positions de Nietzsche par d’Alasdair Macintyre »
merci de la précision, x, je vais aller me renseigner, je ne connais pas After Virtue, c’est un plaisir de découvrir du nouveau.
« Il faut relire « Le stupide XIXe siècle », de Léon Daudet » ah ça je connais, alors pas deux fois, non!
Tous ces crétins veulent faire de l’esprit mais aucun n’a d’esprit.
Je vais faire un test.
Crétin, es-tu là ?
Reconnaissons, Chaloux, que vous avez fait preuve d’un esprit éblouissant à propos de la banane qui bouche le port de Marseille. C’est Léon Daudet qui vous inspirait ce jour là ?
de toutes façons, comme je vous l’ai déjà dit, quelqu’un qui aime César Vallejo ne peut pas être méchant…
jorge Rodriguez dit:
Parce qu’il était coco, comme toi, Pétomane…
Pétomane, abandonne tes pseudos « lmd » et « jorge Rodriguez », tu les as grillé aujourd’hui.
(D’ailleurs, cela correspond à quoi le L de « lmd »? Tu t’appelles Louis Maurice Desborels?)
Tous ces crétins veulent faire de l’esprit mais aucun n’a d’esprit.
Chaloux dit:
C’est exactement ça. Ils veulent se venger en étant drôles et ils n’arrivent qu’à être pathétiques.
D.,
Fellini tournait je ne sais quel film ; Toto traversa le set et Fellini dit :
« C’est qui ce crètin ?
— moi », répondit Toto.
Toto :
https://youtu.be/pUBU1SJTLZg
M Court, il y a un certain temps que je voulais répondre à vos attaques contre « L’histoire de la musique » de Lucien Rebatet, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je peux consulter mon exemplaire…Je crois que vous avez été parfaitement injuste. Non, Rebatet n’encense pas Bruckner parce qu’il serait un pur allemand. Il le ridiculise plutôt en tant que personne (un balourd à la limite de la niaiserie) tout en reconnaissant ses talents de symphoniste. Il loue aussi son Te Deum mais n’en fait pas pour autant un géant de l’histoire de la musique. Il est beaucoup plus élogieux avec Mahler, d’origine juive comme chacun sait et lui consacre plus d’espace qu’à Bruckner. Rebatet montrent même une sympathie réelle pour l’homme Mahler. Par ailleurs, je n’ai vu nulle part qu’il traitait Meyerbeer de « sagouin » comme vous l’affirmez…
Pour vous répondre, j’aurai au moins eu le plaisir de me replonger un moment dans cette Histoire de la Musique, véritable chef d’oeuvre de vulgarisation intelligente qui se lit avec un plaisir extrême…
Le seul reproche que l’on peut faire à Rebatet est de refléter un peu trop fidèlement les modes de son temps (fin des années soixante). Il se croit obligé de fustiger « l’académisme » et de montrer une complaisance coupable pour l’avant-garde, même inaudible…
toutes ces histoires de pet et contrepet deviennent des signes d’effondrement :
« Il faut arrêter de couper les nouilles au sécateur. Et bosser »
sur LSP
@ Chaloux
J’ai cité ce matin Scutenaire, dont je viens de finir de lire les deux volumes de « Mes inscriptions » (Ed. Allia, 2007 et 2017), trouvés l’année dernière chez Gibert, deux livres qui font presque 600 pages avec lesquels l’ami Louis aurait pu faire un très bon petit livre d’aphorismes d’une centaine de pages, en éliminant beaucoup de conneries (comme ses soi-disant poèmes très longs et complétement débiles) et des réflexions ou très banales ou sans aucun intérêt. J’avais lu d’autres éditions des « Inscriptions » (il y a très longtemps, à la Bibliothèque de Beaubourg), qui devaient être des anthologies, parce que j’en avais gardé un très bon souvenir, alors que cette fois lire autant de bêtises à côté de très bons aphorismes de temps en temps cela finit par fatiguer.
Bref, dans le premier volume, il écrit cette phrase dont je voulais savoir ce que tu en penses, étant donné que tu connais bien mieux que moi les deux livres: « Au Château d’Argol de Julien Gracq est Le Grand Meaulnes de notre avant-guerre ».
@ christiane
cette reponse pour vous a votre dernier post sur edith Wharton:
Vous m’avez donné grande envie de lire cette préface.
Jusqu’à votre avis le rapprochement que vous faites ave l’éducation sentimentale se justifie –t-il ?
A mes yeux, certes, l’amour d’Acher pour Ellen ressemble effectivement à celui de Frederic pour Madame Arnoux en ce sens qu’ils sont tous deux pour ainsi dire « hors sol’, de sorte que les couples qu’ils formeraient seraient inévitablement destinés à se dissoudre faute d’un terreau social susceptible de les accueillir et de servir de cadre a leur évolution et à leur maturation dans le temps .
Je vois d’après ce que vous me dites de la préface que c’est cette version ,celle d’un couple qui meurt faut d’avenir possible , qu’a envisagée Wahrton ,et qu’lle l’a rejetée actant en quelque sorte , que ce genre de relation ne peut rester, selon les cas qu’un heureux ou douloureux souvenirs si elle allée jusqu’au bout ou ; ou dans le cas contraire alimenter un regret permanent et ému d’une aventure exceptionnelle a côté de laquelle on est passé, ce qu’elle a en définitive choisi comme dénouement du roman
La pour moi s’arrête la similitude
Cette divergence que je reléve tient d’abord aux circonstances de la naissance de cet amour ;chez Wharton Acher est seduit par une femme dont la fréquentation lui révèle ce qui manque à sa fiancée et lui fait prendre conscience la pesanteur du carcan social dans lequel il est enserré . En face de cette femme qu’il va admirer parce qu’elle est différente ,parce qu’elle a l’audace de vouloir être elle même au prix d’une méconnaissance des conventions de son monde, il prend conscience que la personne qu’il va épouser et qu’il croyait aimer a pour seule identité d’être le pur produit du système de conventions qui désormais lui pèse. Son amour pour Ellen, en aidant Acher à porter un regard lucide sur son monde, le mûrit .
Frederic au contraire tombe amoureux de Madame Arnoux parce qu’il est alors un adolescent naïf nourri de romantisme par des lectures qui ont laissé divers clichés dans son esprit ,ce que nous indique par petites touches Flaubert nous faisant découvrir le personnage à travers des details matériels , son look copié sans doute de ce qui pour lui signale le poete , cheveux longs et cravate bouffante ,et le recueil de penséées qu’il tient en main
il vient pour la premiere fois de quitter sa mere, de se sentir adulte, appelé a un destin dont il ignore quelle sera la tonalité et , porté par les clichés qui l’habitent il est en situation d’attente du grand amour qui va surgir d’un coup de foudre .Et c’est alors , que, par hasard, son chemin croise celui de madame Arnoux ,moment magique et quasi mystique vécu comme une illumination religieuse, quand la petite bourgeoise installée sur le bateau à côté de sa bonne et empêtrée de bagages et d’enfants se transforme en creature de rêve .
Le coup de foudre de Fréderic est un emballement de gamin imaginatif , celui d’Acher celui d’un homme que cet amour éclaire sur lui-même
Par ailleurs il faut bien voir que la place de cet amour impossible à une portée tres differente l’economie des deux romans
Chez Wharton le sujet du roman c’est le vécu de cet amour par Acher et les ,« intermittences du cœur » qu’il suscite chez lui au fil de ses impressions , de ses réflexions, de ses décisions ,de ses revirements, de ses hésitations
L’Education sentimentale c’est avant tout l’histoire d’une vie ratée , celle de Frederic ,ce garçon qui échoue partout parce qu’il ne sait pas choisir sa destinée. Et chacune des voies qu’il emprunte et dans lesquelles il ne persévère pas est personnifiée par une femme :Ou bien avec madame Arnoux dédier sa vie à une grande passion dévorante, exclusive, et ignorante du monde exterieur ;ou bien avec Rosannette choisir une vie de plaisirs faciles ;ou bien avec Madame Dambreuse faire le choix de l’ambition sociale
.Le personnage de madame Arnoux et la tentation qu’elle représente a un moment de la vie de Frederic n’est qu’un des volets du sujet ,un élément dans la genèse de cette accumulation d’échecs qui trouve son aboutissement dans le réenracinement provincial de Frederic ,
Cet ultime choix par défaut, qu’il tente comme pour couronner son échec, s’incarne aussi dans une femme ,celle avec laquelle il envisage en définitive un médiocre et confortable mariage provincial, mais auprès de laquelle il est devancé par Deslauriers
Pablo, Gracq aurait été fâché par ce jugement car il tenait LEGM pour de la littérature de pacotille. Je crois d’ailleurs que c’est faux. Gracq n’était pas assez pervers pour le écrire un Grand Meaulnes. S’il fallait chercher un répondant, il y aurait certainement le livre d’Haedens que je viens de terminer. D’une certaine maniere toutes les valeurs, amitié, amour, desir, qui font le Grand Meaulnes y sont présentés sous leur jour le plus ridicule. Mais on a aussi l’impression bizarre qu’Haedens ne tenait pas particulièrement à réussir son livre et c’est le plus grand reproche qu’on pourrait lui faire.
De plus, je ne crois pas qu’on écrive de Grand Meaulnes après-guerre. On les écrit plutôt avant dans la tension qui les précède.
(J’écris sur mon smartphone, pas simple).
Présentées.
« Samuel fait défiler les commentaires, comme d’habitude ils virent à l’affrontement général, les échanges tournent souvent à la polémique. Surtout de la part des hommes, leur agressivité est plus grande que celle des femmes, les femmes peuvent parler tranquillement de leurs lectures, si l’une d’elles n’est pas d’accord, elle le dit, s’ensuit alors une discussion entre elles, calme et paisible.
D’ailleurs en faisant défiler les commentaires Samuel aperçoit une discussion entre Ophélie et Clarissa sur Philip Roth, il se demande comment cet écrivain a bien pu débarquer dans une conversation qui au départ concernait la littérature allemande, il n’a pas le courage de revenir en arrière pour élucider ce mystère, il lit ce commentaire où Ophélie dit posément à Clarissa aimer tous les livres de Philip Roth, tous sans exception aucune, même si elle trouve que certains de ses livres sont un peu trop longs à son goût, les romans d’imagination, les fictions, même lorsqu’ils ne sont pas du premier ordre m’ont toujours été une grande source de distraction et de plaisir, je bénis souvent les auteurs de les avoir écrits, écrit Ophélie en conclusion de son commentaire à l’attention de Clarissa. Je reconnais ma chère que même dans les œuvres que nous vénérons il y a toujours des moments où l’on décroche, sans doute notre premier contact avec cette œuvre est-il si fort, tellement puissant que notre sensibilité s’émousse au fil des pages, lui répond Clarissa. Concernant la Pastorale Américaine de Roth, je trouve ce roman un tiers trop long pour être le chef-d’œuvre attendu, lui répond Ophélie dans le but de poursuivre cette discussion calme et paisible. Dites-moi diable quel tiers vous enlèveriez à ce roman qui n’a besoin d’aucun retrait pour être un véritable chef-d’œuvre, lui répond Clarissa, ajoutant en citant un écrivain que si chaque auteur allégeait ses œuvres pour contenter les lecteurs aucune œuvre n’existerait.
Les autres commencent alors à s’en mêler, immanquablement le ton monte, il monte d’un ton et souvent de bien plus, il monte en puissance, il monte en injures et en insultes, il monte tellement qu’il déborde du sujet. Roth ne peut pas être compris si l’on n’a pas lu la Bible, écrit Job dans un commentaire. Tiens, il y avait longtemps qu’on ne nous avait pas bassinés avec Dieu, serait-il possible de demander aux modérateurs d’exclure tous ces religieux, tous ces culs bénits et autres grenouilles de bénitier de ce blog littéraire, qu’on puisse enfin respirer, à la longue ces histoires de religion deviennent vraiment insupportables, répond Roméo, un photographe esthète autant esthète qu’athée. Parce que pour vous, dans ce livre il n’est peut-être pas question de terre promise peut-être, si cette gamine poseuse de bombes bégaie comme Moïse c’est peut-être le fruit du hasard, répond Job sur un ton qui se veut ironique.
Là-dessus Yorick surenchérit, évoquant Nietzsche et Dostoïevski dans une enfilade interminable de commentaires eux-mêmes interminables. C’est une torture que de lire vos commentaires mon pauvre Yorick, pourquoi vous sentez-vous obligé d’écrire ces trucs sans fin quand trois mots suffiraient à résumer la pauvreté de votre pensée minable, répond Roméo aux interminables commentaires de ce pauvre Yorick.
Cette banale discussion littéraire devient alors soudain un véritable champ de bataille, chaque camp se retranche derrière ses lignes, le camp des heideggeriens et celui des anti-heideggeriens, des nietzschéens et des anti-nietzschéens, des croyants et des athées, des pro-Grass et des anti-Grass, des pro-Céline et des anti-Céline.
Comme si, en ce monde, tout se résume à un combat entre les pro et les anti, les obus se mettent à pleuvoir, les balles sifflent au-dessus des têtes, des tirs à l’arme lourde, le premier qui a le malheur de pointer le bout de son nez risque de recevoir un projectile mortel, pendant que la guerre fait rage, Ophélie et Clarissa continuent tranquillement leur conversation sur Philip Roth.
Samuel sourit devant son écran, d’habitude ces échanges l’intéressent, mais cette fois il n’a pas le courage de continuer, de lire les autres commentaires, il se sent fatigué, fatigué et fiévreux, sa gorge lui fait de plus en plus mal, c’est sûr, se dit-il, c’est encore une foutue angine.
Samuel éteint son ordinateur et repense à Thomas Mann, il y repense comme dans un rêve, comme s’il rêvait à ce qu’il pense, c’est vrai, se dit-il en reprenant une pastille pour le mal de gorge, dans la Montagne Magique, Thomas Mann réussit le coup de force de mettre dans un bocal toute l’intelligence produite par les grands penseurs européens, les grands maîtres de la pensée humaniste, des penseurs humanistes de haut rang, le sanatorium est ce bocal, situé loin des réalités du monde, situé sur les hauteurs, sur les cimes, les cimes de la pensée, des grandes idées, les cimes des esprits supérieurs dans un monde malade, le monde d’en bas, se dit Samuel de plus en plus fiévreux, un monde tellement malade que les grandes idées produites par ces penseurs de haut rang ne peuvent plus le soigner, se dit-il la gorge de plus en plus douloureuse, toutes ces idées nées dans une partie du monde si orgueilleuse de son humanisme, ces idées ne sont ni un vaccin susceptible d’immuniser le monde contre sa maladie, ni un médicament capable de le guérir de sa maladie, se dit Samuel en se demandant s’il ne devrait pas reprendre de l’aspirine avant de se coucher, il ne reste alors que l’existence des personnages, leurs désirs, leurs amours, leur désir d’amour, leur désir d’absolu et leur peur de la mort, se dit Samuel, fiévreux et à moitié endormi, repensant à ce pauvre Yorick, sa soif d’absolu et son désir d’harmonie, ses attaques incessantes contre l’individualisme et le nietzschéisme, ses attaques contre une société malade d’être devenue trop nietzschéenne, ses attaques contre tous les nietzschéens de la terre qui, selon ses termes, poussent plus vite que la mauvaise herbe, une société faite d’individus rois, des individus tout puissants construisant eux-mêmes l’horizon de leurs propres valeurs immorales, ce pauvre Yorick, son désir de transcendance est si vain, ses commentaires tellement excessifs, extrêmes, exubérants, tellement longs, interminables, minables, inutiles, tristes et inutiles.
Samuel prend ses trois livres, les deux tomes et l’autre, Antimatière, monte dans sa chambre, s’allonge sur son lit tout habillé, commence à lire, on signalait une dépression au-dessus de l’Atlantique, elle se déplaçait d’ouest en est en direction d’un anticyclone situé au-dessus de la Russie…, il lit jusqu’à la fin du premier chapitre, autrement dit, si l’on ne craint pas de recourir à une formule démodée, mais parfaitement judicieuse : c’était une belle journée du mois d’août 1913, puis il s’endort. »
Antimatière (Louis Maurice Desborels dit lmd) édité en République de Finlande.
@DHH
Votre analyse comparative des deux couples est si fine que je l’ai relue pour le plaisir.
Juste avant cette phrase que vous aviez mémorisée : « le mariage le plus ennuyeux n’est pas une faillite, tant qu’il garde la dignité d’un devoir », il y a ces quelques lignes (traduction 1921)qui sont comme une clé pour entrer dans la chambre secrète des pensées d’Archer Newland :
« Lorsqu’il se souvenait de Mme Olenska, c’était d’une façon irréelle, avec sérénité, comme on penserait à une bien-aimée imaginaire découverte dans un livre ou dans un tableau. Elle était devenue l’image de tout de dont il avait été privé. »
C’est sans soute ce passage, très beau (et un autre qui va suivre ci-dessous), qui ont réveillé en ma mémoire cet échange que vous aviez eu avec Gisèle sur la beauté de de la rencontre de Frédéric et Mme Arnoux.
Le deuxième passage qui m’a marquée c’est la dernière rencontre clandestine de Mme Olenska et Archer dans ce musée où sont conservés des animaux naturalisés, un lieu où ils seront seuls dans New-York.
Tout sent la mort dans ce musée où ils marchent dans « le vide de longues galeries sonores » entre des vitrines emplies d’animaux « moisis », de « momies », de « sarcophages » où « le gardien traverse la salle avec le pas errant d’un fantôme ». Lieu propice aux adieux… où Ellen répond à Archer qui s’étonne de son projet de voyage et de sa remarque « il m’a semblé que j’étais ici moins en danger. »
Archer répliquera : – Moins en danger de m’aimer ?
– Moins en danger de faire un mal irréparable. Ne soyons pas comme tous les autres ! répond Ellen. »
Sarah Fosse écrit dans sa préface : « Il est significatif que Newland Archer et la comtesse Olenska aient leur ultime tête-à-tête dans un musée désert où règne le silence, où sont exposés les vestiges archéologiques d’une civilisation disparue et qui est explicitement comparé à une nécropole : celle de leur amour (à partir de ce moment-là, Archer ne verra plus Madame Olenska seule et assistera impuissant au cérémonial de sa mise à mort sociale, puis à sa disparition), mais aussi celle d’un monde voué à s’éteindre…. »
Beaucoup de beauté et de finesse dans les deux romans mais vous avez raison de préciser leurs différences.
Merci, DHH.
en lisant les échanges paisibles entre christiane et DHH cela m’a fait penser à cet excellent passage de cet excellent livre écrit par cet excellent grand écrivain franco-finlandais que j’ai lu il y a quelque temps…
HAMLETj’ai lu cette critique ce matin;
avec ces remarques: »
lors d’un entretien d’embauche dans une agence fédérale américaine, un personnage se voit demander quelle est sa religion. Quand elle répond qu’elle n’en a pas, le recruteur en conclut qu’elle est athée. Elle lui rétorque alors : « Je m’en fous, Dieu, pour moi, c’est comme le bridge : je n’y pense jamais. Donc, je ne me définis pas par le fait que je me fous du bridge, et je ne me réunis pas non plus avec des gens qui discutent du fait qu’ils se foutent eux aussi du bridge. » »
voici la conclusio:
Ajoutons pour finir que L’anomalie est un roman très drôle. Hervé Le Tellier, dont on a pu découvrir les penchants pour la facétie à la radio (« Des Papous dans la tête ») et qui est quand même parvenu à convaincre un éditeur de publier un livre intitulé Joconde jusqu’à cent, auquel il a donné une suite, Joconde sur votre indulgence, a le sens de l’humour et le rire intelligent. Ça fait plaisir. »
oui, ça fait plaisir
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/09/09/dieu-bridge-letellier/
trois clébards de clochard venant sur ce blog pour nous montrer qu’ils savent aboyer
Ainsi vous empruntez comme un bon Toutou à sa mémère. C’est la première à avoir utiliser cette notion, clebard(e), clebardise qui peut être comprise comme remplaçant un terme plus correct et tout autant signifiant: suiveur, suivisme, suivisme, sans initiative. Le bain finit par imprégner les aficionados proches ou lointains. Le réseau permet la proximité en dépit de l’éloignement geographique , de l’impregnation il faut se méfier même si elle se traduit que par des emprunts futiles, contingents et superficiels. L’imagination au service du dénigrement devrait susciter quelques travaux pour ne pas avoir air d’un sans ressources créatives et langagières.
@lmd, vous habitez un bien chouette quartier. J’ai découvert l’église Saint-Victor il y a peu et ai pu y admirer le fémur en majesté du saint éponyme…Cela m’a rappelé les reliques qui peuplent les belles églises portugaises de Goa (merveilleux bâtisseurs que les Portugais!).
Cela m’a rappelé le concert de tibia d’aristo qu’avait donné Jean-Jacques Lemêtre. Je vois très bien le génial géant forer quelques trous dans l’os du Saint-Victor pour en sortir de divins sons!
en lisant les échanges paisibles
C’est sûr qu’en cumulant un siècle et demi à deux , peuvent se gargariser le dentier de vies qu’elles n’ont pas eues, coincées entre la cour d’école et la popote.
lmd doit être un pro de la bouille à baisse…😊
Chapeau.
Près de St Victor, de la bouille à l’abesse, alors. Allez, c’est presque le week-end.
aïe, abbesse.
A-t-on des nouvelles de Denise ?
Eh bien oui.
Sa nouvelle vie, est en compétition, sur une liste de prix litteraire.
La gloire, pour Denise, en liste pour le Renaudot.
Ok, c’est de l’humour noir, surtout avec Christian Giudicelli, toujours au jury…
Enfin ce touriste sexuel n’aura été pour rien dans le succès déjà acquis à « l’ once » (*) l’an dernier.
On se console comme on peut, ma pauvre Denise.
@hamlet,
je me souviens bien de ce roman Antimatière de Maurice Desborels dit…, édité chez Atramenta.
Un récit alternant des passages très littéraires comme celui-ci, un jeu de piste digne d’un polar, et un roman de science-fiction. Je me souviens de ce personnage, Samuel qui ne lisait plus que des critiques de livres après avoir été un grand lecteur. Un personnage mi-naïf, mi-amer.
Le lisant j’avais pensé à un autre roman étonnant, inclassable Hyrok de Nicolaï Lo Russo, édité par Léo Scheer. Le personnage, Alain Dubreuil était déroutant… Je l’avais découvert sur un blog superbe, celui de Leo Nemo (autre mystère…), où le livre était présenté chaleureusement.
Ces deux romans me parurent être les créations d’un écrivain qui se serait inspiré de Romain Gary qui a écrit sous le pseudonyme d’Emile Ajar… Une mystification étrange pour un écrivain caméléon, aimant les pseudonymes…
Des fausses pistes dont une vidéo cocasse, une présentation de roman où l’éditeur s’étonnera que l’auteur soit absent…
« J’étais las de n’être que moi même. J’étais las de l’image Romain Gary qu’on m’avait collée sur le dos une bonne fois pour toute depuis trente ans, depuis la soudaine célébrité qui était venue. […]
J’écris ces lignes à un moment où le monde, tel qu’il tourne en ce dernier quart de siècle, pose à un écrivain, avec de plus en plus d’évidence, une question mortelle pour toutes les formes d’expression artistique: celle de la futilité. De ce que la littérature se crut et se voulut être pendant si longtemps – une contribution à l’épanouissement de l’homme et à son progrès – il ne reste même plus l’illusion lyrique. J’ai donc pleinement conscience que ces pages paraîtront sans doute dérisoires au moment de leur publication, car, que je le veuille où non, puisque je m’explique ici devant la postérité, je présume forcément que celle-ci accordera encore quelque importance à mes œuvres et, parmi celles-ci, aux quatre romans que j’ai écrit sous le pseudonyme d’Émile Ajar.
Je me suis bien amusé, merci beaucoup. »
Vie et mort d’Émile Ajar – Romain Gay – Gallimard.
hamlet, vous n’avez pas à être déprécié pour ce roman sauf par un … gobe-tout…
Entre popote inomales et art de la gastronomie lequel m’est étranger, il reste du temps pour lire, réfléchir, penser, réagir. Dentiers à vies, que voulez dire à part attribuer des caractéristiques qui restent de purs fantasmes, votre couperose se porte elle un peu mieux que ce sourire que vous n’aviez et ne vous donne pas si fière allure qu’à peine vous résoudre à révéler. Ultra bright, c’est quand même autre chose . Voyez ED, pour exemple. Quelle charme instantané, n’est ce pas. Je lisais ces jours ci une présentation d’une très jeune agrégée, jolie et talentueuse, fraîche et en plus d’un potentiel supérieur, chargée de qualités qu’on espère ne pas lui voir perdre.
La Demoiselle à cœur ouvert,
de Lise Charles,
P.O.L, 352 p., 21 €, numérique 15 €.
Le pangolin fait son mercato.
Qu’à peine vous consentez à révéler. Mes excuses les plus plates.
Qui est Christian Giudicelli, écrivain, éditeur et compagnon de voyage de Matzneff ?
Bloom, j’ai jadis séjourné à Diu, dont voici l’église
Je me souviens que non loin étaient installées séchages de poissons sur des files de nombreux filets à ciel ouvert avec odeur prégnante qui allait inmanquablement avec. L’alcool y était autorisé et nombre de necessiteux venaient s’échouer dans cet ex comptoir , certains gisant sur le trottoir.
« cette soeur ainée adulée était celle qui lui avait ouvert la voie en l’aidant à s’extraire d’une famille et d’un milieu résignés à leur médiocrité »
Si le Renaudot arrive à couronner cette merde misérabiliste , je ne donne pas cher de la réputation des jurés.
Il n’a toujours pas démissionné le Nobel ?
Un peu d’histoire, nord de Inde, Diu et ses soeurs
https://www.lhistoire.fr/carte/l’océan-indien-au-xvie-siècle-lac-portugais
tata mégot est en forme ce soir. Encore plus destroy que d’habitude , si c’est possible.
« Samuel fait défiler les commentaires, comme d’habitude ils virent à l’affrontement général
hamlet dit:
Pétomane, tu radotes (encore un signe de ton alzheimer?) : ce texte tu nous l’a infligé déjà en août-2019.
Ou alors tu es particulièrement fier de lui, ce qui est encore plus grave, puisqu’on dirait un brouillon d’un apprenti romancier de 16 ans.
La cliente de Lidl , une vieille prof très glamour comme on en a sur la rdl, qui allait mater la caissière, sera sur la place Stan.
https://www.livreshebdo.fr/article/marie-helene-lafon-prix-des-libraires-de-nancy-le-point-2020
Au secours, faites de la place à Fus, Passou, please.
Hamlet
Merci pour lmd Très bel échange chez Maurice Desborel.
Hamlet Christiane DHH
Frédéric est sans doute l’expression même du romantique éthéré, égaré.
Ke mouchoir de baptiste qy’il ramasse avec dévotion sur le bateau ; le gznou de Mme Arnoux qu’il frôle avec émotion sous la table. Tout lui est prétexte à palpitations.
Saseur, je vous laisse à vos rails. Occupez vous de vos coms, les miens ne sont que reponses à vos insinuations ou en occurence ne vous est pas adressé pour le derniere. Occupez vous de vos quolifichets accueillants, de votre carnet adresse e tue-mouches, de votre fond de bibliothèque qui indéniablement vous permet de progresser vers une mentalité que de nombreux trou du cul qui semblent l’approuver en plus de la maîtresse lieux et de son sens de l’accueil.
…l’approuver recherchent…
Innomables, décidément, même à me relire, je vous laisse à défaut de répérer ces fautes impardonnables les corriger. Merci de votre indulgence patiente.
tata megot est fumace.
Maurice, tu mériterais une place sur la liste du prix premier roman.
marie Sasseur, vous semblez habitée d’une vraie colère et à laquelle tour le monde est indifférent:que pouvez vous en dire, au juste?
A propos de Lise Charles
le 09 09 2020 vers 21 h26.
@vous semblez habitée d’une vraie colère et à laquelle tour le monde est indifférent.
Non, c’est une impression que vous avez. En tout cas pas ce soir.
Ou alors faites-vous référence à ce depit de voir promue de la merde misérabiliste comme une des plus fortes » surprises de la rentrée « , et vous auriez raison.
Je déplore que souvent promue de la merde
Ah je n’ai pas effacé la fin du brouillon.
Du tout, Sasseurcuisineaubeurre, on connait tous vos habitudes au dénigrement, à la critique négative, à votre choix de vie licencieux , de là à ne pas ramasser vos ordures, non , j’ai en horreur la crasse. Et je ne vous laisserai pas salir mon pas de porte. Je ne dispose d’aucun employé de maison aussi sans faiblir je fais ce que j’estime être d’une utilité salubre. Croupissez très chère dans les affres de vos enfers additionnés de lectures et rencontres vantées ou éventées d’une façon ou d’une autre avec tant de subtilité. Une specialité de votre » maison ».
tata mégot s’acharne inutilement, je suis en mode avion, c’est une expression qui fera date, quand je lis son » nom ».
Sinon, ce devrait être la fête de la littérature, a cette époque. Et invariablement, ici, le commentarium est sinistre.
C’est grave, je trouve.
Enfin, moi, je vais aller faire un tour aux Correspondances.
L’alcool y était autorisé et nombre de necessiteux venaient s’échouer dans cet ex comptoir , certains gisant sur le trottoir.
—
Le Gujarat est un état « dry », effectivement, sauf cette magnifique poche autrefois portugaise…C’est bien d’avoir vu autre chose que le sempiternel Rajasthan!
C’est la même chose à Pudducherry où on trouve plus de 200 magasins servant de l’alcool, aisés à repérer parce qu’indiqués par un néon bleu blanc rouge, avec un B dans le bleu, un A dans le blanc, et un R dans le rouge…3 bonnes raisons de ressortir complètement « noir » si je puis dire…
De nombreuses loques humaines, affalées sous des températures dépassant les 45° avec 90% d’humidité relative…
Le weekend, c’est la jeunesse de Bangalore qui déboule en masse, et qui hélas trop souvent se crashe sur le chemin du retour…Bon nombre d’étudiants français en stage de fin d’études dans la Silicon Valley indienne ont fini à la morgue de cet ancien comptoir… (de BAR)…
Goa a ses propres turpitudes, mais les églises y sont remarquables, comme le sont celles de Kochi, l’ancienne Cochin, haut lieu de l’art contemporain indien avec sa biennale et cité lacustre mesmérisante.
Oh et alors la brochette de metoos victimisees invitées par Ultrabright, ce soir, dans sa grande bibli, c’est le summum.
Sasseur, à mes yeux, vous etes un détritus cultivé. Vous devriez opter pour l’auto recyclage bien que l’écologie et l’avenir de nos enfants soit le cadet de vos préoccupations, je me fiche de ce que vous pensez et vos rabachages n’y pourront rien changer. Rica Zaraï de la littérature, Annie cordy du concept, madame Claude de la transaction putassiere. Il vous faut esperer rencontrer un homme aimant et thérapeute à ses heures, il y a fort à faire.
Le déchet est revenu de Goa. 😁
Vous affirmez Chaloux que le jugement de Gracq sur « Le Grand Meaulnes » est« littérature de pacotille » ,jamais trace de cette expression chez lui.Où avez trouvé ça? En 1946, dans « Lautréamont toujours » il dit clairement qu’il n’aime pas « le Grand Meaulnes », il parle « « d’eau fade de souvenirs bénits »
Plus tard, Gracq révise complétement son jugement sur le roman. Il cite un passage en écrivant ceci : »Il y a dans Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier une notation qui me plait beaucoup :quand Meaulnes s’échappe, avec la carriole pour aller chercher les parents à la gare. »
Dans ce Lettrines 2 il détaille ce qu’il aime « la guette invisible et tendue de la campagne,les yeux qui de loin suivent, supputent, interprètent la petite ombre qui va seule sur le chemin.. » etc etc..
Toujours dans Lettrines 2 il est fasciné par « tous les ressorts secrets d’un livre comme Le grand Meaulnes où le fantastique enfantin de la distance joue un rôle si éminent ». Dans « les eaux étroites »(1973) à propos de « la brulure piquante et assoiffante de la limonade tiède. Je la retrouve intacte sur ma langue quand je relis le récit du pique-nique au bord du Cher dans « Le grand Meaulnes » ..
Mieux . Dans « en lisant, en écrivant » (1980) il parle du magnétisme de certains romans et fait un parallèle entre Stendhal et Alain-Fournier ! excusez du peu.. « je ne doute pas une seconde que, pour deux romanciers aussi différents que Stendhal, dans « La chartreuse de Parme. » et Alain Fournier dans « Le grand Meaulnes » , la matérialisation d’une musique intérieure impossible à capturer autrement que dans le déploiement d’un ample récit ait été leur souci unique ».ZEnfin dans les entretiens avec Jean carrière, il parle du « gisement poétique » du Grand Meaulnes et le relie à « Nadja » de Breton. Tout au long de sa vie, Gracq a donc lu, relu, annoté et mieux compris l’importance du « Grand Meaulnes » .
@un parallèle entre Stendhal et Alain-Fournier !
C’est très osé, ce grand écart. Une truc à se faire une élongation inguinale. De la limonade, un souvenir d’enfance, c’est puissant je trouve comme analyse litteraire.
Munissez vousc d’une carte, ce n’est pas du tout situé à proximité ni fréquenté par les mêmes. Vérifiez avant de perorer.
@Gracq a donc lu, relu, annoté et mieux compris l’importance du « Grand Meaulnes » .
Et peut-être pompé une idée ou deux dans » un beau ténébreux » ?
Paimpopol, cherchez du côté des entretiens. Là où je suis, je manque de documentation, mais je vous retrouverai les références. Sur Gracq, il est douteux que vous me preniez en défaut. Et s’il vous plait, ou pas, prenez tout cela de moins haut. Votre orgueil ensanglanté fait des contre-ut assez ridicules.
@C’est très osé, ce grand écart. Une truc à se faire une élongation inguinale.
c’est pourtant très courant.
Train in Vain (Stand by Me)
https://www.youtube.com/watch?v=aUzBgeI5dpc
It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry
@Là où je suis, je manque de documentation
Me too ; en attendant
https://www.youtube.com/watch?v=SRjEqw4GibI
@rose
je trouve que Frédéric n’est pas romantique, c’est un personnage qui révèle tout le pessimisme de Flaubert sur l’humanité. Un dégoût de l’existence, un à quoi bon de raté. Flaubert ne le présente avec aucun lyrisme, seulement tel qu’il est, cet anti-héros qui subit le monde avec fatalisme -tout comme Flaubert subit son temps.
On peut vivre de très belles scènes d’amour et être un désenchanté, finir sa vie comme tel en tout cas (Frédéric l’a commencée dans la rêverie, même trajectoire qu’Emma Bovary)
Curieusement, je vois parfaitement ce que vous voulez dire en associant Frédéric et romantisme, un peu comme si ce personnage était un des derniers soupirs du romantisme que Flaubert dégomme ensuite dans son oeuvre.
bien à vous rose.
« un orgueil ensanglanté qui fait des contre-ut »
????
Toujours dans Lettrines 2, un très beau passage sur la « filiation » Francis Jammes-Alsin-Fournier :
« J’aime dans les temps Clara d’Ellébeuse
l’écolière des anciens pensionnats »
Gracq mentionne la « double distance nostalgique » : « le lointain de l’enfance, certes, mais l’éloignement aussi, qui creuse davantage encore la perspective d’une couche sociale déjà délicatement fanée par une maladie de langeur.
FIlles de hobereaux […], vierges bourgeoises demi-cloîtrées jusqu’à la catstrophe nuptiale hâtée et machinée de longue main par les familles, petites victimes déjà pliantes, pathétiques d’avoir, si jeunes encore, devant elles si peu de temps. […]
Filles d’une caste entrée déjà en agonie, celle de la bourgeoisie rurale liée à la terre et de la petite noblesse, caste appauvrie, […] elles fleurissaient brièvement, pathétiquement, l’espace de deux ou trois étés, avant de sombrer crevées de marmaille et parfois besogneuses au creux des manoirs et des maisons de famille. Plus tenaces pourtant que d’autres au souvenir à qui les a croisées encore, comme s’il avait connu de très jeunes mortes.
Il y a de tout cela dans l’Yvonne de Galais du Grand Mealnes, qui doit tant à Jammes: fin d’une race et d’une caste, fin d’un manoir, fin d’une fortune, douceur frileuse et crépusculaire, résignation, étisie, immaturité prolongée (« Nous sommes des enfants, nous avons fait une grande folie »), bonheur à goût exclusif d’arrière-saison. »
Gracq les oppose à « la petite bande » proustienne de Balbec, au pedigree différent : « filles de “nouveaux riches”, d’une bourgeoisie laïque et montante — dès 1900 déjà sûre d’elle — de hauts fonctionnaires et d’industriels. Jeunes filles en fleur, et non vierges préraphaélites exsangues, surgeons pathétiques d’une terre qui meurt […] et chez les deux écrivains contemporains, également obsédés à leur manière par la femme-enfant, on déchiffre deux poésies de l’adolescence qui se tournent le dos. » (87-89)
Quelques pages auparavant, à propos des passions littéraires des jeunes gens, on apprend que Gracq a lu plus que Le grand Meaulnes :
« Chez l’amateur de belles-lettres encore en bouton, il y a une puberté littéraire toute neuve et constamment en émoi que la seule vue de l’imprimé, indistinctement, met dans tous ses états, comme l’autre puberté une jupe. Le plus curieux exemple de cet éréthisme littéraire inépuisable de l’adolescence se trouve dans les quatre volumes de la Correspondance de Jacques Rivière et d’Alain Fournier. (72)
Dans Les carnets du grand chemin, une note p. 267 :
« Sexualité préraphaélite d’Alain-Fournier, que cerne clairement son teste sur le corps de la femme. La femme est toujours chez lui une Dame Dame de merci plutôt que Dame sans merci, et de préférence une Dame en majesté sociale, en représentation de bienfaisance ou en visite, ce qui la replace d’office au pôle opposé à cleui de la nudité et permet d’ajouter à la chasteté de son harnachement quelques pièces supplémentaires, telles que chapeau, voilette, gants, manchon. La fixation à l’image de la mère est ici à l’opposé de celle de Stendhal (“Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu’il n’y eût pas de vêtements” (Henry Brulard). »
Bloom, quand je vois « dry », je nepeux m’mpêcher de me souvenir que Derrida raconta en cours que l’on avait traduit » Signature Evenement Contexte , par « DRY »;
un détail infime duquel on apprend beaucoup
@ x
« Dans Les carnets du grand chemin, une note p. 267 :
« Sexualité préraphaélite d’Alain-Fournier, (…). La femme est toujours chez lui une Dame. Dame de merci plutôt que Dame sans merci, et de préférence une Dame en majesté sociale, en représentation de bienfaisance ou en visite »
En peu de mots, Gracq a tapé exactement juste.
UNE THESE SUR LA TRADUCTION DE Derrida qui montre comment les lettres nous éprouvent, quant au « qui »,et au « quoi »
pardon, je ne suis pas originale du tout
L’IM-POSSIBLE: AMÉRICANITÉ DE JACQUES DERRIDA
UNE CRITIQUE SÉMIOPOLITIQUE DE LA TRADUCTIBILITÉ D’UN AUTEUR
https://archipel.uqam.ca/8400/1/D3001.pdf
m’empêcher
En attendant la tournée générale de baffes que je ne manquerai pas d’appliquer à la bande de trissotins ignares qui est en train de se former (Ah, Pablo, que d’amitiés indefectibles nous générons entre ces hyènes qui se s’entre-dévoreront à la première occasion!), je me permets de faire remarquer que les entretiens de Gracq se trouvaient encore facilement sur Youtube il y a peu, et que ce doit être encore le cas. Il me semble que le jugement sévère que porte Gracq sur le GM se trouve dans le plus long et le plus interessant, qui doit dater de 1969.
Dans l’Entretien avec Jean Carrière, c’est surtout ce dernier qui formule un jugement très dur sur Le grand Meaulnes, présentant ce jugement comme un écho ou un renfort à une opinion défavorable exprimée par Gracq dans un de ses textes (sans que soit précisé lequel) ; la formulation de la très longue « question » (plus longue que la réponse de Gracq) ni la typographie ne permettent de déterminer si J. Carrière cite littéralement ou s’il s’agit d’une paraphrase quelque peu biaisée :
« Vos réserves à l’égard du Grand Meaulnes sanctionnaient à juste titre l’utilisation du merveilleux plaqué sur le réel, au profit du merveilleux dissimulé en lui, “pris dans la masse” si j’ose m’exprimer ainsi. Pourtant, ce livre a “précipité” quelque chose qui d’évidence a agi sur plusieurs générations […] Cette gloire en gros sous qui s’est abattue sur Le Grand Meaulnes était d’évidence un mauvais placement : c’est exactement le livre destiné à un public qui a besoin qu’on lui mette les points sur les “i”. »
Il [Jean Carrière] aborde ensuite l’image du surréalisme « entachée par des gamineries ».
Réponse de Julien Gracq :
— Le surréalisme n’a certainement pas cherché à avoir son Grand Meaulnes! Mais, dans la mesure où Le Grand Meaulnes, avec tous ses défauts, a mis au jour un gisement poétique jusque-là inexploité, on pourrait dire que le surréalisme a eu le sien sans l’avoir cherché : il s’appelle Nadja. Avec cet avantage que, se présentant comme un simple procès-verbal, le livre échappe à tout l’artifice romanesque, très apparemment fabriqué, qui abîme Le Grand Meaulnes, surtout dans sa seconde partie. » (140-141)
Sévérité nuancée, donc : Gracq ne condamne pas en bloc le roman (la première partie n’est pas vraiment remise en cause) et par ailleurs, pourrait-on abîmer une chose à laquelle on ne reconnaîtrait pas de la beauté, de la valeur et de l’intérêt ? (140-141)
Gracq se trompe complètement sur la sexualité chez Alain-Fournier. Voir l’excellent petit livre du regretté Alain Buisine, les mauvaises pensées du Grand Meaulnes. Puf. Qui encore ne dit quela moitié des choses.
si bien que vous apprécierez l’esprit de cette »communication »
y. Effects of signature are the most common thing in
the world. But the condition of possibility of those effects is Simultaneously, once
again, the condition of their impossibility, of the impossibility of their rigorous
purity. In order to function, that is, to be readable, a signature must have a repeatable, iterable, imitable form; it must be able to be detached from the present and
Singular intention of its production. It is its sameness which, by corrupting its
identity and its Singularity, divides its seal [sceau]. I have already indicated above
the principle of this analysis.
To conclude this very dry discussion:
1) as writing, communication, if we retain that word, is not the means of
transference of meaning, the exchange of intentions and meanings [vouloir-dire],
discourse and the « communication of
http://lab404.com/misc/ltdinc.pdfconsciousnesses. » We are witnessing not
Quand on parle de « romanesque très fabriqué », Zizix croit qu’il s’agit du.d’un éloge. C’est bien le droit de Zizix. C’est bien le mien de penser autrement.
@un détail infime duquel on apprend beaucoup
Perec et les zobs secs, en effet
4th Time Around (Take 5)
https://www.youtube.com/watch?v=FAckCGPDAvg
Nouvelle mention du Grand Meaulnes, dans l’Entretien avec jean-Paul Dekiss (2000), où je ne serais pas allé la chercher (consacré à « l’enfance » il évoque surtout Jules Verne).
Gracq explique que « un siècle plus tard, [Verne] n’aurait pas pu faire ses livres ; il fallait que le monde fût « encore assez impénétrable, assez mal connu, assez hostile pour résister malgré tout à cette démystification [par l’étude scientifique] »
C’est d’ailleurs Gracq qui introduit Alain-Fournier dans la conversation :
« On voit ce monde du merveilleux se rétracter de plus en plus, c’est assez pathétique même… Je ne sais pas si vous aimez Alain-Fournier… »
Réponse de J.-P. Dekiss:
« Oui, le monde merveilleux que veut retenir AUgustin Meaulnes, c’est l’adolescence qui s’enfuit, c’est aussi comme si l’on avait un devoir envers le merveilleux… »
Gracq: « C’est assez pathétique parce que c’est le merveilleux qui l’intéresse, mais on s’aperçoit qu’il ne peut plus exister que dans des conditions très précaires… dans la Sologne… Il lui faut la solitude, il faut ce voyage dans le “Domaine perdu”, mais tout cela est menacé, rongé partout sur les bords. Le “Domaine perdu”, on va s’apercevoir rapidement de ce que c’est : c’est un manoir agonisant. Alain-Fournier s’efforce d’ailleurs, quand il peut, d’éliminer les éléments trop modernes qui pourraient mettr en fuite le reste du merveilleux. Par exemple, il y a une gare, un chemin de fer… mais on n’en parle qu’à peine, les grands-parents arrivent “par la gare”, mais on va les chercher en carriole, dans Le Grand Meaulnes. Il n’y a pas d’automobile… Le merveilleux a besoin d’être protégé, mis en conserve. » (277-278)
Donc résumons, Gracq apprécie certaines notations du GM son gisement poétique mais il pense également que la seconde partie souffre « d’un romanesque fabriqué ». Chacun se fera son idée, surtout la nouvelle famille de hyènes sous oxygénées mais je maintiens ce que je disais. Gracq juge sévèrement le Grand Meaulnes.
Et Paimpopol de « littérature de pacotille » à romanesque fabriqué » il n’y a pas des kilometres. On est en tout cas très loin de l’adoration éperdue à laquelle vous croyez.
@l’agité du bocal qui s’autorise
On pourrait aussi penser (d’après le dernier entretien cité) que cette « fabrication du romanesque » jugée regrettable sur le plan artistique (dans l’absolu), ce qui ne signifie pas non plus qu’elle gâche complètement le livre, a été en quelque sorte « nécessitée » par l’époque
peu favorable au merveilleux.
Devant cette même impossibilité, le surréalisme « orthodoxe » garde le merveilleux mais laisse tomber le roman.
(Audiberti, lui, parviendra à concilier les deux, sans « fabrication » mais il y aura un coût, mentionné par Paulhan dans leur correspondance : ses romans sont toujours « cassés en deux », changent de ton, de forme en cours de route, ce qui décontenance pas mal de lecteurs.)
Il n’y a rien de « personnel » à estimer qu’il y a une différence entre littérature de pacotille et « romanesque fabriqué », plus nuancé et à nuancer encore plus à la lecture, puisqu’il s’agit d’un entretien, qu’il y a (et pas seulement à propos du Grand Meaulnes) des désaccords entre les vues de Carrière (plus outrées) et celles de Gracq, qui reformule, précise sa pensée en la différenciant de celle qu’on lui attribue (sans traiter son interlocuteur de crétin). L’interprétation doit tenir compte du genre « entretien », et ne pas faire du « fabriqué » l’alpha et l’omega du jugement de Gracq sur Le Grand Meaulnes.
Sinon comment expliquer qu’il y revienne si souvent ?
C’est Carrière qui évoque les gros sous, mais le « fabriqué » n’a pas forcément pour Gracq le sens de « produit de l’industrie culturelle », inauthentique (si on peut encore employer le terme), qui serait, lui, une condamnation sans appel.
Or « pacotille » est une des traductions françaises du Kitsch selon Broch. C’est en cela aussi que le terme n’est pas anodin.
Pour parler par images : il y aurait d’un côté (si l’on tient compte de l’entretien avec Dekiss) du fabriqué/bricolé de manière artisanale, pour répondre à un manque (certes sans inventer une nouvelle forme pleinement artistique), « fabriqué » mentionné dans la nostalgie de ce qui aurait pu être, de ce que l’on entraperçoit (sans pour autant se duper sur le résultat).
Et d’un autre côté, un « fabriqué » cynique, purement commercial que Gracq a toujours combattu.
Souligner la différence de « pacotille » à un jugement plus nuancé ce n’est pas s’attaquer à la personne qui a employé le mot « pacotille », mais simplement veiller à ce qu’un roman (qu’il ne s’agit pas de prétendre parfait, envers et contre Gracq) ne passe pas d’une catégorie à l’autre.
Tout le monde n’est pas uniquement préoccupé par les règlements de compte aux dépens des œuvres, littéraires ou critiques.
Jeudi 10 septembre 2020, 5h47
Quoi !!! J’apprend que le Grand Meaulnes serait une petite bistrouquette respectueuse des dames ??? Je gracque, je gracque ….on nous cache tout !
Année LvB, Flohlied op. 75 N 3 :
10.9 — 6.03
Le match promettait d’être grandiose.
Ils viennent se disputer le titre de poids lourd dans la catégorie superficiels.
Entrés sur le ring avec Meaulnes, des lettrines de J. Gracq, et la chartreuse de Stendhal, ils se sont jaugés.
D’un coup de menton a son coéquipier, celui qui a le cerveau qui déborde , l’ huissier en string, s’est approché dangereusement du maillon faible venu beyler, et lui murmuré:
» Là où je suis, je manque de documentation », interrompant la lutte.
La reprise aura peut-être lieu, pour notre plus grand plaisir: Qui de Gracq ou de Meaulnes.
aura peut-être lieu, pour notre plus grand plaisir
Euh.
Je trouve triste cette bataille des Gaux.
Vous m bcp mieux ailleurs.
Perec Boris Vian etc se saluaient en se touchant le coude. Je recherche.
Jibé
Merci d’écrire que vous voyez parfaitement ce que je veux dire.
Sans doute que le romantisme est désanchanté.
En attendant, qu’ils reviennent avec du biscuit:
Un grand sensuel:
http://volkovitch.com/rub_langue.asp?a=pe146
Forever young , lol.
Donc, au Musée d’Orsey on peut tomber sur L’origine du monde, mais on ne peut pas entrer si le personnel juge un décolleté trop osé — bien que, si je me tiens à la photo, celui incriminé n’avait rien qui puisse réellement déranger —. Apparement ces personnels n’arrivent même pas à articuler le mot « sein », substitué par un simple « ça ».
Zizix est vraiment la tête de veau type. Qui a parlé de « règlements de comptes »? C’est parce que je me suis beaucoup intéressé à Gracq et à Alain-Fournier que j’ai gardé le souvenir des fortes réserves du premier sur le livre du second, chacun devenant un repère vis-à-vis de l’autre.
Réserves que personne ici ne connaissait, pas même le matador Paimpopol, prix Goncourt de pacotille et romancier artificiel, qui croit encore que les apparences de la passion tiennent lieu de tout, -et encore moins, évidemment, la petite bande de hyènes incultes gorgées de navet. Quant à son string, que l’Assasseure se le mette sur le nez en restant bien couverte par ailleurs: assez d’horreurs nous avons vu.
Vous cherchiez ces Dahlias, rose ?
Pour en terminer. Le point de vue de Gracq sur Alain-Fournier est aujourd’hui assez dépassé, ce dont personne ici ne semble avoir conscience. Ce qui fait en grande partie la valeur du Grand Meaulnes c’est la persistance de ses enigmes.
Dialogue complètement impossible avec de pauvres gens qui se precipitent sur ce qu’on veut leur faire acheter, et n’accumulent ainsi qu’une culture de pacotille, résolument artificielle,les laissant totalement démunis s’il leur faut réfléchir. Et qui s’imaginent que résumant un roman on en a tout dit.
Cette histoire de Panthéon pour Rimbaud et Verlaine est à la fois ridicule et odieuse. Qu’on les laisse en paix.
Aujourd’hui, Jeûne genevois.
t les zobs secs, en effet
c’est lui le type qui fait « les enterrements » de ses copains et boit cul sec !
bonne journée (il pleut)
L’Assasseure n’a pas « le cerveau qui déborde », c’est le moins qu’on puisse dire: un neurone de moins et elle n’était pas viable.



1449
commentaires