
Le problème avec Morand
 Poète, chroniqueur, essayiste, nouvelliste, romancier mémorialiste. M. Paul Morand aura été sollicité tour à tour par tous les genres littéraires, ou presque, mais en fin de compte, c’est dans la nouvelle, me semble-t-il, que ses dons ont trouvé et trouvent encore leur meilleur emploi. Peut-être lui-même n’en juge-t-il pas autrement. En tout cas, après les nouvelles de La Folle amoureuse publiées l’an dernier, c’est encore un recueil de nouvelles qu’il nous propose aujourd’hui sous le titre de Fin de siècle.
Poète, chroniqueur, essayiste, nouvelliste, romancier mémorialiste. M. Paul Morand aura été sollicité tour à tour par tous les genres littéraires, ou presque, mais en fin de compte, c’est dans la nouvelle, me semble-t-il, que ses dons ont trouvé et trouvent encore leur meilleur emploi. Peut-être lui-même n’en juge-t-il pas autrement. En tout cas, après les nouvelles de La Folle amoureuse publiées l’an dernier, c’est encore un recueil de nouvelles qu’il nous propose aujourd’hui sous le titre de Fin de siècle.
Fin de siècle ! L’expression avait fait fureur au temps de Félix Faure et de Loubet. On en avait assaisonné toutes sortes de sauces. Elle avait servi d’enseigne à un périodique empli d’images galantes et d’histoires déshabillées signées de noms à particule : Henri d’Argis, Marc de Montifaud, Victorien du Saussay. Comme le rappelle une « notice des éditeurs » de M. Morand, fin de siècle, il y a cinquante-sept ans, était « synonyme d’audace morale, de dernier cri éthique, de préjugés bousculés et chancelants ». Bientôt, ajoute le même texte, « nos descendants de l’an 2000 iront repêcher ce terme, aujourd’hui désuet, et qui avait disparu par une trappe en forme de bouche de métro, avant que l’auteur aille l’exhumer ». Mais est-ce bien aux éditeurs de M. Morand qu’il convient d’attribuer la notice que je viens de citer ? On croirait volontiers que M. Morand y a mis la main. Elle a son style rapide et miroitant, et par surcroît elle reflète les curiosités de moraliste qu’il a toujours eues, et le pessimisme décidé qui perçait sous l’humour des premières Nuits. L’univers que Baudelaire avait vu lézardé et semé de gouffres n’a jamais paru beaucoup plus sûr à M. Morand. Encore Baudelaire croyait-il pouvoir chercher refuge du côté du ciel. Rien que la terre, dit, au contraire, M. Morand ; rien qu’une planète menacée où nous n’aurons même pas l’honneur de voir des gouffres s’ouvrir devant nous. Ce n’est pas dans des gouffres mais dans des nappes que nous serons précipités, dans des trappes en forme de fours, ou de blockhaus, si ce n’est plus en forme de bouches de métro. A la trappe ! à la trappe ! disait Père Ubu qui ne nous aura pas menti.
Mais peut-être marqué-je trop le pessimisme de M. Morand. Ses plus noirs écrits évitent le noir. Les désolantes certitudes dont il est pénétré, il les exprime à peine ; il se contente de nous les laisser deviner. Il s’en distrait ou tente de s’en distraire par un incessant va-et-vient, d’un pays à l’autre, d’un spectacle à l’autre, comme un reporter de qui son journal attend constamment de l’inédit. Reporter ? Pourquoi M. Morand ne l’a-t-il pas été, au lieu de s’égarer dans la carrière, comme tant de fils de famille dont tout le talent est d’avoir un bon tailleur ? Ses qualités étaient et son encore celles d’un voyageur et d’un caricaturiste. Insuffisantes pour faire de lui un romancier, elles lui ont été en revanche d’un précieux secours dans l’art de la nouvelle. La promptitude du  reporter, le raccourci qu’exige la caricature se rencontraient déjà dans Ouvert la nuit, qui date de 1922. On les rencontre encore dans Fin de siècle, car en dépit des années, M. Morand n’a rien perdu de sa vivacité d’allure et d’écriture. Aussi ne se sent-il pas moins à l’aise qu’autrefois dans la nouvelle, dont Baudelaire sait qu’elle a « sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que la brièveté ajoute à l’intensité de l’effet ». Baudelaire, il est vrai, prêchait un peu pour sa paroisse en soulignant « cet immense avantage ». Il se savait incapable de venir à bout du moindre roman, alors qu’il avait de bonne heure fait ses preuves de nouvelliste avec sa Fanfarlo. M. Morand, lui, a eu beau produire plusieurs romans, c’est toujours dans les nouvelles que se sont le mieux manifestés ses dons de narrateur, et surtout dans les nouvelles où le reporter et le caricaturiste que j’ai dits ont eu à évoquer des personnages qu’il avait vu de ses yeux ou des évènements auxquels il avait assisté.
reporter, le raccourci qu’exige la caricature se rencontraient déjà dans Ouvert la nuit, qui date de 1922. On les rencontre encore dans Fin de siècle, car en dépit des années, M. Morand n’a rien perdu de sa vivacité d’allure et d’écriture. Aussi ne se sent-il pas moins à l’aise qu’autrefois dans la nouvelle, dont Baudelaire sait qu’elle a « sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que la brièveté ajoute à l’intensité de l’effet ». Baudelaire, il est vrai, prêchait un peu pour sa paroisse en soulignant « cet immense avantage ». Il se savait incapable de venir à bout du moindre roman, alors qu’il avait de bonne heure fait ses preuves de nouvelliste avec sa Fanfarlo. M. Morand, lui, a eu beau produire plusieurs romans, c’est toujours dans les nouvelles que se sont le mieux manifestés ses dons de narrateur, et surtout dans les nouvelles où le reporter et le caricaturiste que j’ai dits ont eu à évoquer des personnages qu’il avait vu de ses yeux ou des évènements auxquels il avait assisté.
Son recueil de l’an passé offrait précisément le défaut de comporter trop de morceaux écrits de chic et où la fabrication se faisait sentir. Fin de siècle vaut beaucoup mieux, encore que l’anecdote qui sert de prétexte à la nouvelle où est raconté l’incendie du Bazar de la Charité soit de ces histoires d’adultère, très 1900 peut-être, mais qu’un auteur plus exigeant eût néanmoins abandonnées aux fournisseurs habituels de « la presse du cœur ». Mais mon intention n’est pas de chercher querelle à M. Morand sur le choix de ses intrigues. Je serais ingrat si j’affectais de bouder des récits dont la verve et la malice m’ont diverti. Veut-on des exemples de cette verve ? De la vieille impératrice de Chine déguerpissant de son palais à l’heure où les choses vont se gâter pour elle, M. Morand écrit : « Ainsi se termine un règne d’amour étouffées et de gâteaux à l’arsenic ». Des rues de Pékin ensanglantées par la guerre des Boxers, il dira que l’odeur des cadavres non ensevelis y aggravait l’odeur habituelle de la Chine, celle de cabinets bouchés ». Mais laisson le Céleste Empire à ses odeurs obstinées. Nous voici non loin du rond-point des Champs-Elysées, écoutant, à table, un de ces personnages vieille France dont les ridicules ravissent M. Morand :
« Aux œufs brouillés qui faisaient dans son assiette, disait ce gastronome artiste, un soleil d’or auréolé de tomates, ont succédé des côtelettes à la Louis XVIII enfoncées dans une purée de pois frais ; ce sont (expliquait-il) des côtelettes liées par trois dont celle du milieu seule est destinée à être mangée, les deux autres ne servant qu’à la protéger des ardeurs de la grillade et à lui donner leur jus. »
Peut-être ces détails se heurteront-ils à l’indifférence des jeunes gens qui n’ont pas, comme M.Morand, respiré l’atmosphère « fin de siècle » mais du moins ne laisseront-ils pas insensibles les lecteurs dont l’enfance s’est penchée sur les images où le Petit Journal illustré montrait, en couleurs, les merveilles de l’exposition, les supplices chinois ou les belles dames changées en torches dans l’atroce kermesse de la rue Jean-Goujon.
Des quatre nouvelles rassemblées dans Fin de siècle, ce n’est pourtant pas aux plus bariolées qu’iront mes préférences, mais bien à Feu Monsieur le duc, dont le décor se fait aisément oublier au profit du personnage qui s’y ébroue et qui y meurt après avoir pris soin de disperser une série de testaments et de codicilles contradictoires, conçus de façon à brouiller tous les siens. Devant ce duc d’Orgon, richissime excentrique, « indépendant de tout et de tous, sauf de la lune et de ses influences », on peut se demander, une fois de plus, s’il n’eût pas suffi d’un peu de discipline et d’application au peintre de mœurs que sait être M. Morand, pour devenir une sorte de La Bruyère plus acide que le Théophraste du grand siècle. M. Morand excelle en effet à saisir les traits de caractère. Peu importe, après tout, que son penchant à la caricature lui fasse quelque peu grossir ou déformer les traits. La satire et les exagérations qu’elle implique n’ont jamais été interdites aux moralistes. Imaginerait-on Lucien se privant d’y recourir dans ses Dialogues ou dans son Peregrinas, grâce auxquels ont survécu tant d’extravagants, de jouisseurs, de sophistes et de demoiselles aux talons courts d’il y a dix-sept cents ans ?
Pour ma part, je ne puis que regretter que M. Morand n’attache pas plus de prix à l’art qu’à l’artifice et qu’il néglige souvent le portrait pour le tableau à effet. Chacune de ses nouvelles a son « clou », comme le Salon de la belle époque ou comme la revue des Folies-Bergère : un bal masqué à l’ambassade russe de Vienne, l’attaque des légations européennes de Pékin par des bandits chinois, les nuages de fumée bleue ou jaune roulant au-dessus du bazar en feu. Comme tous les livres de M. Morand, Fin de siècle est riche, très riche, trop riche en morceaux de bravoure, en chromo-lithographies éclatantes et vernissées, mais qui ne tarderont pas à se ternir. Il est possible que ce soit sur ces tableaux-là qu’on compte aujourd’hui pour se concilier les applaudissements, mais ce sera peut-être à cause d’eux que l’an 2000, sans y regarder de plus près, confondra son œuvre avec celle de Jean Lorrain.
(Article sans titre originellement publié dans Carrefour, le 3 avril 1957 – le titre est de la RDL)
Chroniques littéraires (1954-1977)
530 pages, 50 euros
Du Lérot, éditeur
Tusson, Charente, 2012
9 Réponses pour Le problème avec Morand
…
…Fin de siècle,…Paul Morand
…Chroniques littéraires,…Pascal Pia
…
…pour ma tasse de café et mes biscuits,…
…etc,…
Vacharde, la critique au bout du compte mais rudement bien nuancée ! Ça donne envie de relire Morand.
« On en avait assaisonné toutes sortes de sauces »
..assaisonner un plat !
Faut-il comprendre que Du Lérot réédite l’ancien volume paru naguère chez Nadeau? En tous cas, plaisir de retrouver ici Pia qu’on évoquait avec CP l’autre jour.
Bien à vous.
MC
En rétrospective Morand est un snob français assez typique avec ses (auto-)caricatures qui sont rébarbatives pour les non-Français..
« En rétrospective Morand est un snob français assez typique »
C’est tout de même un peu plus que cela
oui vacharde … des compliments sur le style et l’esprit, mais la flèche du Parthe: « des caricatures »…Il est vrai que Morand comme La Bruyère raconte des « types » et non des hommes! En revanche Pascal Pia est lourd et plus snob qu’un snob lorsqu’il raconte au début ses connaissances des périodiques galants 1900 et des auteurs à particules…. Ah Morand !
AOB
Vachard, Passou, décidement bien Vachard!
Et puis, pourquoi ce titre « Le Problème avec Morand » ? On croirait qu’il n’y a que çà: Est ce son milieu (« le fils de famille » ?) son pessimisme (« décidé » ?), ses portraits-charges (« le reporter et le caricaturiste » ?) – ou son talent lui-même ?
On se souviendra peut être un jour de Pia comme d’un critique bibliomane furtif , une sorte de Sachs discret de la fin du XXe siècle et de sa chronique qui voulait faire disparaitre Morand ni « dans les trappes en forme de fours » ni dans « les blockhaus »… mais sous le tapis de Jean Lorrain !
Tout de même, « Morand et ses Chromos lithographies »… Du Pia embirlificoté tout çà !
Chers amis, veillez à respecter l’orthographe des grands auteurs. Pascal Pia n’a assurément pas écrit : « des personnages qu’il avait vu de ses yeux », mais plutôt : « des personnages qu’il avait vuS de ses yeux ». Du reste, la phrase est curieusement bâtie : …« dans les nouvelles où le reporter et le caricaturiste que j’ai dits ont eu à évoquer des personnages qu’il avait vu de ses yeux ou des évènements auxquels il avait assisté. » Le verbe est d’abord au pluriel (« ont eu ») puis au singulier (« avait vu ») ?? Pascal Pia a-t-il vraiment écrit cela ou son éditeur actuel a-t-il mal lu l’article d’origine ? Il y a de quoi s’inquiéter. Mais la phrase réellement écrite par Pascal Pia pourrait bien être la suivante : …« dans les nouvelles où le reporter et le caricaturiste que j’ai diT [au singulier car il s’agit d’un seul et même individu] A eu à évoquer des personnages qu’il avait vuS de ses yeux ou des événements auxquels il avait assisté. » Ne croyez-vous pas ?


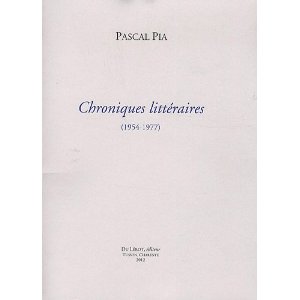
9
commentaires