
Traduire la poésie d’idées de Javed Akhtar
 Javed Akhtar est l’une des voix les plus justes de la poésie ourdoue contemporaine. Elle exprime une sensibilité postmoderne, radicalement différente des autres voix de sa génération. Il habite les deux mondes de la métaphysique et du concret avec la même facilité ; entre eux ni opposition ni hiérarchie. Exemple de l’hétérotopie qu’évoque Michel Foucault, sa poésie est une invitation à découvrir d’autres mondes encore, des lieux qui permettent de contester, des lieux de doute, de clair-obscur, d’autres mondes que ceux qui nous sont familiers. Héritier d’une riche tradition poétique familiale, Javed Akhtar réussit pourtant à trouver un mode d’expression dont le timbre frais séduit l’oreille. Il compose des ghazals et des nazms, formes poétiques traditionnelles, mais les régénère en puisant ses images et ses métaphores dans le monde du XXIe siècle. Ainsi propose-t-il une poésie d’idées, fondée sur une quête du nouveau, une recherche intellectuelle courageuse et consciente.
Javed Akhtar est l’une des voix les plus justes de la poésie ourdoue contemporaine. Elle exprime une sensibilité postmoderne, radicalement différente des autres voix de sa génération. Il habite les deux mondes de la métaphysique et du concret avec la même facilité ; entre eux ni opposition ni hiérarchie. Exemple de l’hétérotopie qu’évoque Michel Foucault, sa poésie est une invitation à découvrir d’autres mondes encore, des lieux qui permettent de contester, des lieux de doute, de clair-obscur, d’autres mondes que ceux qui nous sont familiers. Héritier d’une riche tradition poétique familiale, Javed Akhtar réussit pourtant à trouver un mode d’expression dont le timbre frais séduit l’oreille. Il compose des ghazals et des nazms, formes poétiques traditionnelles, mais les régénère en puisant ses images et ses métaphores dans le monde du XXIe siècle. Ainsi propose-t-il une poésie d’idées, fondée sur une quête du nouveau, une recherche intellectuelle courageuse et consciente.
L’émotion y a toute sa place, mais elle n’est ni envahissante ni tapageuse – toujours en demi-teintes, elle couve sous les cendres du non-dit, allusive, évanescente. Les nazms de Javed Akhtar sont avant tout le fruit d’une recherche minutieuse dans laquelle le lecteur est entraîné : on y suit sa pensée persistante alors qu’elle explore tous les recoins d’une idée ; sa démarche est calme, sa logique implacable, il raisonne avec une précision presque mathématique, n’hésitant pas à multiplier les questions : « Qu’est-ce que le temps ? », « Qu’est-ce que ce jeu ? ». Ces questions n’appellent pas nécessairement de réponse, elles nous invitent à réfléchir comme dans le poème « Langue »:
« Une pensée/ une émotion n’importe laquelle/ une chose n’importe laquelle/ Qui sait/ Tout d’abord a-t-elle reçu une voix/ ou a-t-elle été dessinée/ Je me le demande »
Aux métaphores et images usées jusqu’à la trame par différentes traditions poétiques, Javed Akhtar insuffle une nouvelle vigueur : la larme, allégorie de la peine, devient une goutte d’eau qui, chemin faisant entre le coeur et les cils, se perd.
« S’accrochant au doigt d’un récit/ faisant un mouchoir de sa peine/ posant de fausses vraies questions/ à son sujet/ elle est venue jusqu’à mes cils ».
Le topos du Temps, qui a hanté Baudelaire et Villon, ne le laisse pas indifférent non plus, mais il situe ses compositions dans le cadre d’une quête rigoureusement scientifique : grâce à lui, trous noirs, comètes incandescentes, galaxies, années lumière entrent pour la première fois dans les annales de la poésie ourdoue. Le poète est mû par une insatiable curiosité qui le pousse à explorer les limites de ce monde tangible. « Univers » communique ainsi la stupéfaction de l’homme face au cosmos :
« Depuis des siècles je contemple/cet univers et son immensité/ Quel étonnement quel étonnement »
Chaque métaphore, chaque idée, chaque détail est soumis à l’épreuve du feu de la raison. Il n’y a ni sujets tabous ni héros intouchables. Dans « Mère Teresa », Javed Akhtar s’interroge et interroge : il s’adresse à cette sainte de Kolkata avec une série de « pourquoi ? » sans pour autant chercher la provocation et la remise en cause.
« Pourquoi n’as-tu jamais voulu/ que les enfants nus/ les vieux lépreux/ les hommes sans ressources/ à ce monde/ réclament leur droit de vivre/ et non pas l’aumône de vivre ».
D’un ton hésitant, Javed Akhtar aborde les problèmes sociaux et parle de la misère en termes inattendus ici, mais il n’a pas de réponse toute faite à proposer ; il n’est pas polémiste, mais poète et sa poésie a pour objet de véhiculer le doute, sous toutes les facettes que présente le monde dans lequel il vit. De plus, il assume cette parole libérée :
« Car si je te pose la question/ je devrai assumer ma responsabilité moi aussi/ celle que j’ai réussi à esquiver jusqu’ici. »
Javed Akhtar n’est pas un simple poète, il est aussi un poète philosophe dans la tradition des philosophes du siècle des Lumières : c’est la société dans laquelle il vit, l’homme moyen, l’ici et le maintenant qui l’interpellent, captent son attention et son intérêt. Le poème « Bidonville », dont le titre se réfère à une réalité douloureuse du paysage urbain de Mumbai, rend hommage à ceux qui travaillent pour le paradis des autres et reviennent à leur enfer le soir :
« Il semble que/ tout le bidonville/ est un abcès douloureux/ Il semble que/ tout le bidonville/ est un chaudron brûlant/ Il semble que/ le Bon Dieu assis au coin de la rue/ vend des hommes brisés en morceaux/ pour trois fois rien. »
Javed Akhtar, l’athée, prend aussi fermement position contre la religion. L’idée de l’au-delà, d’un dieu juste et protecteur lui semble absurde ; pour lui, la religion divise et sème la discorde. Dans le poème « Avant l’émeute », le poète décrit une ville sur le qui-vive, effrayée par son ombre même, et conclut :
« Regarde l’almanach/ J’ai l’impression/ que c’est un jour de fête, peut-être »
La foi aveugle va à l’encontre du progrès, elle assujettit. Dans le poème « A/Dieu », il nous rappelle qu’autrefois tout était attribué à Dieu – les cycles de la nature comme les cataclysmes et il interpelle Dieu, presque pour le provoquer, car sa religion à lui, c’est l’intelligence, sa foi, c’est la science :
« Tu es là/ où il y a cette conscience/ de ce qui se cache derrière ce rideau de la mort/ Restes-y encore quelques jours/ mais que je te dise/ J’y viendrai »
Son originalité vient aussi de sa capacité rare à revisiter des lieux communs pour les animer d’une vie nouvelle. Dans le poème « Une liane autour de l’arbre », le topos est proche de celui de la fable Le chêne et le roseau de La Fontaine, mais la liane du poème d’Akhtar réussit à sauver l’arbre en nouant les branches, en soutenant l’arbre dans ses bras. Cependant, toute la poésie de Javed Akhtar n’est pas seulement la quête du nouveau. Les souvenirs d’une enfance heureuse, sécurisée, inspirent des poèmes d’où émane une chaleur réconfortante, comme celle que communique la figure maternelle aimante qui nourrit son enfant,
« Une bouchée pour l’éléphant/ Une bouchée pour le cheval/ Une bouchée pour l’ours »
ou qui le cache dans le pan de son sari pour le gronder avec amour. Ailleurs, c’est la maison de l’enfance qu’il regrette :
« La maison où j’habite à présent/ est très belle/ mais souvent assis silencieux je me souviens/ que l’autre pièce me parlait. »
Les vers de Javed Akhtar sont courts et denses et ils parviennent, grâce à cette écriture dépouillée à exploiter chaque idée dans les moindres recoins, à en sonder les profondeurs, à en repousser les limites, sans jamais être bavards. Or cette gymnastique intellectuelle n’est pas une méditation solitaire, car Javed Akhtar ne cesse jamais de converser avec le lecteur, de l’entraîner dans les méandres de sa pensée. La poésie reste pour lui un dialogue, un contact chéri, un rapport privilégié.
Héritier de la tradition des écrivains du Progressive Writers’ Movement, Javed Akhtar garde une certaine nostalgie de poètes révolutionnaires qui ont voulu changer le monde. Par exemple, le poème intitulé « C’était un homme singulier » rend hommage à Kaifi Azmi, son beau-père, qui était un des piliers de ce mouvement. Mais si Akhtar reste un poète engagé qui ne cesse jamais d’élever la voix contre l’exploitation, l’injustice, il n’est pas dupe, il voit que les temps ont changé. Le monde lui apparaît terni : le compromis et la collusion désormais bien établis ont brisé le monde meilleur rêvé par ses prédécesseurs.
Le poète d’aujourd’hui qu’est Javed Akhtar est un réaliste résigné, il sait que sa révolte sera stérile, que son hymne révolutionnaire ne trouvera pas d’écho. S’il faut survivre, comme le protagoniste du poème « Dilemme », il faudra se faire fouler aux pieds par les autres ou les écraser, opprimer ou se faire opprimer. Sur l’échiquier de l’existence, le pion ordinaire devra jouer serré, la solitude sera le prix de sa victoire. Et dans ce jeu, l’amour est transactionnel, car le jeu est une guerre, les promesses de demain sont des mensonges, et toute retraite est impossible. Pourtant, dans cette poésie, ni colère, ni passion, seulement un constat sans amertume qui laisse une place à l’espoir courageux, à la force intelligente.
Qu’en est-il de l’ourdou, la langue de ces poèmes ? C’est une des langues régionales de l’Inde et la langue nationale du Pakistan. Il s’écrit dans l’alphabet arabo-persan et son lexique privilégie les mots d’origine arabo-persane. Pour sa graphie, l’ourdou s’est doté d’un style calligraphique qu’on appelle nastaliq. On n’aurait pas tort de dire que l’ourdou et le hindi, la langue nationale de l’Inde, sont des langues soeurs. Seulement, ces langues ont rapidement été annexées par la voix stridente des nationalistes, et avec la Partition l’ourdou est devenu musulman et le hindi langue des hindous. Alain Désoulières, dans son ouvrage sur la poésie ourdou, compare cette situation à celle qu’a connue l’Europe avec le serbo-croate.
Pour atteindre un plus vaste public, Javed Akhtar a publié ses poèmes dans les deux alphabets, le devanagari qui dérive du sanscrit et l’ourdou. Mis à part les deux systèmes d’alphabets, il n’y a aucune différence entre les deux versions. Après avoir découvert cette poésie originale lors d’une lecture publique, j’ai aussitôt éprouvé le besoin de traduire les poèmes de Javed Akhtar afin de pouvoir partager mon enthousiasme avec des lecteurs francophones. Lorsque j’ai pris la décision de me lancer dans ce projet de traduction avec la précieuse collaboration du Professeur Christine Raguet de la Sorbonne Nouvelle, quelques stratégies de traduction se sont rapidement imposées, notamment celle de respecter la richesse sonore de cette poésie, sa musicalité si particulière. Pour ce faire, il fallait en privilégier les rythmes et les harmonies et donc soumettre nos traductions à l’épreuve du gueuloir si cher à Flaubert. Cependant nous étions conscientes que toute traduction est une interprétation et qu’il n’existe pas de traduction parfaite. Ce qui comptait pour nous avant tout, c’était de susciter des émotions, de transmettre des vibrations, car comme le disait si bien Arun Kolhatkar, poète et traducteur,
« traduire un poème c’est comme faire l’amour / avoir une liaison… faire l’amour avec un poème / avec le corps d’une autre langue ».
La langue ourdoue n’a pas de majuscules et n’a pas de système de ponctuation. Comme la poésie ourdoue est faite pour être récitée, le changement de ton, le timbre de la voix, le souffle, tout concourt à laisser l’auditoire construire le sens. Et la construction du sens en poésie est une entreprise individuelle qui se fait à partir de sons et de sensations, de silence et de bruit. Frances Pritchett fait remarquer à juste titre que le ghazal classique n’avait pas de marques de ponctuation, ce qui lui permettait de garder sa polyphonie et jouer sur la polysémie, et va jusqu’à qualifier l’ajout de ponctuation occidentale dans la poésie ourdoue comme un barbarisme qui détruit le maani aafriinii lequel, dans l’esthétique poétique ourdoue, permet de multiplier et enrichir le sens.
M. Akhtar lui-même utilise très peu la ponctuation. C’est donc le corps vocal que nous avons cherché à reproduire en utilisant les majuscules comme des repères qui signalent les pauses, les reprises ou les jonctions, et facilitent la respiration. En bref, notre stratégie de traduction était d’évoquer, de suggérer et non pas de fixer un sens ou d’enfermer un mot dans une seule signification.
VIDYA VENCATESAN
(Photos Passou)
Javed Akhtar
D’autres mondes (poésie)
Traduit de l’ourdou (Inde) par Vidya Vencatesan (avec la collaboration de Christine Raguet)
Préface de Marcel Bénabou
293 pages, 20 euros
Les éditions de Janus
6 Réponses pour Traduire la poésie d’idées de Javed Akhtar
Que dire?
Mon ami Ali, pakistanais mais athée, se désole de ce qu’est devenu le Punjab, ancienne culture rendue anémique par les mahométans.
«La langue ourdoue n’a pas de majuscules et n’a pas de système de ponctuation. Comme la poésie ourdoue est faite pour être récitée, le changement de ton, le timbre de la voix, le souffle, tout concourt à laisser l’auditoire construire le sens.»
Toute poésie n’est elle point faite pour être lue à voix haute?
Allez, on passe au suivant…
J’aime beaucoup ce que vous faites, Bihoreau, continuez.
Raoul, voilà un prénom qui sent bon la terre de France ! Continuez vous aussi, avec Enguerrand et Thierry.



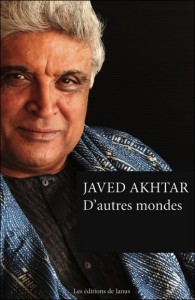
6
commentaires