
La vacance de monsieur Bloom
par Dominique Nédellec
 On connaissait le Gonçalo M. Tavares sémillant agent immobilier, avec un portefeuille clients bien fourni : monsieur Valéry, monsieur Brecht, monsieur Kraus, monsieur Calvino, monsieur Walser… Il les a tous logés dans le Bairro, un quartier de papier en pleine expansion où l’on annonce la venue prochaine de sympathiques voisins : Mme Woolf, M. Breton… Un nouveau recensement est en cours.
On connaissait le Gonçalo M. Tavares sémillant agent immobilier, avec un portefeuille clients bien fourni : monsieur Valéry, monsieur Brecht, monsieur Kraus, monsieur Calvino, monsieur Walser… Il les a tous logés dans le Bairro, un quartier de papier en pleine expansion où l’on annonce la venue prochaine de sympathiques voisins : Mme Woolf, M. Breton… Un nouveau recensement est en cours.
On connaissait le Gonçalo M. Tavares plus grimaçant de Jérusalem et Apprendre à prier à l’ère de la technique, deux romans sombres et boueux, dont les décors auraient pu être signés Otto Dix ou George Grosz.
Cette fois, Tavares nous propose ni plus ni moins qu’une épopée en vers sur cinq cents pages. En toute simplicité. Le culot et l’ambition n’ont jamais fait défaut à Gonçalo. Mais là, il pousse le bouchon assez loin… Jusqu’en Inde, pour être précis, par l’entremise de son héros désolé, Bloom, le parricide, qui cherche une femme, ou la sagesse.
J’ai fait l’aller et retour, moi aussi : cinq mois de voyage immobile pour traduire une odyssée en dix chants et mille cent deux stances (sans oublier l’indispensable postface d’Eduardo Lourenço). Un voyage en Inde : un livre curieux, cocasse, dans lequel la métaphysique trébuche sur le burlesque, le politique grimpe sur les épaules du poétique.
Maintenant qu’il a paru, je prends le temps de ranger mon atelier (a-t-on jamais vu un traducteur se présenter comme un capitaine d’industrie ? Il a trop de plaisir à se déguiser en artisan) : mon établi poussiéreux, mes brodequins coqués (qui me protègent des chutes de briques), ma panoplie d’outils : rabot, chignole, varlope, dynamite… Partout de la sciure, des copeaux, des mèches, des clous tordus. Voyons si, comme les glaneurs et la glaneuse, on arrive à trouver dans ce farrago deux ou trois choses bonnes à garder.
Faux départ
Avant même d’avoir ouvert le livre, les ennuis commencent. Le titre original : Uma viagem à Índia. Alors ? Un voyage en Inde ou Un voyage aux Indes ? « Aux Indes », c’est beau, ça scintille comme un feu de Bengale, c’est somptueux comme un palais du Rajasthan, on voit d’ici l’éléphant sacré, les marchands de Venise en partance, leurs cassettes remplies de sequins (tiens, « sequins », trouvé chez Pierre Michon), c’est la Route des Indes, la Malle des Indes… Stop ! Justement, trop séduisant pour être honnête. Bloom cherche sa voie dans la morosité du xxie siècle. Son périple, il l’entreprend à l’heure du désenchantement globalisé. Non, Bloom ne part pas aux Indes, il part en Inde. « En Inde », c’est neutre, c’est plat comme un iPhone, insipide comme le plateau-repas qu’apporte l’hôtesse de l’air. Passer « des Indes » à « l’Inde », c’est déjà faire l’expérience de la désillusion, de la mélancolie : fini, les fastes d’antan, les épices, la sphère armillaire, les embruns. Maintenant, c’est l’Inde, Bhopal, monsieur Mittal. Où l’on voit que, dès le titre, le traducteur aurait pu faire fausse route…
Les citations (plus ou moins) clandestines
Certaines citations, traduites et retraduites, plus ou moins travesties par l’auteur, sont là presque incognito. Le but du jeu est de les débusquer et de décider de leur sort (le cas échéant : leur redonner leur tenue d’origine). Parfois, Tavares, grand seigneur, met des guillemets. Chant V, stance 137 : É verdade que « um baixo amor os fortes enfraquece ». D’où peut bien venir cette sentence, aux inversions un peu surannées ? On sait qu’Un voyage en Inde emprunte aux Lusiades de Camões son squelette. Quelques lambeaux de chair ne seraient-ils pas restés accrochés ? Vérifions. Même chant, même stance ? Raté. Mais deux stances plus loin (facétie de GMT), on retrouve : « Car il semble bien qu’une vile passion affaiblit les plus forts » (dans la traduction de Roger Bismut, chez Bouquins). Tavares adresse ainsi trois ou quatre clins d’œil explicites au grand poète borgne. Précisons au passage que, contrairement à son modèle ici revisité, Un voyage en Inde est écrit en vers non rimés et sans métrique contraignante, ce qui est évidemment une énorme épine retirée du pied délicat du traducteur : pas de carcan particulier, si ce n’est une certaine brièveté, d’une part pour éviter autant que possible les retours à la ligne (il en reste tout de même dans la version française, ce qui est un peu dommage pour l’œil) et d’autre part pour que les apophtegmes de Tavares conservent toute leur force de frappe.
Quand on cale, on peut toujours interroger l’auteur. Si les morts sont plutôt taiseux, les vivants sont pour la plupart disposés à collaborer. Quand j’ai lu : « les solides se sont toujours dissous dans l’air, comme disait un vieux monsieur » (chant III, stance 72), je n’ai pas immédiatement pensé à Marx. J’aurais dû. Mon sur-moi réactionnaire avait fait barrage à cette phrase tirée du Manifeste du parti communiste : « tout ce qui est solide se dissout dans l’air ».
Chant IV, stance 92, j’aggrave mon cas : je ne reconnais pas plus le « poète français » qui s’y promène que le « vieux monsieur » précité. « [Les hommes] ne savent être doux, comme disait le poète français, que lorsqu’ils sont suffisamment forts, réduisant ainsi la délicatesse à la première partie d’une négociation. » Le mot « doux » est là pour traduire le portugais doces et le mot « forts » pour traduire fortes. Rien d’extraordinaire, donc. Mais, même pour ces deux termes anodins, il me déplaisait de m’en remettre au hasard : pour la beauté du geste, je tenais à découvrir l’identité du poète masqué et à m’assurer qu’il avait bien utilisé ces mots-là. Gonçalo, un indice ? C’est Rimbaud, mais je n’ai pas la citation exacte, me répond-il. Un peu de recherche motorisée : « Parce qu’il était fort, l’Homme était chaste et doux », dans « Soleil et chair ». C’est bien « fort » et « doux », je peux passer à la suite la conscience tranquille.
Petits arrangements avec les mots
Traduire, c’est souvent couper les cheveux en quatre, tergiverser, se prendre les pieds dans le tapis, jeter le tapis, changer de main. « Les limites, les pièges, les impossibilités me sont indispensables, je pars chaque jour à leur rencontre. » La citation n’est pas extraite des mémoires d’un traducteur émérite, mais du Traité du funambulisme, de Philippe Petit, le « Magicien de Haut Vol » (la joyeuse promenade entre les deux tours du World Trade Center en 1974, c’est lui). Le traducteur, qui tend son fil entre deux langues, aime bien chercher les ennuis, lui aussi, c’est son plaisir quotidien, ce qui lui vaut d’appartenir à la famille des danseurs de corde et des voltigeurs. Traduire, c’est glisser, ruser, biaiser. C’est dépêcher des émissaires qui vont et viennent entre les deux langues, transiger, parlementer avec la phrase, les mots, négocier sur la ligne de démarcation, sous l’œil noir des soldats des deux bords.
Le terme convés, en portugais, désigne le pont d’un navire. Seulement, Tavares, de manière inattendue, accole ce terme à un édifice : « le pont d’un immeuble ». Le lecteur francophone a toutes les chances de passer à côté de l’image maritime (il risque même de ne rien comprendre du tout). Il faut donc congédier ce « pont » et lui trouver un remplaçant. Une doublure qui ait le pied marin et fasse tout de suite surgir des histoires de vaisseaux, de dunettes et de gaillards. Pourquoi pas « tillac » ? Avec un mot pareil, pas moyen de rater l’allusion et on a le même degré de surprise qu’en portugais. Ça donne, chant IX, stance 25 : « Des hôtesses sur le tillac d’un immeuble organisent des déjeuners malicieux dans le dos d’épouses ingénues. Des maris adultères mâchonnent dans la ville agitée des filles qui ne veulent rien d’autre qu’un emploi stable. »
En matière de traduction, Gonçalo M. Tavares n’est pas un auteur interventionniste. Il est généralement laconique dans ses réponses à mes demandes d’éclaircissements (il veille toujours à ne pas cloisonner le sens de ce qu’il a écrit) et, lorsque je sollicite son avis sur telle ou telle option, il me laisse le plus souvent trancher, ce qui est une belle marque de confiance. Par exemple, en route vers l’Inde, Bloom fait escale dans la capitale française, qu’il tient en haute estime. Dès son arrivée, une évidence le frappe : « ça sent la métaphysique de tous les côtés. » Il est charmé. « Ah, Paris ! Dans aucune autre ville on ne se trouve plus près de Paris qu’à Paris. D’où sa grandeur. » Lorsqu’il se met à pleuvoir, Bloom, qui à Paris ressemble beaucoup à Buster Keaton, se réfugie sous la « petite banne d’une boutique qui vend des chaussettes pour les pieds » et se retrouve ainsi, por imposição meteorológica, « par injonction météorologique », aux côtés de Jean M, avec qui il se lie d’amitié. Les deux hommes échangent tantôt en se tutoyant, tantôt en se vouvoyant. De la même manière, on saute souvent du passé simple au présent, et vice versa, dans le déroulement du récit. Faut-il harmoniser ? Personnellement, je préfère ne pas. Quand cet apparent désordre participe de l’ambiance générale, je ne vais pas jouer au garde-chiourme. Le traducteur n’est pas là pour redresser tous les coups tordus ni pour faire marcher droit la phrase débraillée. Un voyage en Inde peut parfois dérouter, mais il ne me revient pas de baliser la piste ni de planter des panneaux indicateurs. Si, comme il est dit au chant VIII, « nous sommes inséparables du pire » (on croirait du Cioran), il serait regrettable qu’on ait le sentiment de rouler sur les routes du paradis en français là où l’enfer faisait fondre les pneus en portugais.
Rats immondes et ronds de jambe
Le traducteur étant schizophrène comme tout le monde, il ne peut pas non plus tout tolérer les bras croisés. Par moments, la prise de distance s’impose. Pour rendre o império de um homem modesto não é mais controlável que o império do rei, j’échangerai sans hésiter l’« empire du roi » contre un royaume, que je n’utiliserai d’ailleurs qu’une fois afin d’éviter un disgracieux royaume-royaume-roi : « le royaume d’un homme modeste n’est pas plus contrôlable que celui du roi ».
Au chant V, il est question du Moyen Âge et de ses epidemias de ratos, littéralement « épidémies de souris » (rat se dit ratazana). La moindre bestiole peut décider de venir ronger les nerfs du traducteur : s’agit-il de maladies transmises par ou plutôt d’une invasion de ? Le genre de questions qu’on est amené à se poser. C’est une odyssée, toute négligence serait punie par les dieux. Lâchement, je demande à Gonçalo de m’en dire plus sur ce pan de l’histoire médiévale. Muitos ratos nojentos, me répond-il, soit en V.F. plein de souris dégoûtantes. Bien. Je commence par les transmuter en rats (on ne peut pas demander à de fragiles souris d’incarner à elles seules les heures sombres du Moyen Âge), des rats qui devront être immondes bien sûr (nojentos), et puisqu’il s’agit d’une épidémie, on pourra dire qu’ils… pullulent. On aura ainsi : « Au Moyen Âge les rats immondes pullulaient… » À la réflexion, j’aurais très bien pu faire l’économie d’immondes (qui était dans son explication, mais pas dans le texte), dont l’idée est presque automatiquement rendue par la simple juxtaposition de « rats » et « pullulaient ». Trop tard. Nota : ici, l’action est vue au ralenti et en plan serré, mais il va de soi que tout traducteur fait ça cinquante fois par page, intuitivement, au grand galop et sans descendre de son cheval toutes les deux secondes.
Dans le roman d’un autre auteur, le personnage prend une chambre dans un hôtel : elle est au troisième étage page 158, au second page 164. Dans une zone non sismique (et c’était bien un hôtel, pas la tour de Pise). Le traducteur, qui doit savoir tout faire, y compris un peu de maçonnerie à l’occasion, rajoute un étage ni vu ni connu (sans pour autant écrire à la truelle).
Dans le fond, le débat est toujours le même. Larbaud, dans Sous l’invocation de saint Jérôme, le résumait parfaitement : que faire pour « éviter, d’une part le mot à mot insipide et infidèle à force de servile fidélité, et d’autre part la traduction ornée ? » Question d’équilibre. Mais le traducteur n’est pas non plus en permanence sous la torture. Il lui arrive aussi d’avoir du bonheur, que diable ! Et des plaisirs simples, comme celui de mettre la main sur « charpie » pour faire entendre le même déchirement que farrapos, sur le sympathique « deviser » pour traduire elaboram sobre o clima (« les hommes devisent sur le climat et citent des auteurs classiques »), ou sur l’expression « ronds de jambes », pour traduire ici cerimónias. Jean M, l’ami de Bloom, tient à le déniaiser un peu et le met en garde sur ce qui l’attend à Paris : « Ne te laisse illusionner ni par les monuments ni par les ronds de jambes. L’esthétique, c’est fini. Il ne reste que l’argent. »
Où as-tu posé le dictionnaire latent ? Dans la bibliothèque neuronale
Car Bloom voyait plutôt Paris comme une ville voluptueuse, où « les éditeurs vivent dans le dénuement afin de permettre aux poètes de posséder une cave et une bibliothèque ». Et que fait le poète pour se mettre en jambe ? Il boit et insulte le bourgeois, mais il mène aussi uma investida erecta dans le bordel principal de la ville. Investida : attaque, assaut. Le dictionnaire Houaiss signale un sens figuré : approche amoureuse ou sexuelle. La tauromachie portugaise aussi connaît l’investida, qui désigne la charge, le moment où le taureau fonce sur sa cible. Erecto : érigé, dressé, brandi, bandé, turgescent. Comment le dire sans le dire tout en le disant, conformément à l’original ? « Assaut » me met sur la voie d’une manœuvre militaire, on donne la charge (comme le taureau avec sa corne effilée). Je vois un officier napoléonien dégainer sa lame. Il attaque… « sabre au clair », voilà qui me plaît. Par acquit de conscience, un coup d’œil sur le prodigieux TLFi (http://atilf.atilf.fr/) sans qui j’aurais déjà fermé boutique, « sabre au clair » : sabre placé hors du fourreau. Pour le plaisir et pour s’assurer de la pertinence de l’image, un petit détour chez les classiques de l’argot, toujours riches d’enseignement sur la question : Le Petit Simonin illustré confirmera à ceux qui en doutent encore que le sabre désigne bien le membre viril. Auguste Le Breton acquiesce dans L’argot chez les vrais de vrais et complète en indiquant que fourreau peut s’employer pour pantalon. CQFD. On aura donc pour investida erecta : « un assaut sabre au clair dans le bordel principal de la ville ».
Voilà comment, pour traduire deux mots, on aura consulté un dictionnaire français en ligne, trois unilingues portugais (un du xixe, deux du xxe siècle), un bilingue plutôt loyal, deux manuels d’argot chinés dans une vie antérieure et une monographie illustrée sur la tauromachie équestre portugaise. Il n’en reste pas moins que l’outil le plus précieux et le plus personnel du traducteur est sans doute ce que Michel Bréal nomme le « dictionnaire latent », niché on ne sait trop où dans la cervelle. Peut-être sur un rayon de notre « bibliothèque neuronale », que viennent sans cesse grossir les lectures d’auteurs aimés pour constituer notre « stock intérieur » (deux expressions de Pierre Michon). Sans approvisionnement régulier, on risque de se retrouver en rupture, en manque de trouvaille. Or, la trouvaille, c’est ce qui fait travailler les langues, disait Derrida, c’est ce qui les fait vivre, les anime ; c’est aussi une des signatures du traducteur, comme un blason secret (car invisible à l’œil nu pour la plupart des lecteurs). Pour une traduction réussie, mieux vaut posséder une certaine dextérité, de l’intuition, la souplesse du contorsionniste, le sens de l’équilibre du funambule, certes. De l’oreille, également, bien sûr (méfiez-vous d’un traducteur qui chante faux, prévient Erri de Luca), afin de rendre au mieux une cadence, une ondulation. Mais qu’est-ce que le rythme ? Encore une formule saisissante de Michon : « Le rythme, c’est un mélange indissociable d’émotion forte et d’un choix lexical infini. » On y revient : ce choix lexical infini, c’est celui dans lequel le traducteur rêve de pouvoir piocher à chaque instant en feuilletant son dictionnaire latent. Autrement dit, pour que le traducteur joue juste, il doit être mélomane et athlétique, il lui faut un système artériel irréprochable, pour que le sang circule vite et bien entre le cœur, le cerveau, les oreilles, les poumons, les mains.
De l’inconvénient d’être Bloom
Traduire, c’est passer son temps à régler des problèmes techniques. Mais une fois qu’on a démonté puis remonté toute la machine, on peut refermer le capot, enlever son bleu de chauffe et, après s’être un peu décrassé, siroter tranquillement le seul plaisir du texte. Tavares invite lui-même le lecteur d’Un voyage en Inde à ne pas se priver de picorer. Amuse-gueules à volonté, servis par un moraliste démoralisé, chacun pourra composer son assiette. Pour accompagner mon bloody mary, voilà mon petit assortiment d’aphorismes, plus ou moins vénéneux :
– Qui est Bloom ? Personne ne le sait (lui moins que personne : il est trop près.)
– La mémoire a de l’avenir, voilà une idée qui est loin d’être pessimiste.
– La consommation, contrairement à ce qu’on nous rabâche, n’est pas une invention du capitalisme : les dieux ont façonné des hommes incomplets, dotés d’un estomac, sensibles au froid et vaniteux. À quel autre résultat pouvait-on s’attendre ?
– Les pauvres ne sont pas bons, c’est seulement qu’ils ont moins d’argent pour faire le mal.
– Tant qu’on peut acheter, c’est qu’on est en vie.
– La ville est un malheur organisé.
– Les amis, soit ils sont parfaits, soit ils sont dangereux. Ils sont dangereux, donc.
– La vérité, c’est l’argent.
– L’amour n’existe pas, et la maison de l’enfance est fermée.
– Et si le Christ, au lieu de parler, avait dessiné, que se serait-il passé ?
– Il est laid et toujours là, voilà l’Homme.
Larbaud : « Les joies et les profits du traducteur sont grands et dignes d’envie »
Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de citer encore le délicieux Larbaud. Traduire, c’est aussi permettre à un ami (connu ou inconnu) d’accéder à ce qui n’était pour lui qu’un bloc de texte impénétrable, indéchiffrable. Une fois la traduction achevée, « votre ami peut lire ce poème, ce livre que vous aimez : ce n’est plus lettre close pour lui ; il en prend connaissance, et c’est vous qui avez brisé les sceaux, c’est vous qui lui faites visiter ce palais, qui l’accompagnez dans tous les détours et les coins les plus charmants de cette ville étrangère que, sans vous, il n’aurait probablement jamais visitée. Vous avez obtenu une entrée pour lui ; vous lui avez payé le voyage. »
On ne vous demande même pas vos papiers. Profitez-en, la voie est libre…
DOMINIQUE NéDELLEC
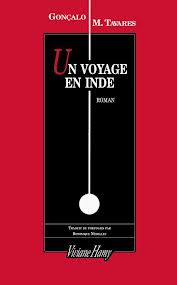 Traducteur du portugais en français d’Un voyage en Inde de Gonçalo M. Tavares
Traducteur du portugais en français d’Un voyage en Inde de Gonçalo M. Tavares
Postface d’Eduardo Lourenço.
Editions Viviane Hamy.
494 pages, 24 €
(« Dominique Nédellec » photo de Brian Graham ; « Gonçalo M. Tavares » photo D.R.)
11 Réponses pour La vacance de monsieur Bloom
merci de ce texte qui tient d’une illumination vue du pont !
Je l’urais supporté plus long, comme un « journal »-au quotidien- de votre travail superbe!
Remarquable vraiment. Nous sommes tout à fait dans l’atelier du traducteur…et c’est tout simplement passionnant. Merci à vous!
Remarquable et passionnant. En plus cela donne envie de lire le livre de Tavares, – et ceci si possible dans une version bilingue !
À propos de Inde et des Indes, j’aime bien le pluriel, peut-être un peu de nostalgie, chez moi, de l’époque quand cette immense nation était supervisée par Albion. @ cneff: Pour Gonçalvo Tavares et ses textes courts, je pense comme vous, il serait plaisant de pouvoir les lire en bilingue.
Cada qual está sempre debruçado sobre o mundo em parapeito frágil.
Gonçalo M. Tavares
Ergo aqui bem alto a minha seta erecta ao vencedor do prémio da Ass. Port. de Escrit. (APE), também conhecido por prémio Macaco (APE), pelo seu romance em dez cantos Uma Viagem à Índia. Como bem topou o respectivo prefaciador Eduardo Lourenço, trata-se de um livro paródico. Para um livro paródico, crítica paródica.
Já Luís Vaz de Camões tentara, com êxito, uma viagem à Índia e o respectivo romance em dez cantos. Sem sair das redondezas de Sião e de Jerusalém, já Amos Oz tentou o mesmo, com êxito, em Só o Mar. Gonçalo M. Tavares, sem sair de Lisboa, aposto, culminou com os Lusíadas do século XXI e ganhou 15 000 euros. Não foi pequena a tença.
Quem acusa Gonçalo M. Tavares de praticar uma filosofia wikipédica em roupagens literárias bebidas nos quatro quadrantes (por acaso nem sei se alguém o acusa disso), está errado porque Gonçalo M. Tavares começam por dizer “não falaremos de…” e depois vem o rol das coisas de que não falarão falando, coisas que apanharam com facilidade (Camões não tinha essas facilidades) numa simples pesquisa do Google escrevendo “coisas incontornáveis da história do mundo e do homem, dignas de figurar num poema épico em prosa”: o rochedo sagrado de Jerusalém, o Parnaso, Hermes Trimesgisto, Santo Graal, o Vesúvio, as águas de Bath em Inglaterra, as pirâmides de Gizé, Stonehenge ou Avebury, Pedra Negra de Meca, Machu Picchu, Os Gregos, os Gregos, penhascos do Colorado… o que ocupa inúmeras estâncias de que não falaremos. Falaremos de Bloom, um português que partiu de Lisboa para a Índia com o seu blusão novo. É assim que começa o livro, um grande livro de 500 páginas e capa dura que se resumem a 100 porque, tirando as coisas de que não falaremos, aquela disposição em verso e espaços para as estâncias faz render os caracteres e os espaços e transforma cada dez páginas em duas no máximo, o que me lembra a palavra coimbrã bazófia.
Vou no fim do primeiro canto.
Quel bonheur de vous lire 🙂 Dominique Nedellec est un ami, je me rappelle quand nous étudions qu’il était toujours plongé dans un livre, sérieusement, ou alors nous devisions de musique… Et le départ à Lisbonne, le début du voyage vers la traduction !
Très belle description de notre métier, la plongée en apnée dans l’océan des mots. Obrigado colega!
Ouaouh ! magnifique !
Pour une première descente dans un blog ce fut une réussite, une magie, un délice. Au plaisir de vous relire, ou plutôt de vous déguster à nouveau !
Gribouille
merci pour le voyage, bloom, je n’ai pas encore lu, j’écris.
Encore faut-il un éditeur compétent et qui ne demande pas, pour une traduction littéraire, de vous livrer une traduction la veille. Le piré étant quand il croit connaître la langue traduite. Il va vous reprocher d’avoir mal traduit « cerimónias » en disant : je sais, ça veut dire cérémonies.


11
commentaires